Intervention de Patrick Weil
Séance en hémicycle du lundi 6 mai 2024 à 15h00
Bilan des politiques publiques de défense et de promotion de la laïcité
Permettez-moi, pour commencer, de remercier le groupe Socialistes et apparentés, en particulier M. Guedj, de son invitation.
En 1905, lorsque le Parlement décide la séparation des Églises et de l'État, l'un des principaux conseillers de M. Aristide Briand, rapporteur du projet de loi, souligne : « La séparation des Églises et de l'État a pour conséquence de faire disparaître l'administration des cultes pour ne laisser subsister que la police des cultes ». La police des cultes correspond aux dispositions pénales, inscrites dans une section du même nom, de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Elles permettent de punir les atteintes à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la séparation des Églises et de l'État. Ces dispositions sont si importantes qu'elles inspirent les articles 1
L'article 1
D'après cette jurisprudence, la liberté de conscience, qui concerne les convictions de chacun en son for intérieur, est une liberté absolue. Le « libre exercice des cultes » désigne le port de signes religieux ou toute manifestation individuelle ou collective d'un culte. L'article 261 du code pénal de 1810 a directement inspiré l'article 1
Au sujet de l'article 31 de la loi de 1905, le principal conseiller d'Aristide Briand évoque la nécessité d'une protection contre les pressions et Aristide Briand lui-même mentionne de possibles actes d'intimidation. Or cet article, qui figure toujours dans la loi et qui a vu ses peines renforcées en 2021, n'est pas appliqué lorsque des pressions s'exercent pour contraindre des personnes à porter des signes religieux – lorsqu'ils sont autorisés – ou à les en empêcher.
Les autres dispositions pénales de la loi de 1905 protègent la séparation des Églises et de l'État. Les intrusions lors de cérémonies religieuses sont punies, tout comme les discours prononcés par des ministres des cultes incitant à la violence contre des fonctionnaires publics ou d'autres citoyens, discours qui font l'objet de peines spéciales et plus sévères que dans le droit commun – Aristide Briand explique bien pourquoi. Mais là encore, ces dispositions pénales qui ont abouti à la condamnation de centaines d'ecclésiastiques entre 1905 et 1914 ont été totalement oubliées. Elles sont certes mentionnées dans la circulaire du garde des sceaux du 22 octobre 2021 faisant suite à l'adoption de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite séparatisme ou CRPR, mais elles sont noyées au milieu de commentaires sur les nouvelles mesures censées protéger la laïcité, sans que les procureurs ou les citoyens français aient conscience que la liberté de conscience, la liberté de culte et la séparation des Églises et de l'État sont déjà protégées par des dispositions pénales.
Permettez-moi, pour conclure, de souligner la dimension éthique des dispositions pénales prévues par la loi de 1905. Nous avons tous appris, même si nous ne savons plus très bien comment, que nous devons assistance à personne en danger. Aux États-Unis, où j'enseigne, cette règle n'existe pas : on n'a pas le réflexe de secourir une personne en danger ; ce n'est pas dans la culture juridique et éthique du pays. En France, la non-assistance à personne en danger repose sur une disposition pénale : elle est punissable d'une amende. Je crois que la protection de la liberté de conscience – la liberté de croire ou de ne pas croire – et de la liberté de manifester sa foi ou non, sans subir de pression, devrait être une éthique enseignée aux citoyens, non pas uniquement par des instructions au procureur, mais dans la vie quotidienne, comme fondement d'une politique de la laïcité collectivement partagée.
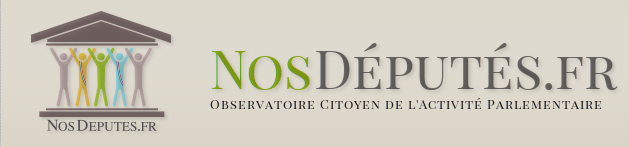

Le 21/05/2024 à 11:54, Aristide a dit :
" sans que les procureurs ou les citoyens français aient conscience que la liberté de conscience, la liberté de culte et la séparation des Églises et de l'État sont déjà protégées par des dispositions pénales."
Si les procureurs ne connaissent pas la loi, c'est un problème...
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui