Intervention de Philippe Sorez
Séance en hémicycle du lundi 6 mai 2024 à 15h00
Bilan des politiques publiques de défense et de promotion de la laïcité
 Philippe Sorez :
Philippe Sorez :Laïcité et école de la République sont intrinsèquement liées. La laïcité, en garantissant la stricte neutralité de l'espace scolaire, participe de l'idéal émancipateur de l'école. Or loin d'être perçue comme un outil d'émancipation, la laïcité est aujourd'hui comprise par un nombre croissant d'élèves comme une interdiction, dirigée contre la religion. Face à ce constat, j'aimerais vous interroger sur deux enseignements censés fournir aux élèves les éléments d'une culture indispensable à la compréhension de notre patrimoine commun : l'enseignement moral et civique (EMC) d'une part, l'enseignement du fait religieux d'autre part.
Concernant le premier, les travaux de la mission d'information sur la redynamisation de la culture citoyenne, conduits au Sénat en 2022, ont mis en évidence un contenu des programmes d'éducation morale et civique à la fois disparate et trop fréquemment modifié au gré des faits de société. En résulte un EMC qui place sur le même plan des thématiques diverses et nombreuses, avec des programmes trop ambitieux, abstraits et confus. Comme le relate Mark Sherringham, président du Conseil supérieur des programmes (CSP), « les programmes actuels se caractérisent par une grande profusion. Les professeurs ne savent pas comment les traiter en intégralité. C'est un peu à la carte. Or un programme national n'est pas à la carte ».
Concernant l'enseignement du fait religieux, il n'existe pas en France, dans les programmes scolaires, de cours de fait religieux à proprement parler. Du collège à la terminale, le fait religieux est seulement abordé et analysé comme élément de compréhension des sociétés passées et de notre patrimoine culturel, par le truchement de disciplines comme l'histoire, l'éducation musicale, les arts plastiques ou encore la philosophie. Or tout l'enjeu de l'enseignement du fait religieux à l'école est d'apaiser la perception de ces sujets, d'expliquer aux élèves la différence entre croire et savoir, et de favoriser « une laïcité d'intelligence », comme l'écrivait Régis Debray dans son rapport de 2002, « L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque ».
Face à ces constats, ne serait-il pas opportun de repenser entièrement l'enseignement moral et civique, en le centrant davantage sur les institutions et les valeurs républicaines, avec une attention particulière portée à la laïcité ? Quant à l'enseignement du fait religieux, la question n'est plus de savoir s'il est justifié de le mener dans les écoles publiques, mais plutôt comment le faire de manière plus efficace et pertinente.
2 commentaires :
Le 21/05/2024 à 14:55, Aristide a dit :
"Quant à l'enseignement du fait religieux, la question n'est plus de savoir s'il est justifié de le mener dans les écoles publiques, mais plutôt comment le faire de manière plus efficace et pertinente."
La plupart des élèves ne savent même pas que Jésus avait 12 disciples, quelle inculture...
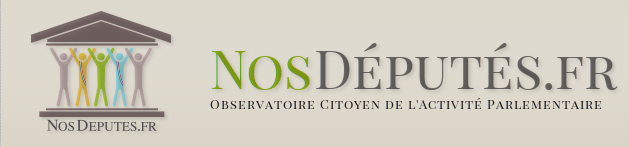

Le 21/05/2024 à 14:54, Aristide a dit :
"La laïcité, en garantissant la stricte neutralité de l'espace scolaire,"
En quoi demander à un élève s'il mange ou non du porc à la cantine participe à la neutralité scolaire ?
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui