Intervention de Sabrina Agresti-Roubache
Séance en hémicycle du lundi 6 mai 2024 à 15h00
Bilan des politiques publiques de défense et de promotion de la laïcité
…mais celui du partage, des savoirs, de la mesure et du discernement. Les pressions doivent être combattues, les règlements des établissements respectés et la loi appliquée. Le voile intégral est interdit partout sur le sol français, tout comme les lieux de prière non déclarés : c'est la loi de la République, qui s'applique à tous.
Si le consensus social autour de la laïcité tend à s'éroder, il continue malgré tout à exister. La dernière étude de l'institut de sondage Viavoice le prouve : plus de sept Français sur dix se déclarent attachés à ce principe républicain. La variation générationnelle est toutefois très marquée : si 85 % des 65 ans et plus se déclarent attachés à la laïcité, ils ne sont que 65 % chez les 18-24 ans. Par ailleurs, près de 40 % des Français souhaiteraient que le sujet soit plus fréquemment abordé et expliqué. Il y a donc une demande de l'opinion publique pour davantage de pédagogie.
Pour répondre à cette exigence d'action et de clarté des Français à notre égard, nous disposons désormais d'outils pour protéger, promouvoir et diffuser le principe de laïcité plus efficacement. Pour rester un trait d'union et garantir la concorde civile et républicaine, la laïcité doit s'adapter aux évolutions de la société française.
Sur le plan juridique, la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République met en place un nouveau cadre destiné à assurer la pleine application de la laïcité à l'ensemble des missions de service public, y compris celles confiées à des entreprises privées sélectionnées lors de marchés publics. Elle permet aussi d'apporter une réponse pragmatique à chaque problème constaté sur le terrain – je pense au déféré laïcité ou au réseau des 17 000 référents laïcité chargés de relayer cette politique publique au sein de leur administration. La création de nouveaux délits, comme celui de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle, répond à notre stratégie visant à améliorer la protection des élus et des agents publics menacés dans leur activité quotidienne. Cela participe à la défense du socle des valeurs essentielles auxquelles nous sommes tous profondément attachés.
Depuis 2021, nous disposons de nouveaux outils dont nous encourageons l'utilisation, y compris par les services de l'État. Je citerai un seul exemple, récent : dans une circulaire adressée aux membres du parquet le 29 avril 2024, le garde des sceaux a rappelé la nécessité d'assurer un traitement prioritaire aux infractions commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion, dans un contexte séparatiste ou d'atteintes au principe de laïcité.
La laïcité n'est pas qu'un principe juridique, c'est aussi une politique publique, que l'État mène tant au niveau du Gouvernement que de l'administration. En juin 2021, le Gouvernement a créé le comité interministériel de la laïcité, placé sous l'autorité du Premier ministre. Cette instance politique, décisionnelle et opérationnelle réunit les ministres concernés afin d'orienter et de promouvoir la politique publique de la laïcité au sein des administrations de l'État et des collectivités territoriales. Ce comité interministériel pourrait être utilement complété par la nomination d'un référent laïcité au sein de chaque cabinet ministériel pour nourrir ce dialogue qui suscite de fortes attentes – c'est une proposition que je formule.
Le secrétariat d'État placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé de la citoyenneté, s'occupe du suivi proprement politique – j'ai l'honneur d'être à sa tête. Il permet de piloter au quotidien la politique publique de la laïcité et de lui offrir une visibilité auprès du grand public mais aussi auprès des partenaires concernés par les questions de laïcité.
Troisième acteur, administratif celui-ci, le bureau de la laïcité relève de la sous-direction des cultes et de la laïcité au sein de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Ce bureau fondé fin 2021 anime et coordonne le travail interministériel mené sur la laïcité, ce qui permet de la promouvoir en fournissant une expertise juridique, politique et sociale au ministère de l'intérieur et des outre-mer, aux autres administrations et au grand public. Il administre aussi le site officiel du Gouvernement laicite.gouv.fr.
Le comité interministériel de la laïcité s'est réuni pour la première fois le 15 juillet 2021 pour valider les orientations de l'action du Gouvernement. À cette occasion, dix-sept décisions ont été prises – plusieurs découlaient directement de la loi CRPR. Elles constituent désormais la feuille de route commune des ministères. Ce plan d'action ambitieux esquisse des mesures que nous devons prendre pour renforcer la connaissance et la compréhension du cadre que fixe la laïcité.
Deux nouvelles obligations s'imposant aux administrations sont particulièrement importantes : former l'ensemble des agents publics au principe de laïcité et nommer un référent laïcité dans chaque administration, qu'elle relève de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, ainsi que dans les autres établissements publics.
La formation des agents publics est un sujet majeur ; ce sont les premiers à incarner et à défendre la laïcité dans le service public. Depuis 2021, la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) met à la disposition de tous les agents publics la formation à distance Mentor. Une formation plus spécifique, en présentiel, est proposée aux agents les plus exposés aux problématiques de laïcité dans l'exercice de leurs fonctions. Cette formation très efficace, associant mises en situation et analyses pragmatiques de cas pratiques, est saluée.
Depuis 2021, tous les nouveaux agents se sont vu proposer une formation sur les fondamentaux de la laïcité. S'agissant des agents déjà en poste, le bureau de la laïcité du ministère de l'intérieur et des outre-mer comptabilise environ 570 000 agents formés entre 2021 et 2024. L'objectif est de former 100 % des agents d'ici à 2025, ce qui est ambitieux et inédit. Nous maintiendrons le rythme et garderons le cap pour continuer à atteindre cet objectif au-delà de 2025. En outre, depuis 2015, pas moins de 120 000 agents ont suivi la formation Valeurs de la République et laïcité dispensée par 2 200 formateurs habilités par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Le bureau de la laïcité remplit son rôle d'animateur de l'action interministérielle portant sur la laïcité en éditant des guides pratiques sur le sujet à l'usage des professionnels. Le « Guide de la laïcité dans la fonction publique » est devenu un outil de référence, facilement accessible et concret – il a vocation à être actualisé le plus souvent possible. Ce guide commence par poser le cadre théorique grâce à des fiches telles que « Qu'est-ce que la laïcité ? », « Qu'est-ce que la neutralité de l'État ? » ou « Qui sont les acteurs de la laïcité au sein de la fonction publique ? ». Il apporte ensuite des éléments de réponse aux problèmes les plus fréquemment rencontrés à travers une série de cas pratiques : « L'agent peut-il porter un signe religieux dans l'exercice de ses fonctions ? », « Le comportement prosélyte d'un agent public envers ses collègues est-il permis ? », « L'obligation de neutralité s'applique-t-elle durant le temps de pause ? » ou « Un candidat peut-il se présenter à un entretien de recrutement en portant un signe religieux ? ». Un autre document, intitulé « Comprendre la laïcité dans la fonction publique » et destiné aux agents publics, complète ce premier guide.
D'autres ministères que celui de l'intérieur et des outre-mer se sont emparés du sujet et ont produit d'autres guides, tout aussi utiles, à destination de leurs agents. En 2016, l'académie de Paris a ainsi publié le guide « Comprendre, enseigner et faire vivre la laïcité », constamment remis à jour par les services du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. La Conférence des présidents d'universités (CPU) – devenue France Universités – édite le « Guide de la laïcité à l'université », dont la dernière actualisation date de 2023. Ces productions montrent que l'État et les administrations publiques sont plus que jamais mobilisés pour faire de la laïcité un cadre de pensée, d'action et de cohésion sociale connu et compris de tous. Il faut que ce concept revête le même sens pour tous.
Les professionnels ne sont pas le seul public visé par la politique publique de la laïcité. Parce qu'il est composé de citoyens de tous âges et toutes origines, aux parcours de vie divers, le grand public est une cible prioritaire. Les pouvoirs publics soutiennent et renforcent la pédagogie de la laïcité qui lui est destinée. Il me paraît fondamental de faire en sorte que le grand public comprenne mieux la laïcité pour qu'il puisse y adhérer davantage – c'est un principe exigeant, mais qui protège la liberté de conscience. À la fin de l'année dernière, j'ai présidé la remise d'un prix de la laïcité qui a mis en valeur de très belles initiatives, comme un concours d'éloquence dans un collège alsacien, ou une mallette pédagogique imaginée par les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Il y a quelques semaines, j'ai demandé au bureau de la laïcité du ministère de l'intérieur et des outre-mer de mettre en place un label des ressources en matière de laïcité, pour constituer un vade-mecum des bonnes pratiques qui fonctionnent concrètement sur le terrain. Ce vade-mecum rassemblera les supports, les contenus et les initiatives reconnus pour leur qualité et leur facilité d'accès ; ceux-ci seront mis à disposition de tous ceux qui souhaitent organiser des actions de sensibilisation, de promotion et d'échange autour de la laïcité. Cela va dans le sens de la pédagogie citoyenne de la laïcité.
L'année 2025 marquera les 120 ans de la loi de 1905. Un cycle mémoriel ponctué de nombreux événements marquants pourrait incarner aux yeux de nos concitoyens, en particulier pour les plus jeunes, une laïcité heureuse, source d'apaisement, de cohésion et de communion nationale.
Vous l'aurez compris, je suis pleinement déterminée à faire en sorte que la laïcité continue d'être le cadre collectif de notre liberté à tous ; une laïcité juste, apaisée, exigeante et bienveillante, pour reprendre les mots du Président de la République.
Depuis 2021, nous avons consolidé la prise en charge et l'organisation administrative et gouvernementale de l'action publique en matière de laïcité ; les résultats sont là. Nous devons poursuivre ces efforts dans tous les domaines, avec la société civile et le tissu économique, car c'est collectivement et non séparément que nous parviendrons à préserver les acquis républicains qui nous sont si chers.
2 commentaires :
Le 21/05/2024 à 19:15, Aristide a dit :
"Il me paraît fondamental de faire en sorte que le grand public comprenne mieux la laïcité pour qu'il puisse y adhérer davantage"
Commencez par la comprendre vous-même.
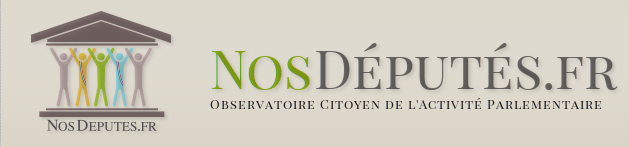

Le 21/05/2024 à 19:13, Aristide a dit :
"Depuis 2021, tous les nouveaux agents se sont vu proposer une formation sur les fondamentaux de la laïcité. "
Une formation en endoctrinement politique...
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui