Stéphane Rambaud
Question N° 6704 au Ministère de l’intérieur
Question soumise le 28 mars 2023
M. Stéphane Rambaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la récente décision n° 2022-1034 QPC du Conseil constitutionnel du 10 février 2023 sur les relevés signalétiques contraints. En effet, l'article 55-1 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire de procéder ou de faire procéder, dans le cadre d'une enquête de flagrance, aux opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police. De même, lorsqu'une personne majeure est entendue sous le régime de la garde à vue ou de l'audition libre, ces opérations de prise d'empreintes ou de photographies peuvent, sous certaines conditions, être effectuées sans son consentement. Cependant, le Conseil constitutionnel vient de juger que, en cas de refus de la personne concernée par les relevés signalétiques, il sera désormais nécessaire d'obtenir du procureur de la République une autorisation écrite à condition que ce soit l'unique moyen d'identifier la personne, que ladite personne soit soupçonnée d'avoir commis un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, que le recours au relevé signalétique contraint soit strictement proportionné, que la présence de l'avocat soit obligatoire. Cette décision n'est pas sans susciter de graves inquiétudes auprès des services de la police judiciaire, qui craignent de ne pouvoir exercer les prérogatives que leur octroie la loi pour lutter contre les phénomènes de délinquances et les phénomènes migratoires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions nécessaires qu'il entend initier afin de préserver l'action de la police nationale face à la délinquance sans alourdir les procédures et tout en maintenant ses pouvoirs d'investigations.
Réponse émise le 17 octobre 2023
Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a précisé dans une décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023 les contours du recours aux relevés signalétiques contraints. Face aux difficultés d'identification de personnes mises en cause dépourvues de titre d'identité, qui refusent de s'identifier ou qui usent de noms ou d'alias différents, il est apparu nécessaire de prévoir un dispositif autorisant l'usage d'une contrainte strictement encadrée pour obtenir leurs empreintes digitales, palmaires ainsi que leurs photographies. Il peut ainsi être recouru aux relevés signalétiques contraints dans le cadre d'une enquête (flagrance ou préliminaire) ou d'une information judiciaire à l'égard d'une personne (art 55-1, 76-2 et 154-1 du Code de procédure pénale - CPP) entendue sous le régime de la garde à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans si elle est majeure ou 5 ans si elle est mineure, qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, ou dès lors que la prise de ses empreintes palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen de l'identifier. Il doit être souligné que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le dispositif légal permettant aux officiers de police judiciaire d'avoir recours, sous certaines conditions, à la contrainte pour la signalisation des personnes, entendues sous le régime de la garde à vue, refusant de s'y soumettre. Il a en effet jugé que le législateur, en adoptant ces dispositions, avait entendu faciliter l'identification des personnes mises en cause au cours d'une enquête pénale, poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions. Cette décision, même si elle paraît de nature à complexifier le travail des forces de l'ordre, conforte donc néanmoins une avancée importante qui a été introduite par l'article 30 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Avant cette loi en effet, les opérations de signalisation ne pouvaient être réalisées qu'avec le consentement de la personne concernée. En l'absence d'un tel consentement, aucune mesure coercitive ne pouvait être mise en œuvre (le refus de se soumettre aux relevés signalétiques était toutefois pénalisé). Le cadre posé par la loi du 24 janvier 2022 demeure donc porteur d'une amélioration incontestable pour l'action des forces de sécurité intérieure de l'État. Dans sa décision du 10 février 2023, le Conseil constitutionnel a toutefois rappelé, d'une part, le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire et, d'autre part, le nécessaire respect des droits de la défense. Ainsi a-t-il émis une réserve d'interprétation selon laquelle les opérations de prises d'empreintes ou de photographies sans le consentement de la personne, qu'elle soit majeure ou mineure, ne sauraient être effectuées hors la présence de son avocat ou des représentants légaux de la personne, lorsque leur présence est requise. En pratique, il conviendra donc que l'avocat du mis en cause soit présent lors de la mise en œuvre d'un relevé signalétique sans consentement. Par ailleurs, ont été jugées contraires à la Constitution les dispositions permettant de recourir à la contrainte afin de signaliser les personnes, majeures ou mineures, entendues sous le régime de l'audition libre, le respect des droits de la défense exigeant que la personne entendue dans ce cadre le soit sans contrainte et puisse quitter à tout moment les locaux où elle est entendue. Il ne peut donc plus être recouru à la contrainte pour la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'une personne, mineure ou majeure, entendue sous le régime de l'audition libre. En cas de nécessité, si l'infraction relevée le permet et sous réserve de l'existence d'un des motifs énoncés à l'article 62-2 du CPP, il est donc impératif de prendre une mesure de garde à vue afin de garantir les droits de la défense pour appliquer ce dispositif en la présence obligatoire d'un tiers (avocat, responsable légal ou adulte approprié), tout en respectant les quantums minimums de peines associées aux majeurs et aux mineurs. Concernant la notion de contrainte à appliquer, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), par le biais de la circulaire n° JUSD2209905C en date du 28/03/2022, a précisé qu'elle devait être strictement nécessaire et proportionnée et tenir compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne ou de la situation particulière du mineur. Elle parait ainsi devoir être proscrite à l'encontre de personnes souffrant d'un handicap physique ou psychique, ou dont le discernement apparaît altéré. Par ailleurs, les empreintes digitales et palmaires ainsi que les photographies, qui ont pour but l'établissement d'une correspondance avec une précédente signalisation enregistrée au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ou au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), doivent être d'une qualité suffisante afin de pouvoir être intégrées et exploitées par ces fichiers. Dès lors, il convient de souligner que l'usage de la contrainte pour relever les empreintes digitales doit être évité face à une personne très récalcitrante ou manifestant une résistance physique importante dans la mesure où le recueil de l'empreinte des cinq doigts et des deux paumes des mains serait en tout état de cause impossible à réaliser dans des conditions satisfaisantes. La décision citée supra a donc eu pour effet de limiter les possibilités de recours aux relevés contraints, ceux-ci étant uniquement possibles à l'occasion d'une garde à vue et en présence d'un tiers, selon les cadres strictement énoncés par les articles 55-1 du CPP, ainsi que des articles L413-16 et L413-17 du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Bien que destiné à faciliter le travail des forces de l'ordre en terme d'identification de personnes mises en cause pour des infractions à la loi pénale, le droit positif, en sus de la décision du Conseil constitutionnel et de la doctrine diffusée par la DACG, impose un cadre strict et limitatif auquel il ne peut être dérogé. Ces réserves ont pris effet immédiatement, à compter du 10 février 2023. Toutefois, les relevés signalétiques contraints réalisés lors d'une audition libre avant cette date ne peuvent pas être contestés sur le fondement de cette déclaration d'inconstitutionnalité. En revanche, il doit être relevé que, contrairement à ce qu'écrit l'auteur de la question, le Conseil constitutionnel ne vient pas de juger que, « en cas de refus de la personne concernée par les relevés signalétiques, il sera désormais nécessaire d'obtenir du procureur de la République une autorisation écrite ». Cette condition était en effet déjà prévue par la loi du 24 janvier 2022, qui a autorisé une contrainte strictement encadrée pour les relevés signalétiques. En tout état de cause, la politique d'allégement du formalisme procédural et de simplification de la procédure pénale se poursuit sous l'impulsion du Gouvernement. La mise en œuvre de ce dispositif n'a engendré la rédaction d'aucun acte procédural supplémentaire autre que ceux déjà prévus et accessibles dans les fonctionnalités du logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN). Il est en effet nécessaire d'établir, par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, un procès-verbal retraçant les opérations et exposant les raisons pour lesquelles les enquêteurs ont eu recours à l'unique moyen d'identifier l'intéressé. Ce procès-verbal fait également état de la décision du magistrat, laquelle est annexée à ladite pièce de procédure. L'original est remis au magistrat (lors de la transmission de la procédure), et une copie à l'intéressé. La montée en puissance de la procédure pénale numérique, expérimentée à partir de 2019 et en cours de déploiement depuis 2020, se poursuit. Elle devrait être généralisée dans l'ensemble du territoire d'ici à la fin de 2025. Il s'agit d'un réel progrès pour les policiers de terrain, avec l'abandon du papier et de la signature manuscrite. La transformation numérique de la police nationale (outils de travail en mobilité, mise en place de la plainte en ligne, futur service de prise de plainte par visioconférence…) constitue un autre vecteur de simplification. Par ailleurs, la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur crée des « assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale », recrutés parmi les personnels administratifs, pour décharger les enquêteurs de diligences procédurales formelles et améliorer la qualité des enquêtes face à la complexification croissante de la procédure. Ces nouveaux « assistants d'enquête » permettront aux enquêteurs de se concentrer sur leur cœur de métier. La loi du 24 janvier 2023 comporte ou prévoit également diverses dispositions de simplification de la procédure (simplification du recours à la télécommunication audiovisuelle pour certains actes d'enquête, extension des autorisations générales de réquisition, suppression de la procédure de réquisition des services de police technique et scientifique par les services de la police nationale, présomption d'habilitation des agents à accéder aux fichiers de police, etc.). Elle élargit également le champ des amendes forfaitaires délictuelles. Les dispositions contestées, à savoir le quatrième alinéa de l'article 55-1 du Code de procédure pénale et les articles L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs, ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou le droit à un procès équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
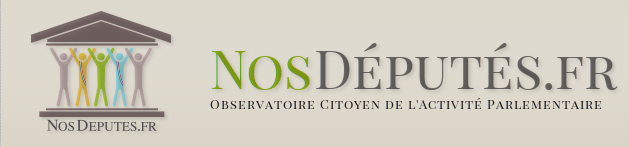


Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.