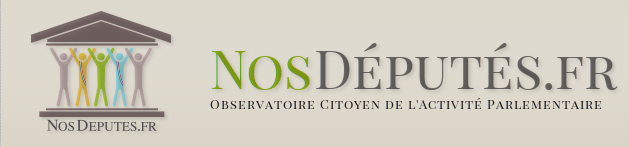Commission d'enquête sur le montage juridique et financier du projet d'autoroute a
Réunion du lundi 15 avril 2024 à 9h30
Résumé de la réunion
La réunion
La séance est ouverte à neuf heures trente.
La commission auditionne M. Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie, chargé des transports et des mobilités, et Mme Catherine Trevet, directrice territoriale de la SNCF, sur la liaison ferroviaire entre Toulouse et Castres.

Nous poursuivons nos travaux consacrés aux hypothèses économiques et sociales qui ont justifié le choix de recourir à l'autoroute A69 pour améliorer la liaison routière entre Toulouse et Castres. Je souhaite la bienvenue à M. Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie en charge des transports et des mobilités ainsi qu'à Mme Catherine Trevet, directrice territoriale de la SNCF.
Madame la directrice, Monsieur le président, je vous suis reconnaissant de contribuer à nos travaux, car je sais que vous aviez d'autres engagements aujourd'hui ; je vous remercie d'avoir accepté de les différer pour participer à cette audition.
Monsieur Gibelin, vous vous êtes déjà exprimé devant l'Assemblée nationale sur la question de l'autoroute A69 lors de l'examen de la pétition à l'encontre de cette autoroute.
Castres et Toulouse sont reliées non seulement par la route nationale 126, et prochainement par l'autoroute A69, mais également par une liaison ferroviaire ancienne qui assure néanmoins un service régulier de passagers. L'existence de cette liaison ferroviaire est souvent invoquée à l'encontre de l'autoroute A69 et plusieurs appels ont été émis pour sa modernisation. En effet, les opposants à l'autoroute estiment que l'alternative ferroviaire n'a pas été approfondie, contrairement à ce qui a été indiqué, notamment dans le cadre de l'étude d'impact.
Votre audition a donc pour objet de nous faire part de l'état actuel de cette voie et du coût financier que représenterait pour la région et SNCF Réseau une modernisation qui consisterait en un doublement de la voie et en son électrification.
Nous souhaiterions également connaître le montant des investissements logistiques nécessaires s'il était ambitionné d'en faire un axe pour le fret. Je rappelle que lors de la première audition de notre commission d'enquête, M. Martin Malvy, ancien président de la région Midi-Pyrénées, puis Occitanie, avait avancé un chiffre de l'ordre d'un milliard d'euros, ce qui avait conduit la région à ne pas s'engager dans un tel investissement alors qu'elle avait considérablement développé les dessertes ferroviaires par ailleurs.
En outre, les économistes des transports et les élus de terrain s'accordent pour constater que le rail et la route ne sont pas substituables. En effet, ces modes de transport sont empruntés pour des raisons et dans des circonstances bien précises. La liaison ferroviaire circule entre Saint-Sulpice et Mazamet alors que l'autoroute desservira Castres en passant par plusieurs localités, soit un parcours différent. Cependant, il est vrai qu'il est utile pour une ville de disposer des deux modes de transport, sous réserve d'en assumer seule les coûts ou grâce à la solidarité nationale.
Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(M. Jean-Luc Gibelin et Mme Catherine Trevet prêtent serment)

Madame, Monsieur, je vous remercie de votre présence devant notre commission d'enquête. Le thème de notre audition est à la fois clair et simple, mais également, comme toujours en matière de transport ferroviaire, un peu complexe.
La future autoroute artificialise les sols, porte atteinte à l'agriculture ainsi qu'à la biodiversité, altère le cycle de l'eau et va générer évidemment l'émission de gaz à effet de serre. Face à ces nuisances, le Gouvernement et la majorité actuelle ne cessent d'affirmer que les transports collectifs électrifiés, notamment le train, constituent une réponse à l'urgence climatique et au besoin de mobilité. Telles étaient les affirmations du précédent ministre des transports et telles sont les affirmations réitérées de l'actuel ministre.
Dans cette logique, la loi de finances pour 2024 a prévu la taxation des sociétés d'autoroutes afin de financer notamment les infrastructures ferroviaires, en particulier non seulement les futurs services régionaux métropolitains, mais également les lignes de desserte fine telles que la liaison Toulouse-Castres. Cette taxe, adoptée après recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, devrait générer un produit de six milliards d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable pour financer le transport ferroviaire et compte tenu du retard que nous constatons en matière d'investissements, pour régénérer et moderniser le réseau. Cette taxe est par ailleurs contestée par les sociétés autoroutières.
Le Gouvernement a annoncé un budget de cent milliards d'euros consacré au transport ferroviaire. Dès lors, dans ce contexte très favorable au train et au rail, pourquoi avoir écarté si rapidement l'hypothèse d'une modernisation de la ligne ferroviaire entre Toulouse et Castres ? Pourquoi ne l'avoir pas même examinée ? Certes, elle est onéreuse, mais j'espère que cette audition nous permettra de comprendre les chiffres qui sont avancés.
L'ensemble des politiques climatiques nécessite de forts investissements. À titre d'exemple, l'effort budgétaire de l'État pour 2024 s'élève à douze milliards d'euros pour la régénération et la rénovation énergétique des bâtiments. Il est complété par les régions et les municipalités quand il y a urgence. Quand il s'agit de combattre la première source de pollution, c'est-à-dire les mobilités, qui représentent 32 % des gaz à effet de serre actuellement en France, force est de constater que les collectivités locales et les collectivités publiques sont capables de se mobiliser.
Votre audition nous permettra de faire le point sur ce dossier. Je vous ai adressé un questionnaire qui a été communiqué à tous les députés membres de la commission d'enquête, de sorte que tous disposent du même niveau d'information quant au sens que je souhaite donner à nos échanges. En effet, je tiens à ce que cette commission d'enquête soit véritablement une instance démocratique extrêmement forte. Si votre audition ne vous permet pas de répondre exhaustivement à ce questionnaire, vous pourrez le compléter par écrit, en ajoutant tout élément qui vous semblerait utile.
Madame la rapporteure, nous avons bien reçu votre questionnaire auquel je répondrai en ma qualité de vice-président de la région, membre de la majorité régionale, en charge des mobilités pour toutes et tous, et en fonction depuis janvier 2016.
J'ai eu dans ce cadre l'occasion d'agir avec un volontarisme fort afin de développer les mobilités, notamment les mobilités ferroviaires, de sorte que les populations de nos territoires ne soient pas assignées à résidence. C'est un point très important auquel s'est attachée la majorité régionale et qui mobilise régulièrement nos politiques régionales.
En matière de transport ferroviaire, nous avons signé une convention de longue durée avec le groupe SNCF et cela explique nos relations importantes avec SNCF Réseau puisque, dans d'autres régions, le conventionnement est signé réglementairement et uniquement avec SNCF Voyageurs. Je pense que nous aurons l'occasion d'évoquer ce plan rail dans nos échanges. Il concerne non seulement les lignes de desserte fine du territoire, mais également le soutien aux lignes à grande vitesse, une ambition pour le ferroutage qui, bien qu'il ne relève pas d'une compétence de la région, faisait partie des différentes actions du plan issu des états généraux du rail et de l'intermodalité. Ce plan contient également, bien sûr, un plan vélo, une stratégie de covoiturage et des voies ferrées portuaires.
Bref, nous réservons une place vraiment centrale au transport ferroviaire dans la région, dans le cadre d'un budget vert dont l'objectif consiste à devenir le plus rapidement possible une région à énergie positive, notamment en ce qui concerne les mobilités.
Nous travaillons dans un contexte difficile, avec un investissement gouvernemental que nous jugeons insuffisant. En 2021, cet investissement représentait quarante-cinq euros par habitant et par an en France, alors qu'il s'élevait à cent trois euros en Italie, cent vingt-quatre euros en Allemagne et quatre cent treize euros en Suisse. Ce constat a conduit les présidentes et les présidents des régions de France à publier une tribune, il y a plusieurs mois, afin d'obtenir un choc d'investissements qui permette un choc d'offres, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Plusieurs chiffres avaient été annoncés, notamment cent milliards d'euros, qui ne se sont pas concrétisés à notre niveau, ce qui nous préoccupe vivement.
Nous sommes convaincus du besoin d'infrastructures. Dans le cadre des échanges relatifs au volet mobilité des contrats de plan État région (CPER), la part consacrée aux infrastructures routières s'élève à 20 % de l'ensemble des engagements régionaux alors que nous totalisons deux mille quatre cents kilomètres de voies ferroviaires et globalement cinquante-trois mille kilomètres de routes départementales, nationales ou autoroutes à l'échelle régionale.
En réponse à votre première question, il nous apparaît évidemment que la ligne concernée appartient au réseau ferroviaire national ouvert au trafic et elle est soumise à une maintenance assurée par SNCF Réseau. S'agissant de sa rénovation, cette ligne a bénéficié d'investissements du plan rail de la région Midi-Pyrénées et du plan rail Occitanie. Elle présente des enjeux de renouvellement comparables à un grand nombre de lignes de desserte fine du territoire.
Des travaux lourds de renouvellement ont été réalisés au cours des quinze dernières années. Je précise d'ailleurs que, contrairement à d'autres lignes d'Occitanie, la pérennité de cette ligne n'est absolument pas menacée, notamment parce que les opérations ont été menées en leur temps. En effet, la ligne bénéficie d'opérations de régénération régulières avec ou sans fermeture de ligne. D'ailleurs, les derniers travaux sur le secteur, réalisés en 2023, portaient sur la mise au gabarit des lignes au niveau des gares de Lavaur et de Castres, ainsi que sur un traitement de la voie permettant de lever les limitations de vitesse précédemment mises en place sur cette ligne. Des opérations sur les ouvrages hydrauliques sont programmées en 2024, ainsi que des opérations de renouvellement de voies.
La situation de la ligne Toulouse-Castres est comparable à celle de lignes qui relèvent de la même classification et qui ont été renouvelées selon un calendrier similaire. C'est ainsi le cas de Toulouse-Albi, de Toulouse-Auch ou de Toulouse-Figeac.
La ligne Toulouse-Montauban, que vous évoquez dans votre question, n'est pas comparable puisqu'elle ne relève pas de la même catégorie du réseau structurant. Elle bénéficie d'installations plus performantes parce qu'elle ne correspond pas au même classement. Elle est composée d'une double voie et d'un passage à quatre voies entre Toulouse et Saint-Jory. Elle est parcourue par un nombre plus important de trains et pas uniquement de trains régionaux, contrairement à la ligne Toulouse-Castres. Enfin, elle est deux fois plus courte que la ligne Toulouse-Castres-Mazamet.
S'agissant de la fréquentation quotidienne, elle varie entre mille quatre cents et deux mille voyages par journée, du lundi au vendredi, et environ mille voyages par jour en week-end, sauf pour les week-ends à un euro. En effet, dans la région, le premier week-end de chaque mois est un week-end à un euro et la fréquentation est évidemment plus importante.
La desserte actuelle s'élève à douze allers-retours, du lundi au vendredi, et cinq et demi allers-retours le samedi et le dimanche, ce qui permet une fréquence d'environ un train par heure en heure de pointe et un train toutes les deux heures en heures creuses.
La desserte est plus dense sur le tronc commun Toulouse-Saint-Sulpice, également emprunté par les trains qui desservent Albi, Rodez et Figeac. Le doublement de vingt kilomètres de voies entre Toulouse et Saint-Sulpice dans le cadre du plan rail a permis d'augmenter la capacité de cette section de ligne, souvent citée comme la ligne de voie unique la plus parcourue d'Europe. Cette capacité supplémentaire a permis de développer le niveau de desserte et surtout d'en améliorer la fiabilité grâce à l'installation en parallèle d'une nouvelle signalisation.
Pour autant, il demeure encore certains obstacles à l'augmentation du nombre de trains et de la capacité d'emport de voyageurs sur la section Toulouse-Saint-Sulpice. Deux tunnels restent en voie unique et constituent dès lors des goulots d'étranglement dans l'organisation des circulations. Au-delà de la voie, le gabarit de ces deux tunnels ne permet pas l'utilisation de rames à deux niveaux avec de plus grandes capacités d'emport. En outre, la ligne n'est pas électrifiée ; seuls les trains thermiques peuvent circuler et ces trains sont moins performants que les trains électriques. À noter d'ailleurs, que l'électrification de la ligne est la deuxième condition nécessaire à la circulation des trains à deux niveaux puisqu'ils n'existent pas en traction thermique actuellement dans le parc. Enfin les capacités d'accueil de Toulouse-Matabiau sont contraintes et, sur un certain nombre d'horaires, nous approchons de la saturation.
S'agissant du prix moyen, le billet plein tarif pour un trajet entre Toulouse et Castres coûte 19,80 euros et 23,10 euros pour le trajet entre Toulouse et Mazamet. Cependant, en Occitanie, la notion de prix moyen n'est pas vraiment appropriée parce que la gamme tarifaire est très vaste et comporte de nombreuses propositions. La recette moyenne enregistrée par voyage ferroviaire sur la ligne Toulouse-Castres s'élève à 5,94 euros, à comparer au tarif plein de 19,80 euros. En fait, ce montant tient compte non seulement des ventes de billets à plein tarif, mais également de l'ensemble des voyages à tarif réduit, voire gratuit, proposés par la gamme tarifaire. C'est une concrétisation de la variété de la gamme proposée sur cette ligne et qui conduit à penser que, régulièrement, 85 à 90 % des usagers voyagent à tarif réduit. En outre, pour les usagers actifs entrant dans le cadre du trajet entre domicile et travail, les trajets peuvent être pris en charge à 50 % par l'employeur, voire 75 % pour les agents de la fonction publique.
Le réseau est évidemment d'abord et avant tout tourné vers l'intermodalité. J'ai précédemment évoqué les états généraux du rail et de l'intermodalité et la mise en place du service régional des mobilités, qui porte sur quatre piliers : la convention Transport express régional (TER), les transports interurbains et les transports scolaires régionaux qui concernent près de cinq mille véhicules tous les jours et cent quatre-vingt mille enfants transportés dans la région, les transports alternatifs comprenant le plan vélo, le covoiturage, et enfin, quatrième pilier, les pôles d'échanges multimodaux. Les aménagements déployés au niveau des points d'arrêt favorisent cette combinaison avec les autres modes de transport, notamment avec le plan vélo, le stationnement pour les véhicules légers, les emplacements de covoiturage. À partir du mois de septembre, sur deux lignes de la région, nous lancerons une expérimentation de location de longue durée de vélos pour les usagers du vélo et de vélo-train pour leurs trajets entre leur domicile et leur travail.
Le plan d'échange multimodal de Castres a fait l'objet d'un accompagnement régional, avec une participation de 1,6 million d'euros sur un budget qui s'élevait à 3,9 millions d'euros. Sa mise en œuvre constituera un acte fondateur de la multimodalité de la ligne et permettra également de rediriger les lignes urbaines et régionales vers la nouvelle gare routière créée sur le même site que la gare ferroviaire, et qui comprend un parc de stationnement de cent places supplémentaires pour les voitures ainsi que des places pour que le covoiturage.
S'agissant des infrastructures, la plateforme ferroviaire entre Toulouse et Castres peut accueillir du fret ferroviaire, mais limité dans sa nature. La ligne est classée en charge C, classement national qui signifie que le fret ne peut pas excéder vingt tonnes par essieu. Le maintien de l'accès aux trains de fret avait d'ailleurs été une condition fixée en 2007 par la région, lors de la signature du plan rail.
La ligne bénéficie également à Castres d'une cour pour les marchandises, active et utilisable, ainsi que d'une installation terminale embranchée (ITE). Certaines voies de la cour précitée sont mutualisées avec des fonctions de la défense nationale, mobilisables par le ministère des armées. L'embranchement, particulier à Castres, continue de donner lieu au paiement de redevances annuelles d'usage, mais il semble non fonctionnel, car il est dénué d'aménagement sur sa partie privative.
Le développement des services de fret serait tout autant limité non seulement par le nombre restreint d'infrastructures logistiques fonctionnelles, mais également par des contraintes de sillons rencontrées par la ligne ainsi que par la charge à l'essieu.
Dans un passé récent, la ligne comprenait un centre de transport combiné à l'entrée de Mazamet ainsi qu'une cour pour marchandises et des embranchements particuliers entre Castres et Mazamet. À l'inverse, le site de la zone d'activités des portes du Tarn à Saint-Sulpice est traversé par la voie et pourrait faire l'objet d'un embranchement à la demande d'entreprises. Je rappelle que, depuis 2018, la région a voté le principe du cofinancement régional des embranchements pour les entreprises.
L'estimation du coût de la réhabilitation et du doublement la voie est basée sur un ratio au kilomètre issu des études de SNCF Réseau, appliqué à la ligne Toulouse-Castres-Mazamet, mais également en rapport avec ce que nous finançons aujourd'hui sur d'autres lignes. L'estimation a été ramenée aux conditions économiques courantes pour les hypothèses d'électrification.
L'enjeu de doublement de la voie ne pourrait être apprécié plus avant qu'en fonction d'un objectif de service précis, dans le cadre d'études spécifiques par des experts. La présidente l'a ainsi exprimé et confirmé dans un courrier adressé à des parlementaires et que nous mettrons à disposition de la commission d'enquête, si vous le souhaitez. Les études des experts ont abouti à une estimation de 669 millions d'euros aux conditions économiques de 2023, soit de l'ordre d'un milliard d'euros courants à la réalisation.
Vous nous interrogez quant à la prise en compte sérieuse de la possibilité de réhabilitation. Je suis en mesure de vous confirmer que les projets de régénération de l'ensemble de la ligne ont permis de la pérenniser. En outre, les enjeux de desserte, notamment la faible densité d'arrêts intermédiaires de la ligne ferroviaire ainsi que son tracé différent de l'autoroute, ont été correctement identifiés.
L'ensemble des autorités organisatrices de mobilité a été consulté, à savoir, à l'époque, les conseils départementaux de la Haute-Garonne et du Tarn. Je vous propose de partager un extrait du dossier qui, à la page 51, évoque la synthèse des effets du projet sur les autres modes de transport : « Sur le ferroviaire, l'impact du projet sera faible, car l'aire de desserte entre les deux infrastructures n'est pas la même. Les infrastructures sont toutefois complémentaires du point de vue de la couverture territoriale, ce qui conforte le développement de l'infrastructure ferroviaire engagé : doublement de la ligne Toulouse-Saint-Sulpice, rénovation des voies sur l'axe Saint-Sulpice-Castres-Mazamet ».
L'instruction ministérielle du 16 juin 2014 définit le cadre général de l'évaluation socioéconomique des grands projets d'infrastructures. Les gains de temps ne sont pas les seuls effets pris en considération parmi les effets monétisables et les effets non marchands. La caractérisation d'un projet, notamment en regard d'un autre, ne semble pas se résumer à l'unique comparaison des gains de temps. En revanche, faute de connaître les points de départ et d'arrivée des trajets en voiture, nous ne pouvons pas établir de comparaisons. Il ne relève d'ailleurs pas de notre compétence de juger la pertinence des modalités d'évaluation socioéconomique des grands projets d'infrastructures qui sont établies au plan national.

Madame Trevet, nous souhaiterions que vous fassiez le point sur l'état d'utilisation de la ligne entre Saint-Sulpice et Mazamet. En effet, depuis la dégradation et les occupations par des militants opposés à l'autoroute A69, cette ligne n'est plus utilisée dans sa totalité.
Il me semble intéressant de revenir sur les caractéristiques de la ligne ferroviaire afin de compléter les propos de M. Gibelin.
La ligne Toulouse-Castres-Mazamet constitue une des lignes de desserte fine du territoire en Occitanie L'Occitanie comprend mille quatre cents kilomètres de lignes de desserte fine sur l'ensemble du territoire et la ligne Toulouse-Mazamet est longue de cent-cinq kilomètres, dont une vingtaine de kilomètres de doubles voies. Cette ligne n'est pas électrifiée, mais elle présente la particularité de bénéficier d'une double technologie de signalisation afin de permettre son exploitation. Sur le tronçon Toulouse-Saint-Sulpice, la ligne est télécommandée depuis le poste de commandement de Toulouse via la commande centralisée Toulouse-Teissonnières.
Sur le tronçon entre Saint-Sulpice et Mazamet, la ligne est exploitée en bloc manuel de voix unique (BMVU). Aucune obsolescence n'est programmée pour cette technologie d'exploitation et donc aucun renouvellement n'est planifié.
Cette ligne comprend également des ouvrages structurels, à savoir non seulement deux tunnels de six cents mètres et de neuf cents mètres entre Toulouse et Saint-Sulpice, qui sont en voie unique avec des gabarits limitants, mais également cinq viaducs entre Saint-Sulpice et Castres ainsi que soixante-dix-sept passages à niveau, soit treize entre Toulouse et Saint-Sulpice, quarante-six entre Saint-Sulpice et Castres et dix-huit entre Castres et Mazamet.
Ces précisions montrent qu'il est complexe de comparer la ligne Toulouse-Castres Mazamet aux lignes Toulouse-Montauban ou Toulouse-Albi. Il s'agit effectivement d'une ligne de desserte fine du territoire, contrairement à Toulouse-Montauban qui circule sur un réseau structurant dont l'infrastructure est profondément différente, tout comme le niveau de trafic et la typologie des circulations. Sur la ligne entre Toulouse et Montauban, nous enregistrons en moyenne quatre-vingt-quinze circulations de voyageurs et quinze circulations de fret, à comparer aux vingt-deux circulations sur le tronçon entre Saint-Sulpice et Mazamet et aux soixante-huit circulations sur le tronçon entre Toulouse et Saint-Sulpice.
En outre, le nombre de passages à niveau rend l'exploitation de cette ligne plus complexe et plus fragile, en raison de nombreux incidents qui affectent sa régularité. La proximité des passages à niveau majore les effets de ces incidents.
Je vous confirme que cette ligne a déjà fait l'objet de nombreuses opérations de régénération non seulement via le précédent plan rail entre 2009 et début 2010, mais également à travers le nouveau plan rail, porté par la région Occitanie, de huit cents millions d'euros sur la période 2023-2027. En effet, ce plan rail prévoit près de dix-sept millions d'euros d'investissements sur le tronçon reliant Saint-Sulpice à Mazamet, pour le confortement d'ouvrages d'art, le remplacement d'appareils de voie et le remplacement de voies et de ballast.
Le temps de parcours ferroviaire entre Toulouse et Mazamet s'élève à une heure et quarante minutes, le meilleur temps étant d'une heure et trente-huit minutes. Le temps de parcours ferroviaire entre Toulouse et Castres s'élève à une heure et dix minutes, le meilleur temps étant d'une heure et sept minutes.
Nous rencontrons des difficultés d'exploitation de la ligne ferroviaire en raison d'une occupation de zone sur le tronçon Castres-Mazamet par les opposants à l'autoroute A69. Nous avons été amenés à interrompre les circulations ferroviaires depuis le 8 mars 2024. De nombreux actes de malveillance ont été perpétrés et la présence de personnes sur les voies ne nous permettait plus d'exploiter la ligne en toute sécurité et avec la qualité requise du service. Nous avons subi neuf dérangements d'installations sur les passages à niveau entre le 1er janvier et le 7 mars 2024, ainsi que de nombreux envahissements de voies qui nous ont conduits à interrompre les circulations pendant sept journées à cette période. Nous avons déploré de nouvelles dégradations sur le passage à niveau 93, le 2 avril dernier.
Toutefois, la zone occupée ayant été déplacée et éloignée des infrastructures, après un échange avec la préfecture, nous avons décidé de réaliser les travaux nécessaires pour permettre une réouverture de la ligne en toute sécurité. Les travaux sont en cours et doivent se terminer ce soir. Les derniers trains de travaux passent au moment où je vous parle pour une réouverture de l'infrastructure en fin de journée et une reprise des circulations commerciales dès demain, si rien ne s'y oppose. J'attire cependant l'attention sur le fait que s'il venait à y avoir à nouveau de nombreuses dégradations ou des personnes sur les voies, et que les conditions de sécurité ne soient à nouveau pas réunies, il n'est pas exclu que nous soyons contraints d'interrompre à nouveau les circulations, mais ce n'est pas notre objectif et nous sommes dans une dynamique de reprise de l'exploitation de la ligne.
Je vous confirme que nous avons bien été saisis par la région Occitanie pour réaliser une étude préliminaire de différents scenarii concernant des travaux nécessaires, afin de renforcer l'offre ferroviaire. Nous avons étudié un scénario dit « optimum » qui consiste en un doublement de l'ensemble de la voie entre Toulouse et Mazamet et en une modernisation de la signalisation puisque la signalisation actuelle limite l'exploitation. Le chiffrage de ce scénario « optimum » a conduit à une estimation de 2,7 milliards d'euros aux conditions économiques de 2023, soit un peu plus de 4 milliards d'euros aux conditions économiques de 2034.
En parallèle, nous avons étudié un scénario dit « minimaliste », scénario d'optimisation, qui consiste en un doublement de la voie uniquement sur l'axe Toulouse-Saint-Sulpice, une électrification de la voie entre Toulouse et Mazamet et une modernisation de la signalisation, toujours nécessaire pour permettre de développer le trafic. Ce scénario « minimaliste » amène à une estimation préliminaire de 669 millions d'euros aux conditions économiques de 2023, soit un milliard d'euros aux conditions économiques de 2034.
Nous sommes également saisis dans le cadre des études multimodales menées pour le projet de service express régional de Toulouse afin de réaliser des études préliminaires sur l'étoile de Toulouse, y compris sur cet axe ferroviaire.
Quel que soit le scénario étudié, il nécessite de lourds investissements compte tenu non seulement des fortes contraintes d'exploitation et de la caractéristique de l'infrastructure, mais également de la saturation ferroviaire de l'étoile de Toulouse, qui limite les capacités de développement de l'offre ferroviaire sur cet axe Toulouse-Castres-Mazamet. S'agissant de cette saturation du complexe ferroviaire de Toulouse, nous étudions un scénario de création d'une avant-gare à la hauteur de Balma, afin de permettre une desserte ferroviaire Balma-Castres-Mazamet avec un rabattement sur le réseau urbain Tisséo-métro.
S'agissant des capacités de développement du trafic ferroviaire, il existe effectivement des infrastructures logistiques sur cette ligne. Nous disposons d'une installation terminale active à Saint-Sulpice, mais aucun besoin n'a été manifesté. Du côté de Lavaur, une cour pour marchandises est classée C3, ce qui signifie qu'elle n'est plus entretenue et qu'elle n'est donc pas accessible immédiatement, mais qu'elle pourrait être remise en service.
À Castres, il existe une installation terminale active, mais dont la partie privative n'est pas aménagée. La cour pour marchandises de la gare de Castres est accessible immédiatement, mais elle est limitée en charge à l'essieu, et n'accepte que de la charge C, soit vingt tonnes à l'essieu au lieu d'une charge D, classique, à vingt-deux tonnes cinq à l'essieu.
Je vous confirme que cette ligne comporte un centre de transport combiné qui contient des voies classées C3 et qui nécessitent donc une reprise de la maintenance pour être exploitées. Nous n'avons enregistré aucune expression de besoin à ce jour.
Un développement satisfaisant du fret pourrait être réalisé, sous réserve de respecter la charge admissible sur la ligne. Nous n'avons enregistré aucune demande en ce sens depuis plusieurs années.

Je vous remercie, Madame Trevet, pour la bonne nouvelle de la réouverture de la ligne dès demain pour les usagers entre Toulouse et Mazamet.

Je vous remercie, Monsieur Gibelin et Madame Trevet, pour tous ces éléments qui seraient de nature à nous enchanter si nous disposions des financements pour réaliser tout à la fois le fret, la régénération, la modernisation et les dessertes fines, y compris entre Toulouse et Saint-Sulpice.
Ma préoccupation porte non seulement sur la réhabilitation de la ligne Toulouse-Castres et du train, mais également et surtout sur le choix de favoriser l'A69, choix que soutient d'ailleurs la région. En effet, si j'en crois les éléments communiqués par M. Gibelin, la recette moyenne du train entre Toulouse et Castres s'élève à 5,94 euros, à savoir significativement inférieure à ce qu'acquitteront les automobilistes sur le même tronçon s'ils empruntent l'autoroute, sans compter par ailleurs la prise en charge de 50 % par l'employeur pour les salariés et de 75 % pour les agents de la fonction publique, voire dans certains cas, la prise en charge totale par les employeurs.
Nous ne disposons d'aucune étude sérieuse et significative, réalisée préalablement à la décision de la construction de l'autoroute A69, par rapport à l'alternative que constitue le train, et à la valorisation de la modernisation de cette voie non seulement pour le transport de voyageurs, mais également pour le fret. Le trafic sera redirigé vers la route et non pas vers l'autoroute, au regard du coût, mais potentiellement vers une route départementale, dont la réhabilitation, la rénovation et l'entretien seront à la charge du conseil départemental et, donc, des contribuables. Force est de constater que les décisions prises à l'époque concernent des choix, peut-être subis par les élus locaux, qui manifestement avaient tous l'idée d'un aménagement de la RN126. Aujourd'hui ces choix sont assumés par l'ensemble de ces élus puisqu'ils sont tous favorables à l'A69 et c'est la présente commission d'enquête qui révèle de nombreux sujets qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été mis à jour, notamment le coût de l'aménagement de la voie ferrée.
Je souhaiterais vous interroger quant aux ambitions nourries pour la ligne Toulouse-Castres. Madame Trevet, je trouve des éléments qui m'intriguent dans l'annexe 2 de la description du calendrier prévisionnel de l'opération de réhabilitation et de l'aménagement des lignes de desserte fine. En page 36 et 37, le passage ainsi libellé : « de l'opération suppression PN et avec suppression simple du PN » comprend plusieurs éléments cabalistiques sur lesquels vous nous éclairerez, mais qui laisseraient entendre qu'une partie des voies serait retirée. Cela concernerait notamment les mouvements d'intersection alors que ceux-ci pourraient conduire au contraire à réaliser un aménagement permettant une augmentation du nombre de trains sur cette ligne. Pourriez-vous nous le confirmer ?
Monsieur Gibelin, pourriez-vous nous apporter des précisions quant aux ambitions que vous avez exprimées pour l'ensemble du réseau ferré français et tout particulièrement en Occitanie, notamment pour la liaison Toulouse-Castres au regard des dégâts prévisibles que produira l'autoroute A69, non seulement sur le plan environnemental, mais également sur le plan social ?
Les conclusions de l'assemblée plénière du 28 mars 2024, portant sur les travaux de la commission mobilité-infrastructures, réunie le 19 mars 2024, évoquent les efforts significatifs de la région, non seulement sur le service express régional métropolitain, mais également sur les lignes à desserte fine. Cependant, le contrat de plan État-région qui, semble-t-il, n'a pas encore été conclu, mentionne une ambition s'élevant à cent quarante-cinq millions d'euros pour l'ensemble des liens de desserte fine. Pourriez-vous nous indiquer quelle part de ce budget sera attribuée à la ligne Toulouse-Castres ?

La ligne ferroviaire dessert Toulouse, Saint-Sulpice, Lavaur, Castres et Mazamet. Il ne vous aura pas échappé que l'autoroute A69 passe, en ce qui concerne le Tarn, par Maurens-Scopont, Puylaurens, Saint-Germain-des-Prés, Soual, Saix et Castres. Les problématiques d'aménagement et de desserte de la ruralité sont donc différentes pour le tracé prévu pour l'autoroute A69 de celles rencontrées sur la ligne ferroviaire.
Madame Trevet, vous avez évoqué deux scenarii. Le premier, maximaliste, est estimé à 4 milliards d'euros à l'horizon de 2034 pour l'aménagement de la voie. Le deuxième, minimaliste, concerne le doublement de la voie et est évalué à un milliard d'euros à l'horizon de 2034. Je suppose que le coût pharaonique de ces réalisations aurait une incidence sur le prix des billets. Vous avez indiqué qu'entre Toulouse et Mazamet, le prix du billet s'élèverait à 23 euros. Dans le scénario de la réalisation de ces travaux et de ce projet minimaliste à un milliard d'euros, des calculs sur le coût du billet plein tarif ont-ils été réalisés ?
Je précise que je n'ai pas connaissance de l'annexe 2 mentionnée par Mme la rapporteure.
S'agissant des passages à niveau (PN), de nouveaux projets d'aménagement sont ouverts régulièrement parce que, sur le plan de l'exploitation ferroviaire, les passages à niveau représentent un enjeu très important pour la sécurité et la qualité de service. Nous étudions en permanence des scenarii non seulement d'aménagement des passages, afin d'améliorer la sécurité de leur exploitation, mais également de suppression de passages à niveau en accord avec les services locaux de l'État. Je ne connais pas exactement l'ensemble des études en cours sur des passages à niveau sur cette ligne Toulouse-Castres-Mazamet, mais je vous transmettrai cette information à l'issue de l'audition.
Je n'ai pas connaissance non plus de projets de retrait de voies ferrées sur le territoire compris entre Toulouse, Castres et Mazamet.
S'agissant des enjeux tarifaires, du point de vue du gestionnaire d'infrastructures, la tarification n'est pas liée à l'investissement réalisé dans le cadre du plan rail. Elle est liée à la classification de la ligne et celle-ci est en desserte fine du territoire. Les potentiels investissements ne produisent pas d'impact sur le péage. La tarification relève de l'autorité organisatrice.
Il me semble en effet important de préciser que le tracé de l'autoroute et celui de la voie ferroviaire sont différents. La carte est très claire en la matière.
S'agissant des actes de la région, il me semble important de les préciser à nouveau. Je les évoque d'autant plus librement qu'ils ont eu lieu sous la présidence de M. Martin Malvy et que je n'étais pas en fonction à l'époque. Il ne s'agit donc pas de mon travail personnel, mais bien de celui de la région.
Le plan rail de la région Midi-Pyrénées a été lancé en 2007, avec une participation de la région s'élevant à 400 millions d'euros, hors compétence de la région.
En 2009, dans le cadre de ce plan, a été réalisé le renouvellement de l'axe entre Saint-Sulpice et Mazamet pour un coût de 37 millions d'euros, dont 24 millions d'euros à la charge de la région. Le renouvellement des quais a coûté 1,3 millions d'euros à la région.
En 2010, Toulouse- Teissonnières a été financé à hauteur de 11 millions d'euros par la région. Puis le plan rail 2011-2012-2013 a permis de réaliser le doublement partiel de la voie entre Toulouse et Saint-Sulpice.
En 2019, le plan rail a été lancé sur cette partie-là avec 66 millions d'euros apportés par la région sur les 76 millions d'euros de budget. En 2020, le plan rail général a été lancé avec 800 millions d'euros annoncés par la région.
Ces éléments confirment que sur cette période, la région Midi-Pyrénées, devenue région Occitanie, a continué de manière régulière et significative à être très engagée financièrement sur les infrastructures ferroviaires. Cela me paraît important de le rappeler. Il ne s'agit pas de déclarations ou d'ambitions, mais bien de réalisations concrètes. Cela confirme également que la pérennité de la ligne Toulouse – Castres – Mazamet n'est pas remise en cause.
S'agissant du CPER, le volet mobilité n'est en effet pas encore signé. En revanche, l'assemblée plénière a voté un accord qui va se traduire par un temps de concertation et de présentation dans les treize départements de la région, à l'initiative des préfets de département. L'engagement fort de la région est manifeste et il sera réparti à hauteur de 20 % pour la route, le reste sera essentiellement dédié au transport ferroviaire et une partie beaucoup plus modeste au plan vélo. Telle est la répartition prévue par décision de la région.
Dans ce cadre, une part de budget sera attribuée aux lignes de desserte fine du territoire, ainsi que nous l'avions annoncé dans le cadre du plan rail élaboré avec l'État. 37,9 millions d'euros sont fléchés pour le quart Nord-Est, c'est-à-dire l'axe Figeac, Albi et Castres, pour la durée du CPER. Le plan rail a commencé en 2020 et il court sur dix ans alors que le CPER est établi pour la période comprise entre 2023 et 2027.
S'agissant du tarif, le lien entre le tarif et les choix d'investissements n'est pas immédiat. À l'inverse, proposer la gamme tarifaire la moins onéreuse de France correspond à un engagement financier de la région, qui estime que la gamme tarifaire permettra l'augmentation de la fréquentation. Actuellement, nous gagnons ce pari, mais nous ignorons ce qu'il en sera à l'avenir.
Il est évident que la question de la gamme tarifaire et du coût du transport ferroviaire renvoie à celle, très sensible, de la politique des péages. Dans ce cadre, la mission que les parlementaires assignent à SNCF Réseau est déterminante pour nous. Si la politique des péages pose ces derniers comme variable d'ajustement pour que SNCF Réseau se maintienne financièrement en équilibre, la situation sera complexe. Actuellement, l'augmentation du coût des péages contrarie notre ambition d'augmenter la fréquentation. Il n'est donc pas aisé de nous engager sur ce que serait le tarif. Toutefois, si celui-ci, acquitté par l'usager, reste limité, c'est au prix d'un engagement toujours plus important de la majorité régionale sur la politique de fonctionnement tarifaire.

J'adhère à vos propos relatifs à la politique tarifaire actuelle du Gouvernement, mais je souhaite revenir sur le sujet de l'A69.
J'ai précédemment mentionné le plan d'investissement sur la ligne de desserte fine de la SNCF, notamment sur l'axe ferroviaire du quart Nord-Est des lignes de desserte fine. Madame Trevet, ce document fait effectivement état d'une dépose de la voie d'évitement entre Labruguière et Villemur en 2026. Je suis surprise par cette perspective qui empêcherait toute possibilité de doublement de voies à moindre coût sur ces zones-là.
Monsieur Gibelin, quel est le montant précis de l'investissement prévu et fléché pour la ligne Toulouse-Castres ? En effet, vous avez évoqué un coût pour le quart Nord-Est, mais qui ne concerne pas uniquement le tronçon Toulouse-Castres, qui m'intéresse spécifiquement dans le cadre de cette commission d'enquête.
Madame Trevet, j'insiste également sur la mise à disposition de l'étude menée au moment de l'enquête, diligentée par la SNCF, sur l'aménagement de la ligne Toulouse-Castres. Si l'amélioration de la ligne ferroviaire entre Toulouse et Castres était réalisée, et on s'en féliciterait, ce serait au détriment de la circulation automobile sur l'autoroute, mais cela conduirait à une moindre circulation et à une augmentation des tarifs autoroutiers. C'est mathématique.
Je suis à la recherche de cette étude et je la réclame depuis le début des travaux de notre commission d'enquête. Je l'ai demandée au ministère ; je vous la demande. En effet, je n'imagine pas qu'une décision de telle ampleur et d'une telle importance, à tous niveaux, pour un territoire, n'ait pas été accompagnée d'une étude financière sérieuse, pour éclairer le ministre et les élus locaux, soit au moment de la prise de décision, soit avant la déclaration d'utilité publique. Cette étude nous permettrait de confirmer que l'ensemble des mobilités a été pris en compte dans l'analyse du bilan socioéconomique, et non pas uniquement en comparant l'autoroute à la route.
Dès lors, j'attends vraiment que vous recherchiez cette étude dans les archives de votre organisation. À défaut, cela signifierait que la décision de l'A69 a été prise par simple transfert de volumétrie de circulation entre la route nationale et l'autoroute, sans imaginer qu'il puisse exister d'autres mobilités et des transferts de mobilité vers le train, dont chacun sait depuis plus de quarante ans qu'il représente la mobilité la moins carbonée et la moins onéreuse dans les rapports qualité-prix et sécurité-prix pour les voyageurs.

Il serait fort agréable tout de même, Monsieur le président, Madame la rapporteure, de faire un tour de parole des députés parce qu'il est déjà près de 11 heures, et que vous allez clore la réunion. Nous ne pourrons donc pas poser l'ensemble de nos questions. Je suis également députée du Tarn et il me semble important que chacun puisse poser ses questions.

Vous avez la parole, Madame Érodi, et je vous rappelle qu' a priori, vous êtes la seule à poser des questions dans le cadre de cette visioconférence. Madame la rapporteure et moi-même nous efforçons de ne pas monopoliser la parole avec nos invités. Vous aurez tout loisir de poser l'ensemble de vos questions et nous pourrons déborder du temps imparti si nécessaire.

Je souhaiterais revenir sur quelques faits essentiels, pour la compréhension de toutes et tous, sur des faits anciens et des faits plus récents en lien avec les auditions que nous menons.
Premièrement, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), indiquait en 2009, dans le diaporama du débat public, avoir identifié des objectifs ambitieux et avoir procédé à des estimations de cadencement et de report modal, mais sans que quiconque ait pu prendre connaissance d'une éventuelle étude formelle à l'appui des conclusions.
Deuxièmement, l'ancien ministre des transport, Monsieur Dominique Perben, auditionné le 27 février 2024 devant notre commission, indiquait - je cite – « Je ne me rappelle pas, mais je peux me tromper, que l'on ait mis en balance à l'époque une opération routière par rapport à une opération ferroviaire » et d'ajouter, sans davantage en démontrer le fondement, « Je ne suis pas sûr qu'une étude comparative ait été faite sur la liaison ferroviaire. Si l'étude avait été faite, les chiffres auraient sans doute conduit à conclure qu'il valait mieux privilégier la liaison routière ».
Troisièmement, l'ancien président de région, auditionné également par notre commission le 27 février 2024, indiquait - je cite – « il y a eu une étude sur une solution alternative, étude d'ailleurs cofinancée par la région » et d'ajouter « les études que vous cherchez figurent probablement dans le dossier du débat public qu'il doit être possible de se procurer facilement », se référant peut-être à l'étude de la Dreal de 2009.
Il paraît donc surprenant que l'actuelle présidente de région ne fasse nulle part référence à cette étude et avance sur des options techniques très différentes de celles identifiées alors par la Dreal et la région et sur des chiffres très incohérents et fortement variables en l'espace de moins de deux mois. Une même solution technique concernant le doublement intégral de la ligne hors tunnel, la modernisation de la signalisation et l'électrification, est chiffrée le 20 janvier 2024 par Mme Carole Delga à 975 millions d'euros dans la réponse détaillée de la présidente publiée dans La Dépêche et dans un courrier adressé aux parlementaires, en réponse à nos questions alors que dans son courrier adressé aux députés d'Occitanie le 7 mars 2024, Mme Delga fait état de 2,7 milliards d'euros en 2023 et à plus de 4 milliards d'euros en 2034.
La présidente de la région indique en outre dans ce même courrier du 7 mars 2024 aux députés du groupe La France insoumise qu'elle appuie ses propos et déclarations sur des dires d'experts de SNCF Réseau, et non pas sur une quelconque étude circonstanciée.
La SNCF et l'État ne disposent-ils plus de l'étude de 2019 ou ne sont-ils pas en mesure de l'actualiser ? Cette étude existe-t-elle réellement ? J'aimerais obtenir une réponse claire et précise.
Je crois savoir que vous auditionnerez également la présidente de région, ce qui vous donnera l'occasion de lui poser directement la question.
L'État a bien évidemment mené une étude. La région n'en a pas la maîtrise et elle ne peut pas répondre en la matière. La réponse apportée par la présidente, Mme Carole Delga, est précise et contient des éléments chiffrés, construits en lien avec le gestionnaire d'infrastructures, à savoir SNCF Réseau, relatifs à une mise en conformité de la ligne en vue soit d'une électrification, soit d'un doublement et d'une augmentation de la capacité d'emport. Pour augmenter la capacité d'emport, notamment via des rames à deux niveaux, l'électrification est indispensable. Les chiffres évoqués par la présidente nous ont été communiqués par SNCF Réseau. Nous disposons désormais de suffisamment d'expérience avec SNCF Réseau pour confirmer que les chiffres avancés sont crédibles, et en outre cohérents avec d'autres marchés que nous concluons actuellement.
En ce qui concerne l'étude dont l'État aurait disposé, ce n'est évidemment pas le vice-président de la région qui peut vous répondre en la matière.
En revanche, je confirme que la région a cofinancé, avec le conseil départemental de la Haute-Garonne et les collectivités qui le souhaitaient, une étude alternative relative au tracé. Elle a été menée lorsque la question du tracé a été soulevée. Cette étude visait à vérifier s'il existait une alternative au tracé qui avait été retenu par le ministère pour l'autoroute A69.
Je n'ai aucune connaissance de l'étude mentionnée par Mme la rapporteure et je ne peux donc pas me prononcer à ce sujet.
En revanche, je vous précise que le chiffrage du doublement de la voie entre Toulouse et Saint-Sulpice a fait l'objet d'une étude à dires d'experts, réalisée dans le cadre des études multimodales, engagées depuis plusieurs années avec les partenaires du territoire.
S'agissant du doublement de la voie entre Saint-Sulpice et Mazamet, nous avons repris des ratios basés sur l'étude menée pour le tronçon entre Toulouse et Saint-Sulpice. Le chiffrage de l'électrification a été basé sur des ratios appliqués sur d'autres projets. Quant à la signalisation, nous avons appliqué des ratios issus d'une étude préliminaire réalisée sur le tronçon entre Teissonnières et Albi.
L'étude à dires d'experts est basée sur des retours d'expérience ou des études antérieures.

Monsieur Gibelin, quelle part des 145 millions d'euros est précisément destinée à la ligne Saint-Sulpice-Castres-Mazamet ?
Quelles sont les opérations financées actuellement prévues pour cette ligne dans le cadre du CPER ?
Pourquoi investir dans le déferrement, en 2026, des doubles voies en deux points de croisement sur cette ligne alors qu'elles seraient utiles pour un cadencement à la demi-heure de la ligne ? Ce cadencement prévu par le projet alternatif pourrait-il être envisagé et ce déferrement abandonné ?
Je vous confirme qu'en l'état actuel des discussions et de l'accord trouvé avec les services de l'État, les propositions sont classées par grandes enveloppes, y compris sur le plan géographique. J'ai indiqué précédemment qu'il s'agissait du quart Nord-Est parce que ce sont les estimations de travaux faites par le gestionnaire d'infrastructures. Je vous confirme donc les 37,9 millions d'euros pour le quart Nord-Est, qui inclut la ligne ferroviaire qui intéresse votre commission d'enquête. À ce stade, nous ne sommes pas encore entrés dans le détail ligne par ligne.
S'agissant du déferrement, il concerne des voies de service et non pas des voies en capacité d'assurer le doublement de la ligne. Le déferrement de ces voies de service n'impacte pas la desserte.
Je rassure l'ensemble des membres de la commission d'enquête sur le fait que nous ne diminuerons pas le réseau ferroviaire d'Occitanie, encore moins sur ce secteur-là. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes la région qui réouvre des lignes. Nous ne sommes pas dans une situation de régression de l'infrastructure ferroviaire. Elle est au contraire en développement, ce développement peut évidemment conduire à déferrer des voies de service qui ne sont plus utilisées, sans plus.
En effet, je vous confirme les propos du vice-président. Nous sommes amenés parfois à optimiser notre réseau de voies de service parce qu'il est de la responsabilité du gestionnaire d'infrastructures d'entretenir son système ferroviaire. Cependant, ces déferrements n'impactent absolument pas l'exploitation ferroviaire et son potentiel de développement. Nous travaillons sur le réseau des voies de service en tenant compte des besoins actuels et futurs.

Je m'interroge quant à l'avenir des technologies des trains testés sur cette ligne sur batterie hybride et des trains à hydrogène.
Je m'interroge également sur la nécessité du doublement de la voie sur tout le trajet, qui n'est pas indispensable quand il suffirait de multiplier les points de croisement.
Quant à la saturation de l'étoile de Toulouse, l'arrivée de la LGV ne va rien arranger ; elle sera au détriment des transports au quotidien puisque l'on privilégie une forme de transport pour les plus aisés.
La région Occitanie a cofinancé l'ensemble des expérimentations alternatives au diesel classique : le train hybride, le train à batterie, le train à hydrogène, et nous participons également aux expérimentations concernant l'huile végétale hydrotraitée (HVO 100), c'est-à-dire le diesel issu des huiles de friture qui a été utilisé encore dernièrement dans le cadre du train hybride. Nous sommes à la pointe de ces différentes expérimentations et restons prêts à en conduire d'autres.
Le train hybride a été expérimenté pendant trois mois et demi sur l'étoile toulousaine et il a circulé sur toutes les branches de l'étoile. Il s'agit d'un projet. Cependant, le train hybride, comme certains trains à batterie, nécessite l'électrification. Nous avons donc sollicité SNCF Réseau au plan national pour des études, qui ont d'ailleurs été pensées dans le cadre universitaire toulousain, relatives à l'électrification partielle et à l'électrification frugale.
Néanmoins, ces technologies modifieront la capacité de la ligne. Pour augmenter la capacité d'emport de la ligne, il est nécessaire de moderniser l'infrastructure, et notamment d'avoir une possibilité de doublement des voies.
Partout où cela s'avère réalisable, nous mettons en place de nouvelles technologies, mais il est indispensable que ces nouvelles technologies soient cohérentes. À titre d'exemple, nous mettons en place le train à hydrogène sur la région de Luchon à proximité d'une production d'hydrogène vert.
Le développement de la capacité d'emport de la ligne ne peut pas être envisagé sans avoir des travaux conséquents. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui des chiffres à dires d'experts. Il sera toujours possible d'étudier d'éventuelles évolutions, mais les chiffres annoncés aujourd'hui correspondent à la situation actuelle.
L'utilisation du train à batterie constitue une perspective assez récente. Nous étions précurseurs dans son expérimentation et nous avons mis longtemps à identifier de potentiels partenaires.
J'insiste sur le fait que la mise en œuvre de nouvelles technologies nécessite des infrastructures. Nous avons mené des actions sur cette ligne, mais il reste une partie importante sur laquelle il n'est pas possible d'envisager une augmentation de l'offre sans procéder à des travaux d'infrastructures très conséquents.

En effet, la mise en œuvre de nouvelles technologies n'est pas réalisable sans infrastructures, et encore moins avec une infrastructure telle que l'A69, option qui produira la plus grosse quantité de carbone. Un train, même diesel, permet une mobilité moins carbonée qu'une autoroute, qui par ailleurs artificialise des centaines d'hectares au détriment de la biodiversité et de l'exploitation agricole de terres extrêmement fertiles dans ce bassin alluvionnaire tarnais.
Afin de respecter l'objectif de souveraineté alimentaire, l'option du train aurait dû être la seule envisagée avec un aménagement partiel de la RN126. Je rappelle d'ailleurs qu'une partie de la RN126, payée par le contribuable, sera intégrée dans une autoroute privatisée. Le contribuable national a payé et l'usager paiera également.
Je refuse de souscrire aux choix opérés à l'époque et encore moins aux choix qui sont faits aujourd'hui.
Je ne désespère pas d'obtenir avant la fin des auditions de la commission d'enquête l'étude ferroviaire qui a été menée pour éclairer non seulement l'ensemble des partenaires du contrat, mais également les collectivités locales qui participent à hauteur de 23 millions d'euros, quant à la pertinence de la concession autoroutière au détriment d'un aménagement de la voie ferroviaire. Je lance cet appel auprès de la région parce que, bien qu'elle n'ait pas réalisé cette étude, je n'imagine pas que vous n'en ayez pas eu connaissance ou qu'elle ne vous ait pas été présentée au moment de faire un choix.
Je pense également que la SNCF a nécessairement été consultée avant la prise de décision.
J'ai à nouveau adressé un courrier au ministre de sorte que nous disposions de cette étude. Lors d'une commission d'enquête, chacun prête serment, et je ne comprends pas qu'ayant connaissance de cette étude, elle ne nous soit pas communiquée.
Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier non seulement pour la précision de vos propos, mais également pour votre implication sur la question du transport ferroviaire, dont je ne doute absolument pas.
Pour autant, force est de constater que, dans ce dossier, on n'a pas pris la précaution ou porté un intérêt suffisant à cette alternative ferroviaire et à un aménagement éventuellement partiel de cette ligne. Manifestement, les sommes qui seront allouées à l'avenir à cette ligne de desserte fine ne permettront pas un aménagement particulier. Pourtant nous savons que, sur ces territoires qui ne sont extrêmement riches, elle représenterait probablement la préférence de l'ensemble des usagers.
En outre, une ligne ferroviaire, malgré ses arrêts fréquents, ne peut pas être concurrencée par une autoroute, qui est une voie d'intérêt public national et qui n'a pas jamais eu vocation à faire de la desserte fine. Bien que les péages de cette autoroute se situent à des endroits différents des gares de cette voie ferrée, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de rejoindre ces péages ou la voie ferrée sans utiliser une voiture. En effet, dans ces territoires, il n'existe pas d'autre alternative qu'une voiture pour rejoindre la mobilité décarbonée que représente la voie ferrée.
Je vous saurais gré de compléter vos réponses avec des éléments plus précis dans le cadre du questionnaire que nous vous avons transmis.

Je vous remercie, Madame la rapporteure, pour ce plaidoyer anti-autoroute dont vous êtes coutumière.
Nos invités auront compris que, dans une ruralité comme la nôtre, on n'oppose pas les voies routières et ferroviaires. Je crois en effet qu'on fait mine de ne pas comprendre qu'en réalité, cette autoroute A69 propose une desserte totalement différente de la ligne ferroviaire actuelle.
Je vous remercie, Monsieur Gibelin et Madame Trevet pour la qualité de vos réponses.
*
La commission auditionne ensuite M. Jean Olivier, docteur en écologie, et M. Frédéric Manon, ancien conseiller municipal de Lacroisille et ancien conseiller de la communauté de communes Sor et Agout.

Nous poursuivons nos travaux consacrés aux hypothèses économiques et sociales qui ont justifié le choix de recourir à l'autoroute A69 pour améliorer la liaison entre Toulouse et Castres.
Monsieur Manon, vous êtes ancien conseiller municipal de Lacroisille (Tarn) et ancien conseiller de la communauté de communes Sor et Agout ; monsieur Jean Olivier, vous êtes docteur en écologie.
Je précise d'emblée que votre audition se tient à la demande de madame la rapporteure. Vous nous préciserez les raisons pour lesquelles elle apparaît aussi pertinente que celle d'autres élus, notamment des élus actuellement en place ou de tous ceux qui ont participé à la décision en faveur de l'autoroute A69.
Votre audition comporte un double objet. Monsieur Manon, vous avez exercé des mandats locaux et souhaitez nous présenter votre vision d'opposant à cet ouvrage. Monsieur Olivier, vous souhaitez nous présenter une étude sur l'alternative à l'A69 et sur la revitalisation de la liaison ferroviaire entre Toulouse et Castres.
J'espère, messieurs, que les études que vous allez nous présenter lors de cette audition se basent sur de solides arguments, car nous venons d'auditionner le vice-président de la région Occitanie en charge des transports et la directrice territoriale de la SNCF, dont je ne saurais remettre en cause les compétences et l'expérience de terrain.
Je me permets enfin de vous rappeler que nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête sur le montage économique et financier de l'autoroute A69 et qu'il ne s'agit pas, à travers cette commission, de remettre en question le chantier de l'A69, pas plus que la déclaration d'utilité publique (DUP).
Je rappelle que notre audition est publique et retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale.
Messieurs, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais préalablement vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire « je le jure ».
(Messieurs Jean Olivier et Frédéric Manon prêtent successivement serment)

Je vous remercie, messieurs, de votre présence devant cette commission d'enquête.
Notre cycle actuel d'auditions porte sur les hypothèses économiques et sociales ayant sous-tendu le projet de l'autoroute A69. Après avoir traité le volet environnemental, nous en sommes désormais à la question économique et sociale et terminerons ces auditions par le volet financier.
Au fil des auditions, les analyses socio-économiques nous paraissent de plus en plus fragiles, aux dires même d'experts du Commissariat général à l'investissement (CGI) qui ont relevé les éléments suivants :
– absence de lien automatique entre une infrastructure autoroutière et la prospérité d'un territoire ;
– altération des activités agricoles sur un bassin alluvionnaire extrêmement riche ;
– utilisation contestable de la notion d'enclavement, qui n'existe pas juridiquement ;
– surestimation du trafic routier, d'ores et déjà en baisse significative sur certaines portions de cette autoroute ;
– absence totale d'un effort pour définir avec intelligence un projet de transport répondant aux exigences de notre temps.
Sur ce dernier point, nous cherchons toujours, encore en vain, une étude démontrant que l'ensemble des mobilités – routières et ferroviaires – ont été retenues au moment de la décision d'une concession autoroutière. Si l'on privilégiait la mobilité ferroviaire à ce contrat de concession qui nous prive de notre domaine public, à savoir le réseau routier gratuit, il conviendrait de favoriser les investissements vers le transport ferroviaire au lieu de recourir à une concession autoroutière a fortiori de cinquante-cinq ans.
Nous aborderons logiquement la question du coût du péage pour les usagers. Le vice-président de la région Occitanie nous informait que le tarif moyen des déplacements en train était de 5,94 euros et le tarif moyen appliqué aux véhicules légers et aux poids lourds s'avèrera bien plus élevé sur l'A69. Cet aspect tarifaire recouvre la crainte que les niveaux attendus soient hors de proportion au regard du pouvoir d'achat des habitants du Tarn et de la Haute-Garonne.
J'ai proposé de vous auditionner, car l'un comme l'autre vous êtes inscrits dans une démarche d'opposition constructive à ce chantier, en l'étayant par des analyses et des propositions extrêmement sérieuses ; il m'a semblé important qu'elles puissent être entendues et exprimées dans le cadre de cette commission d'enquête.
Vous avez reçu des questionnaires, monsieur Manon sur l'économie du projet et monsieur Olivier sur votre étude sur l'alternative ferroviaire. Ces questionnaires sont relativement resserrés dans la mesure où vos propositions sont très précises. Je vous suggère, dans vos réponses, de les suivre. Ils ont été communiqués à l'ensemble des membres de la commission d'enquête, de sorte qu'elle fonctionne démocratiquement, ce qui a probablement manqué pour les décisions prises dans ce dossier.

Il me semble que l'exercice démocratique a bien eu lieu, ainsi qu'il est requis pour ce type de procédures. Je ne comprends pas qu'après les cinq cents réunions publiques qui se sont tenues, on puisse dire que le débat démocratique n'a pas eu lieu et que les décisions de financement n'ont pas été prises par l'ensemble des élus locaux. Vous avez décidé de mener ces auditions dont je dirais qu'elles sont à charge, par le choix d'auditionner des opposants à ce chantier.
Je crois néanmoins qu'il faut effectivement les entendre et j'aurai évidemment des questions à leur poser à la suite de leur exposé.
Pour soutenir mon propos, j'ai élaboré un support de présentation qui me permettra d'être aussi précis que possible.
J'entreprendrai de démontrer dans quelles mesures l'autoroute Castres-Toulouse ne m'apparaît pas comme la réponse la plus adaptée pour assurer une mobilité complète entre ces deux villes et à l'objectif de répondre aux besoins de déplacements des employés des entreprises et des particuliers. Pour ce faire, je commencerai par un simple rappel historique, étant probablement l'un des rares à avoir suivi le projet depuis le début.
En juillet 2004, le cabinet Infraplan a produit une étude, pour le compte des laboratoires Pierre Fabre, sur le mode de financement requis pour accélérer l'aménagement de la RN 126. La mise en concession de l'itinéraire figurait parmi plusieurs propositions.
En octobre 2006, le ministère chargé des Transports adressait un courrier à la direction régionale de l'équipement (DRE) de la région Occitanie afin de lancer les études d'avant-projet sommaire pour la réalisation d'une liaison à deux fois deux voies. La concession de l'autoroute était donc actée dès 2006.
En juillet 2007, la DRE d'Occitanie a souhaité lancer une concertation sur l'autoroute Castres-Toulouse. Cet élément est très important car l'autoroute Castres-Toulouse était l'un des maillons du futur grand contournement autoroutier de Toulouse, lequel devait faire l'objet d'un débat public à la fin de 2007.
La commission nationale du débat public (CNDP) est donc intervenue pour demander à l'État de différer cette concertation de sorte à ne pas interférer avec le débat public sur le grand contournement. La question centrale du grand contournement était de savoir s'il devait être réalisé à l'Est ou à l'Ouest et le fait d'introduire l'autoroute dans le débat public a forcément biaisé le débat quant à ce choix.
En janvier 2008 s'est déroulée la concertation sur le projet de l'A69. Le projet était initialement chiffré à 289 millions d'euros pour une distance de 36 kilomètres, sachant que sur un projet de cette nature, les seuils de saisine de la CNDP étaient fixés à 300 millions d'euros et à 40 kilomètres. C'était la première illustration de l'intention de l'État de court-circuiter le débat public pour amorcer le projet d'autoroute au plus vite.
En décembre 2008, l'État a tout de même été contraint de saisir la CNDP pour lancer un débat public, lequel s'est tenu de septembre 2009 à janvier 2010. À ce stade, la question n'était déjà plus celle d'un aménagement raisonné de l'itinéraire Castres-Toulouse via la route nationale, mais de savoir s'il convenait de financer une autoroute sur fonds publics ou sur fonds privés. Le débat public a également été biaisé sur cet aspect, si bien que la question de l'opportunité de l'ouvrage n'a jamais vraiment été posée.
En janvier 2013, la commission Mobilité 21 a classé le projet d'autoroute en priorité 1 dans le scénario 2, alors que quelques jours avant, le même projet était classé en priorité 2.
Le mois de décembre 2016 a vu l'enquête publique sur l'autoroute Castres-Toulouse, avec une audition de France Nature Environnement et du collectif RN126. Les éléments fournis lors de cette enquête publique n'ont pas été mentionnés dans son rapport, en particulier l'analyse de la valeur actualisée nette socio-économique du projet. Ainsi avons-nous été les seuls à avoir procédé à une telle étude.
J'en viens précisément aux questions de madame la rapporteure.
« Pourrez-vous résumer autant que possible, lors de votre audition, les critiques à l'encontre des gains de temps, de la surestimation des trafics et du bilan socio-économique que vous avez publié à l'encontre de l'A69 ? »
Je commencerai par les gains de temps. Selon le plan de réduction de la consommation énergétique initié par l'État en juin 2023, la limitation de la vitesse maximale sur autoroute serait a priori portée à 110 km/h. Le gain de temps serait alors de quatre minutes de Castres à Soual, de neuf minutes entre Soual et Verfeil et de deux minutes entre Verfeil et l'A68, soit un gain de temps total de quinze minutes, bien loin des trente-cinq minutes annoncées depuis le débat public de 2009.
Les vrais problèmes de circulation se concentrent entre la rocade de Castres et la déviation de Soual. À bien y réfléchir, le projet de l'A69 est finalement un projet autoroutier de 59 kilomètres, se chiffrant à près d'un demi-milliard d'euros, simplement pour régler un problème de mobilité en entrée et en sortie de Castres.
L'ensemble de ces éléments chiffrés figure dans le dossier rédigé par Atosca en réponse aux avis et recommandations de l'Autorité environnementale dans le cadre de l'enquête publique. Pour l'avoir vérifié, je précise ici que les temps et les distances de trajets retenus par Atosca sont exactement similaires aux données disponibles sur Google Maps.
Le report de trafic sur trois quarts de l'itinéraire a été estimé, par le maître d'ouvrage, sur une fourchette allant de 60 à 80 %. Autrement dit, six à huit véhicules sur dix se reporteraient de la route nationale vers l'autoroute, sachant que l'actuelle liaison entre Verfeil et Puylaurens ne pose aucun problème de fluidité. Un tel report apparaît irréaliste pour de nombreuses raisons : le coût du péage, les gains de temps bien plus faibles que ceux avancés et les emplacements des échangeurs de Soual et de Puylaurens, chacun n'étant doté que d'une entrée et d'une sortie.
De la même manière, le calcul de la valeur actualisée nette socio-économique a largement été surestimé, ce que l'Autorité environnementale et le CGI ont confirmé en indiquant que les gains de temps et les reports de trafics avaient effectivement été surestimés, mais aussi que le prix du péage avait, dès l'origine, été sous-évalué. Le dernier dossier d'Atosca, en réponse à l'Autorité environnementale, détaille les prix optimisés, en page 39. Sur la section allant de Verfeil au péage de L'Union, l'aller-retour serait facturé à 18 euros pour les non-abonnés, à 17 euros pour les abonnés et à 45 euros pour les poids lourds.
J'en viens à la deuxième question concernant le processus décisionnel : « Les défenseurs du projet de l'A69 estiment que les procédures de son instruction ont été strictement respectées, les différents recours à l'encontre des actes réglementaires ayant en outre été rejetés. Comment écarter un projet qui obéit au principe de légalité autrement qu'en opportunité, c'est-à-dire en considérant que les bases sur lesquelles il se fonde sont erronées ? Estimez-vous que c'est l'ensemble du processus décisionnel qu'il faudrait revoir pour les projets d'infrastructures ? »
Un projet d'infrastructure comme l'A69 s'inscrit dans un ensemble de territoires, en l'occurrence le Tarn et la Haute-Garonne. Les premiers concernés en sont les habitants, puisque le projet modifie leurs déplacements quotidiens, le projet de territoire, tout comme il modifie leur environnement. Certes, les habitants sont formellement consultés, au travers de débats et d'une enquête publique, sans toutefois qu'ils prennent part à la décision. L'État est à la fois porteur du projet et décideur ; en d'autres termes, il se fait juge et partie.
Mon rappel historique liminaire atteste bien du choix de l'État d'encourager au maximum le projet de l'A69. En tout état de cause, quand bien même le projet respecte le principe de légalité, comme le soutient monsieur le président Jean Terlier, il n'a pas été honnête eu égard au contenu du dossier et à la façon dont il a été instruit. Bien que le citoyen ait la possibilité de s'exprimer sur un projet concernant son territoire, l'État reste le décideur et in fine, le citoyen subit une décision qui lui échappe, d'où la situation de confrontation que nous vivons aujourd'hui. À mon sens, la seule issue possible, pour éviter ce type de confrontations sur de futurs dossiers, est de mettre en place des conventions citoyennes, avec intégration concrète des citoyens dans le processus de décision.
Votre question n° 3, madame la rapporteure, portait sur l'alternative ferroviaire à l'autoroute A69.
La carte de situation que j'ai présentée relève bien l'inadaptation de la desserte ferroviaire sur les secteurs de Puylaurens, Soual et Verfeil, car elle oblige à rejoindre la gare de Lavaur ou d'autres gares situées entre Lavaur et Castres. Le temps de trajet nécessaire pour rejoindre ces différentes gares joue manifestement en défaveur du ferroviaire.
Toutefois, l'autoroute a précisément été vendue comme étant le moyen d'améliorer les trajets domicile-travail entre Castres et Toulouse et à cet effet précis, la solution ferroviaire permettrait d'atteindre le centre de Castres beaucoup plus vite que l'itinéraire de l'autoroute tel que proposé. À mon sens, le mode ferroviaire est donc la meilleure des réponses possibles aux déplacements entre Castres et Toulouse.
Aussi l'intérêt du projet d'autoroute Castres-Toulouse apparaît-il fortement limité entre Soual et Verfeil, en particulier pour accéder au Sud et à l'Est de Toulouse ; l'itinéraire le plus pratique devant permettre d'accéder à une zone d'activité commerciale très importante et au complexe scientifique de Rangueil.
Votre dernière question, madame la rapporteure, était la suivante : « Vous avez indiqué vouloir vous exprimer sur les rétrocessions de Soual et de Puylaurens. Merci d'exposer vos critiques à la commission d'enquête. »
Les deux déviations rétrocédées deviendront payantes et ne joueront plus leur rôle de déviations, n'étant dotées que d'un accès (une entrée et une sortie). En conséquence, le report du trafic local se fera vers les centres-villages, provoquant une dégradation du cadre de vie des habitants concernés et une dégradation des temps de parcours pour les usagers de la RN126 qui n'emprunteront pas l'autoroute ; ladite dégradation pouvant s'estimer à plus de cinq, voire dix minutes par rapport à la situation actuelle.
Ce qui devrait être défendu, à mon sens, est le maintien des deux déviations par l'ajout d'une entrée et d'une sortie à chacune d'entre elles. Cela serait relativement simple, d'autant que les barrières de péage prévues sont des péages en flux libre (free-flow), c'est-à-dire qu'il serait très facile de différencier les utilisateurs qui utiliseront la déviation pour contourner les villages des utilisateurs ayant emprunté une section payante de l'autoroute. Le surcoût lié à l'ajout de ces deux péages en flux libre serait très faible au regard de celui de l'ouvrage complet. Au demeurant, si le concessionnaire n'était pas en capacité de financer ces deux barrières supplémentaires, les collectivités territoriales comme l'État pourraient tout à fait y procéder.
J'en viens à la question de la subvention d'équilibre.
Dans son dossier d'enquête publique, l'État écrivait qu'une « simulation de la subvention d'équilibre a toutefois été effectuée par l'État en tenant compte des dernières études et des éléments de coûts connus à ce jour, en fonction des conditions de financement observées actuellement sur le marché pour ce type d'opérations ». En d'autres termes, l'État a estimé que l'équilibre financier d'une opération de 460 millions d'euros impliquait une subvention d'équilibre de 220 millions d'euros.
Alors, je pose la question. Comment expliquer que le candidat NGE ne demande aucune subvention d'équilibre, alors que des experts de l'État estiment que l'équilibre financier ne peut être obtenu que par une subvention de 220 millions d'euros ? Comment parvient-il à financer lui-même ces 460 millions d'euros d'investissement ? Je ne comprends pas bien…

Monsieur Manon, je vous rappellerais peut-être le principe même d'une audition, à savoir que la personne auditionnée se doit de répondre aux questions et non d'en poser.
Très bien, j'ai malgré tout posé la question.
S'agissant de l'aménagement sur place de la RN126, j'ai vraiment entendu tout et n'importe quoi au cours des dix-sept dernières années, notamment qu'il n'existait aucune étude. La présidente de la région Occitanie a même affirmé que l'étude n'avait rien donné, ce qui est inexact. Une étude de l'aménagement sur place a bien été réalisée et financée par plus de vingt-trois collectivités territoriales, des communautés de communes, ainsi que par le conseil régional, et ce, pour un montant total de 60 000 euros sur une durée de trois mois. Le bureau d'études Burotec (BTP) avait été sélectionné pour la réaliser. Des agriculteurs avaient été consultés sur le choix des aménagements, un cahier des charges extrêmement argumenté avait été établi et afin de confirmer le coût de l'aménagement envisagé, soit 180 millions d'euros, une autre validation avait été sollicitée auprès d'un second bureau d'études.
Ainsi que cette étude l'a démontré, un aménagement sur place de la RN126 serait tout à fait adapté aux besoins de mobilité des entreprises et des particuliers. S'il ne s'agit, certes, que d'une étude préliminaire, ou d'un avant-projet sommaire, c'est précisément ce type d'études que l'État aurait dû mener depuis le début afin de se mettre en mesure de comparer les différentes solutions d'aménagement de façon objective.
S'agissant de l'opportunité du projet, mon sentiment est que, depuis 2007, on confond les besoins et les solutions. J'ai plusieurs fois entendu parler du besoin d'une infrastructure, mais c'est un peu « mettre la charrue avant les bœufs », si vous me pardonnez l'expression. On a d'abord besoin d'un projet de territoire et ensuite de trouver la solution permettant d'y répondre. Cette notion de projet de territoire a été la grande absente du débat jusqu'à ces dernières années ; c'est d'ailleurs moi-même qui l'ai introduite à la fois dans le débat public de 2009 et lors de l'enquête publique.
On peut regretter qu'aucun projet de territoire n'ait pu émerger à ce jour. Pour mémoire, à la suite de la déclaration d'utilité publique du projet d'autoroute, le Premier ministre d'alors, M. Jean Castex, avait désigné M. Maxime-Yasser Abdoulhoussen pour accompagner les élus et justement les aider à construire un projet de territoire s'adossant au projet d'autoroute. Il me paraît donc complètement aberrant que, dans cette affaire, on ait imposé une solution pour répondre à un projet qui, en réalité, n'existait pas. Si je faisais l'analogie avec mon métier, dans le domaine spatial, cela reviendrait à me demander d'envoyer un satellite dans l'espace sans en connaître préalablement la fonction ni l'utilité. Tel fut pourtant le cas de ce projet d'autoroute.
Toujours sur l'opportunité du projet, eu égard à la loi d'orientation des mobilités (LOM) et à la succession de différentes crises que nous subissons (géopolitiques, financières, sociales et environnementales), je comprends mal comment ce projet parvient à s'insérer dans un tel contexte. Je rappelle ici que la mise en service était prévue en 2013 et que le choix d'un projet d'autoroute a notamment été présenté comme le seul moyen d'accélérer cette mise en service. Nous sommes en 2024 et force est de constater que la mise en service ne surviendra finalement que douze ans plus tard.
En synthèse, je dirais que l'A69 est une solution inadaptée au contexte, présent et à venir et qu'il convient plutôt de penser des projets de territoire et d'adapter les solutions. La question de la mobilité, qui est un réel besoin, suppose des solutions multiples et rapidement reconfigurables en fonction du contexte. L'opportunité du projet n'a jamais été démontrée. De surcroît, la nature trompeuse de la démonstration de l'utilité publique a été confirmée par les expertises de l'Autorité environnementale et du Commissariat général à l'investissement.
D'aucuns pourraient considérer qu'en tant que simple citoyen, je ne suis pas en capacité de juger de la pertinence des études d'un maître d'ouvrage. Mon exposé ne s'appuie pourtant que sur des éléments factuels et autres informations répertoriées dans la documentation de l'État.
Je remercie madame la rapporteure, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, pour cette audition et de bien vouloir prendre le temps de considérer les éléments constituant une réelle alternative à cette autoroute.
Une autoroute à laquelle je m'oppose effectivement, monsieur Terlier, mais contrairement à ce que vous suggériez, je ne me place aucunement dans une logique négative. Je m'y oppose sur la base d'une proposition tangible pour le territoire et j'espère vous en convaincre, a fortiori parce que le député du territoire concerné que vous êtes devrait, à mon sens, s'emparer de ces éléments que je m'apprête à présenter.
Un projet d'aménagement de cette envergure se doit de tenir compte de l'existant et de proscrire le recours à l'artificialisation des terres dès lors qu'il est possible de l'éviter.
Quelles sont mes motivations ? En tant que docteur en écologie, j'ai travaillé sur les écosystèmes, les systèmes complexes et la biogéographie. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Toulouse pour des travaux essentiellement menés sur les enjeux de biodiversité, que ce soit en Amazonie ou sur nos territoires. La crise écologique majeure que nous vivons, marquée entre autres par la perte de biodiversité, se joue aussi sur nos territoires et j'ai l'intime conviction qu'on ne peut plus laisser faire. Voilà ce qui m'a amené à vouloir activement préserver la nature dans le Tarn, notamment dans la vallée de l'Agout, qui est un site Natura 2000.
Au-delà du changement climatique, la période actuelle se caractérise par de sérieux problèmes écologiques tels que l'érosion de la biodiversité, le manque de ressource en eau, les pertes de ressources diverses et l'exploitation des sols. De telles questions ne se posent pas qu'en Amazonie, où la moindre ouverture de route provoque la déforestation des zones alentours, mais se posent également pour le territoire du Tarn, à l'image de Saïx où la mésange bleue parvient difficilement à subsister dans les interstices qu'on lui accorde, toujours plus difficilement chaque jour d'ailleurs, et nous avons une importante responsabilité à cet égard.
Je tiens ici à rappeler le cadre juridique réel, qui me semble échapper à beaucoup, à savoir que la recherche d'une alternative est une obligation à la fois constitutionnelle et légale.
La Charte de l'environnement nous oblige à rechercher des alternatives et des évitements par la juste application des principes de prévention et de précaution. En d'autres termes, s'il est prouvé qu'une alternative n'a pas été sérieusement recherchée, un projet peut tout à fait être jugé illégal et une autoroute annulée et détruite.
La loi d'orientation des mobilités (LOM) nous oblige – et oblige les pouvoirs publics – à rechercher un rééquilibrage modal en vue de diminuer les problématiques de congestion routière, en privilégiant notamment le mode ferroviaire. Le code de l'environnement, quant à lui, nous interdit strictement de détruire des espèces protégées et leurs habitats naturels, à savoir les forêts et les prairies, y compris la parcelle de la Crem'Arbre, à Saïx, qui abritait la mésange bleue. Il en résulte que personne n'a le droit de détruire des espèces protégées et leurs habitats naturels, sous peine de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, voire sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende lorsque cette destruction s'est produite en bande organisée.
En effet, nous n'avons légalement pas le droit de détruire la nature, sauf lorsqu'un arrêté préfectoral l'autorise. Une telle dérogation ne peut être obtenue que sous des conditions très strictes, à commencer par celle de ne pas avoir eu d'autres choix. Il faut pouvoir démontrer une raison impérative d'intérêt public majeur, ce qui est différent, monsieur Terlier, de la déclaration d'utilité publique à laquelle vous vous référez.
La raison impérative d'intérêt public majeur implique de vérifier que les objectifs annoncés sont bien réunis, notamment les objectifs socioéconomiques et à cet égard, l'arrêté préfectoral évoque un désenclavement du bassin d'emploi de Castres-Mazamet. Il faut en outre prouver un gain de temps de trajet, une augmentation de la sécurité par kilomètre parcouru et considérer l'équité territoriale entre les villes moyennes de l'ex-Midi-Pyrénées. De surcroît, les alternatives doivent avoir été recherchées de manière sérieuse et sincère, notamment en recourant à une tierce expertise avant d'engager un quelconque tracé autoroutier.
C'est donc bien dans ce cadre juridique précis que les éléments que nous allons analyser doivent interroger.
La présidente de la région Occitanie, Mme Carole Delga, a systématiquement annoncé, dès lors que la solution ferroviaire lui a été suggérée, qu'il n'existait aucune alternative. Elle a d'ailleurs réitéré cette position d'octobre à décembre dernier et même lors de ses vœux de début d'année à l'occasion desquels elle déclarait : « Si l'A69 ne se fait pas, rien ne se fera. » Plus récemment, M. Jean-Luc Gibelin a tenu des propos similaires. Dans un courrier récent aux députés du groupe parlementaire La France insoumise, Mme Carole Delga a indiqué qu'elle « ne disposait pas d'études », à l'appui de ces affirmations.
Cela pose un réel problème, car le simple fait que la loi oblige à mener des études est censé en garantir l'existence et conséquemment, l'autorité administrative aurait dû s'assurer de cette existence. Pourquoi l'actuelle présidente de la région Occitanie semble-t-elle ne pas avoir connaissance des études ou ne s'y réfère-t-elle pas, ce que les pouvoirs publics seraient censés faire ?
En 2022, l'Autorité environnementale estimait que l'étude présentée par Atosca et validée par les pouvoirs publics avait omis de détailler les alternatives possibles à l'A69, en particulier ferroviaires ; des alternatives qui avaient donc été mal prises en compte, faute d'études – justement – sur le report multimodal du trafic par les transports en commun, dont le train.
Lors de son audition devant cette commission, M. Dominique Perben, ancien ministre des transports, déclarait la chose suivante : « Je ne suis pas sûr qu'une étude comparative ait été faite sur la liaison ferroviaire. Si l'étude avait été faite, les chiffres auraient sans doute conduit à conclure qu'il valait mieux privilégier la liaison routière. » M. Perben a ainsi entrepris de forger sa propre conclusion à partir d'études inexistantes. M. Martin Malvy, ancien président de la région Midi-Pyrénées, avait quant à lui un meilleur souvenir des choses, puisqu'il vous a, lui, répondu de la manière suivante : « Il y a eu une étude sur une solution alternative et cette étude a d'ailleurs été cofinancée par la région. »
Nous nous sommes donc interrogés, en tant que citoyens et en vertu de la Constitution obligeant chacun d'entre nous à rechercher sérieusement toute alternative et toute possibilité d'éviter la destruction de la nature.
Nous avons ainsi vérifié plusieurs des critères justifiant du projet : le désenclavement, le gain de temps, l'augmentation de la sécurité et l'équité territoriale entre les villes moyennes.
Le désenclavement ou les flux de circulation ne concernent pas uniquement l'axe Castres-Toulouse. En 2009, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) recensait un trafic de 5 200 véhicules par jour entre Castres et Toulouse (dans les deux sens) et de 3 800 véhicules par jour entre Castres, Mazamet et Revel. On avance aujourd'hui un chiffre de 8 000 véhicules par jour et il serait particulièrement nécessaire de vérifier s'il ne résulte pas d'une agrégation de tous ces chiffres, sachant que l'autoroute ne desservira pas Revel. De plus, la dernière enquête ménages déplacements nous informe que les mobilités diminuent et qu'il existe un report vers le multimodal.
En somme, on ne connaît pas les chiffres réels, ce qui fait partie des difficultés de ce dossier et des possibles points d'illégalité.
L'autoroute a soi-disant vocation à désenclaver. Si on considère le bassin d'emploi de Castres-Mazamet, la ville de Mazamet n'apparaît tout simplement pas sur les cartes de l'autoroute, ce qui en dit long sur la considération dudit bassin. Il apparaît également que seuls trois échangeurs sont censés desservir ce territoire, alors que la voie ferrée existante propose d'ores et déjà quatre gares, dont une à Mazamet, des gares aménageables supplémentaires et autres haltes ferroviaires et qu'il existe des dessertes par des cars des lignes intermodales d'Occitanie (Lio). Si la voie ferrée ne passe pas par Puylaurens, des connexions de cars Lio sont tout à fait possibles.
Dans le Sud du Tarn et dans le bassin de Castres-Mazamet, il existe en réalité une multitude de trajets possibles vers l'agglomération toulousaine. On ne se rend pas uniquement dans le Nord-Est de Toulouse ou vers le péage autoroutier – et embouteillé – de L'Union, on peut aussi se diriger vers le Sud-Est de Toulouse, vers le pôle scientifique, et à d'autres endroits de l'agglomération. Il convient de réfléchir à la mobilité sur un territoire de manière beaucoup plus globale.
Les études sur les gains de temps nous disent que les temps de parcours routiers existants oscillent entre une heure dix et une heure dix-huit.
L'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale nous ment, purement et simplement, lorsqu'il annonce une moyenne d'une heure quinze de temps de trajet en train, alors qu'il varie entre une heure sept à une heure dix – ce qu'il faudrait encore pondérer par le fait que la ligne ferroviaire n'est pas utilisée au maximum de son potentiel. En réalité, les temps de parcours en train sont d'ores et déjà inférieurs aux temps actuels de parcours routiers. Le débat est biaisé sur ce point. Nous avons d'ailleurs réalisé une projection de circulation sur un train rapide Castres-Toulouse, par le premier TGV ou par le premier train Intercités vers Marseille ou Bordeaux. En ajoutant un train, il serait possible de faire le trajet en une heure et une minute le matin, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'améliorer la voie.
De plus, chacun sait parfaitement que le boulevard périphérique toulousain est en cours de saturation complète et que les projections à 2030 prévoient des embouteillages très importants.
Début janvier, la région Occitanie – avec Vinci – annonçait son intention de tester des navettes de bus sur l'autoroute A68 afin de relier le centre de Toulouse et de décongestionner le périphérique toulousain. Dans cette solution, l'autoroute irait jusqu'à Verfeil ou Gragnague, les automobilistes devraient alors laisser leurs voitures et prendre des cars Lio pour accéder à l'agglomération toulousaine. Plutôt que de changer de mode de transport en cours de route, il me semble préférable de prendre directement un car Lio depuis Castres ou Puylaurens, ou un train depuis Mazamet, Castres ou toutes les gares desservies.
Le gain de temps n'est clairement pas démontré. Les transports en commun, par les voies de bus en site propre ou par le train, sont clairement plus efficaces et plus fiables en termes d'horaires.
S'agissant de l'accidentologie et de la sécurité, selon les chiffres de 2022, la France a déploré 188 décès sur les autoroutes concédées et 64 décès par le train, soit une mortalité par accident trois fois inférieure par le train. De ce point de vue, le train présente un net avantage sur l'autoroute et il est fort dommageable que cette option n'ait pas été recherchée beaucoup plus sérieusement.
S'agissant de l'équité territoriale, je dois dire que la logique m'échappe. Il existe aujourd'hui une autoroute pour Montauban et vingt-neuf allers-retours en train par jour sur ce trajet, ainsi qu'une autoroute pour Albi quasiment gratuite (hormis le péage de L'Union) et dix-huit allers-retours en train par jour. Les trajets vers Montauban et Albi sont facturés à 5 euros, car ils sont en dessous du plafond fixé à 80 kilomètres. L'autoroute pour Castres, quant à elle, sera facturée à 10 euros minimum, car elle se situe un peu au-delà des 80 kilomètres – plafond que la région Occitanie pourrait légèrement moduler.
Avec les mêmes budgets, il serait possible de développer le train de manière plus efficace et cadencée sur des niveaux similaires à Montauban, voire davantage, ainsi qu'une route nationale gratuite ; cette dernière n'étant aucunement congestionnée, ainsi que l'indiquait très justement monsieur Manon. C'est juste une question de temps pour ceux qui veulent aller vite, mais ces derniers pourraient tout à fait prendre le train.
Sur le trajet Albi-Carmaux (dix-huit trajets par jour, à 5 euros), outre une meilleure desserte, on observe ces dernières années une augmentation de la fréquentation du train. Sur Castres-Mazamet, on observe logiquement une baisse de fréquentation de la ligne ferroviaire depuis dix ans.
La gare de Castres est la seule gare de l'ex-Midi-Pyrénées ayant enregistré une baisse de fréquentation entre 2015 et 2022. Quelle en est la cause ? Les habitants de Castres sont-ils moins enclins à prendre le train ou cette ligne a-t-elle manifestement été délaissée ?
Un premier élément d'explication pourrait tenir au fait que le plan rail (2009-2013) avait entrepris de refaire la voie et le ballast de la ligne Castres-Mazamet, mais sans rénover sa signalisation, après quoi la voie a été abandonnée. De plus, alors qu'elle devait se poursuivre jusqu'à Carmaux, la ligne s'est finalement arrêtée à Lavaur. Pourtant, les agglomérations d'Albi-Carmaux et de Castres-Mazamet sont démographiquement et économiquement très équivalentes. En ne faisant les travaux qu'à moitié, on a donc laissé la voie ferrée « au milieu du gué », si bien qu'elle se trouve aujourd'hui complètement sous-utilisée, malgré son grand potentiel. La voie permet aux trains de rouler à 160 km/h en ligne droite, mais ils ne roulent qu'aujourd'hui qu'autour de 110 km/h, justement parce qu'elle a été délaissée.
De surcroît, au moment où la présidente de la région Occitanie nous disait qu'il n'était pas possible d'agir au motif que la voie était unique, nous avons découvert un document révélant l'intention de la SNCF et de la région de procéder, dès 2026, à plusieurs déferrements dans les gares de Labruguière et de Vielmur-sur-Agout. On s'apprête donc à investir dans le retrait de doubles voies ferrées, lesquelles seraient pourtant requises pour un cadencement des trains à la demi-heure.
De manière analogue, dans le projet d'aménagement ferroviaire du Nord de Toulouse pour la LGV Bordeaux-Toulouse, il se trouve que la voie actuellement consacrée intégralement au train du bloc Nord-Est (Tarn, Aveyron, Lot, Cantal et Puy-de-Dôme) sera en partie mutualisée pour les trains arrivant de Montauban. Il y a là quelque chose de proprement anormal. Pour faire venir la LGV, on entreprend de supprimer une moitié des deux voies existantes sur le bloc Nord-Est, ce qui abaissera les capacités de cadencement des trains, notamment celui des trains de proximité pour Toulouse-Castres-Mazamet, ainsi que les lignes Albi-Carmaux-Rodez, Figeac-Capdenac, Aurillac et Clermont-Ferrand.
Parallèlement, la ligne 768 de cars Lio dessert tout l'Ouest de l'agglomération de Castres-Mazamet, au départ de Mazamet pour un terminus à Sémalens. Or la gare de Sémalens est fermée depuis quinze ans. Le car continue pourtant de s'arrêter à Sémalens, sans poursuivre quatre kilomètres plus loin, jusqu'à Vielmur-sur-Agout où une gare SNCF assure actuellement douze allers-retours journaliers. Ce dernier exemple montre que des initiatives très simples pourraient être envisagées pour maximiser la solution ferroviaire pour les habitants du territoire, ce que la région Occitanie a parfaitement les moyens de faire.
Dans le même ordre d'idées, notre étude a mis en lumière de nombreuses incohérences sur les horaires de correspondances entre les trains et les cars Lio, souvent à quelques minutes près. Sans prétendre qu'un tel cumul des incohérences procède d'une quelconque intentionnalité, leur conjonction avec la volonté ferme de bâtir une autoroute a de quoi interroger.
Une étude tangible ne peut se résumer aux dires d'experts et à quelques annonces de chiffres. Étant donné la particularité du transport ferroviaire, il est essentiel de travailler à partir de graphiques horaires tenant compte des différentes vitesses et normes horaires. C'est ainsi que nous avons procédé à l'aide de M. Benoît Durand, expert ferroviaire citoyen.
Pour nous aider à étayer la soutenabilité de l'alternative ferroviaire, M. Karim Latini, paysagiste et urbaniste, a mis en forme et projeté nos éléments techniques pour le volet ferroviaire alternatif. Un expert agréé par le ministère de la justice, souhaitant rester anonyme à ce stade, mais se tenant à disposition de la commission d'enquête et/ou des tribunau, nous a confirmé la justesse des ordres de grandeur de prix que nous avions retenus. Plus récemment, nous avons entrepris de consulter M. Daniel Émery, consultant spécialiste en chemins de fer, ancien enseignant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et reconnu au niveau européen, qui a validé nos options techniques.
C'est ainsi que nous avons élaboré une solution alternative et viable, prête à remplacer cette autoroute A69, dont les tribunaux ne manqueront pas de prononcer l'annulation.
Dans l'immédiat et sans qu'aucun aménagement ne soit nécessaire, nous proposons donc d'ajouter quatre trains allers-retours : un le matin, permettant aux habitants du territoire de prendre le premier train Intercités ou le premier TGV pour Paris, un train l'après-midi et deux trains le soir. Cette première proposition fait d'ailleurs écho aux propos du 24 janvier dernier de Mme Carole Delga qui indiquait être prête à expérimenter dès cette année des amplitudes horaires plus importantes. Sachant que cette ligne ne comporte ni TGV, ni train Intercités, ni fret, la SNCF pourrait parfaitement opter pour ces quatre trains supplémentaires. Nous nous sommes d'ores et déjà assurés, par des graphiques horaires, de la parfaite faisabilité de l'opération.
Un nouveau cadencement des trains à la demi-heure impliquerait de mettre en place la signalisation idoine, qui avait donc été déprogrammée sur cette voie précise, à la différence de la plupart des autres lignes du Midi-Pyrénées. Tout le monde s'accorde sur un coût avoisinant 30 millions d'euros, à l'exception peut-être de la région Occitanie qui parlait, le 20 janvier, de 43 millions d'euros, puis de 84 millions d'euros le 7 mars dernier. D'autres études de la SNCF, sur des régions ayant engagé des travaux similaires, confirment néanmoins un coût n'excédant pas quelques dizaines de millions d'euros.
L'alternative que nous proposons impliquerait en outre un relèvement de la vitesse que nous proposons à 140 km/h en ligne droite, sachant que la voie supporte une vitesse maximale de 160 km/h. Pour ce faire, il suffirait de modifier la signalétique à l'abord des courbes et de déplacer les pédales de déclenchement des passages à niveau, et ce, pour un coût de l'ordre de 1,2 million d'euros, montant qui reste à affiner.
Enfin, une nouvelle gare de croisement serait à définir pour que les trains puissent se croiser toutes les demi-heures, contre une heure cinq actuellement. Puisque cette gare doit se situer à la moitié du temps de parcours, nous proposons qu'elle se situe quelque part entre Serviès et Guitalens-L'Albarède, où une gare serait particulièrement bienvenue et facile à installer, pour un coût allant de 5 à 7 millions d'euros. Cette nouvelle gare de croisement supposerait aussi de renoncer au déferrement de la double voie de Labruguière, nécessaire au cadencement à la demi-heure des trains jusqu'à Mazamet et potentiellement de la gare de Vielmur-sur-Agout qui, elle, servirait de gare de croisement de secours ou pour un possible cadencement au quart d'heure au sein du bassin d'emploi de Castres-Mazamet.
En conséquence, pour un investissement de 40 millions d'euros de coûts d'infrastructures, il serait possible d'obtenir un cadencement des trains à la demi-heure. Un tel cadencement, pour une voie ferrée de six mètres de large et une capacité de 200 personnes par train, suffirait à transporter la totalité des usagers utilisant encore leur voiture pour faire le trajet entre Castres, Mazamet et Toulouse.
À cet investissement doit s'ajouter le coût de l'achat de trains supplémentaires. Nous proposons cinq trains supplémentaires à 8 millions d'euros pièce, soit environ 40 millions d'euros pour se doter de trains Régiolis, hybrides, diesel et électrique.
Il conviendra enfin de procéder aux recrutements associés, sujet relevant de la convention d'exploitation entre la région Occitanie et la SNCF, ce qui devrait être aisément envisageable du fait que la hausse du nombre d'usagers générera une augmentation des recettes.
Notre étude citoyenne, réalisée avec Benoît Durand et expertisée par Daniel Émery confirme donc la possibilité d'un cadencement à la demi-heure en ajoutant une gare de croisement. Nous serions là sur une solution acceptable, qui équivaudrait à ce qui se pratique dans la région, notamment sur la ligne Toulouse-Foix.
Pour un temps de trajet d'une heure, un cadencement à la demi-heure inciterait clairement à choisir le train plutôt que la voiture, ce qui serait possible dès 2030.
Aussi, une étude comparable nous laisse à penser que la région Occitanie a mal été informée par la SNCF. En effet, entre 2018 et 2021, la région Pays de la Loire avait procédé au réaménagement de ligne Clisson-Cholet, et ce pour 46 millions d'euros de coûts d'infrastructures et sachant qu'à la différence du cas qui nous occupe, il n'avait pas été nécessaire de refaire le ballast des voies. Il n'est pas donc impossible que nos estimations soient finalement assez hautes, mais nous avons tenu à inclure de réelles marges de prudence. La région Occitanie pourrait confirmer ces éléments auprès de celle des Pays de la Loire, à savoir que des travaux comparables se chiffreraient à 46 millions d'euros, très inférieurs au milliard d'euros annoncé par la SCNF à Mme Carole Delga.
Nos travaux se basent donc sur de solides éléments techniques.
Je récapitule les chiffres : 7 à 10 millions d'euros pour les gares, 30 millions d'euros pour la signalisation et 40 millions d'euros d'achat de train, soit un total de 80 millions d'euros pour une voie non électrifiée, en incluant les infrastructures et les trains. Comparativement, dans un courrier au groupe parlementaire La France insoumise, la région Occitanie parlait de 1,14 milliard d'euros en janvier et désormais de 2,7 milliards d'euros et 4 milliards d'euros en euros courants. À ce niveau d'écarts, il ne s'agit même plus d'exagérations de montants, mais d'un tout autre univers.
La question de l'électrification a enfin été présentée comme un point bloquant. Pourtant, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) nous indique qu'un trajet en train ou TER, même à base de diesel, émet moins d'équivalents CO2 qu'un trajet en voiture, même électrique. Le train reste donc le moyen de transport le plus écologique, sans commune mesure.
L'électrification peut être un plus, sans être une nécessité. Il est déjà possible de se doter d'un transport plus écologique en cadençant la ligne. L'introduction de nouveaux trains hybrides à batterie pourrait se faire en électrifiant la voie entre Saint-Sulpice, Castres et Mazamet, voire jusqu'à Albi et Carmaux, soit une vingtaine de kilomètres sans caténaire électrique et sans qu'il soit nécessaire d'électrifier la voie en sortie de Matabiau, surtout sous les tunnels de Montastruc-la-Conseillère et de Castelmaurou, qui pourraient effectivement poser problème.
Le 14 décembre dernier, Mme Carole Delga nous affirmait qu'il serait « inenvisageable d'utiliser le train, parce que la voie n'est pas électrifiée » et deux jours après, le 16 décembre, la région Occitanie et SNCF Réseau inauguraient le premier train de France hybride, précisément sur la ligne Toulouse-Castres-Mazamet. Les incohérences sont manifestes. Aujourd'hui, toutes les solutions techniques existent et leur mise en œuvre ne dépend que d'une volonté politique.
Dans le cadre du contrat de plan État-région (CPER), la région Occitanie s'apprête à signer le volet mobilité 2022-2027. Il suffirait d'inscrire 40 millions d'euros dans ce CPER, qui compte près de 1 milliard d'euros d'investissement, pour que, dès les prochaines années, les habitants de la zone Castres-Mazamet bénéficient de trains cadencés à la demi-heure et ainsi de transports modernes, d'avenir et écologiques.
La délibération du conseil régional du 28 mars dernier nous informe cependant que les investissements, pour l'ensemble des lignes de dessertes fines du territoire de l'Occitanie, ne s'élèveraient qu'à 145 millions d'euros. De là, on peut supposer que la partie Saint-Sulpice/Castres/Mazamet ne sera gréée que de quelques centaines de milliers d'euros, soit l'équivalent de la somme prévue pour déferrer les voies, et non pour améliorer la desserte.
Mon avis est que les députés du territoire doivent absolument se saisir de la question, mesurer les enjeux et exiger que leurs lignes soient bien mieux considérées par le CPER.
En conclusion, je dirais que l'alternative ferroviaire est bien réelle, tangible, nettement moins délétère pour l'environnement et nettement moins émettrice de gaz à effet de serre. C'est pourquoi l'alternative ferroviaire me semble présenter tous les avantages.
À celles et ceux qui s'inquiéteraient de savoir ce qu'il adviendrait de l'actuel chantier de l'autoroute, je réponds que plusieurs experts m'ont confirmé l'entière possibilité d'installer des voies ferrées en lieu et place des plateformes préparées pour l'autoroute, y compris sur le viaduc de l'Agout et pour une double voie en sortie de l'agglomération de Castres.
Rien ne pourra évidemment se faire sans que le tribunal administratif ne prononce l'annulation du projet de l'A69, ce qui me semblerait parfaitement logique au vu des éléments considérés aujourd'hui.
J'en ai terminé de ma présentation et me tiens disponible pour répondre à vos questions.

Pour ma part, je ne crois pas utile de vous poser de questions.
Alors même que cette commission vient d'auditionner le vice-président de la région Occitanie et la directrice territoriale de la SNCF, le choix de placer vos auditions sur le même piédestal me semble déraisonnable. Je parlais d'un risque de dévoiement de cette commission d'enquête et je crois que les auditions qui sont les vôtres en sont l'exemple. À cet égard, je vous remercie d'avoir confirmé que vous étiez des militants anti-autoroute.
Je me permets à nouveau de rappeler que cette commission d'enquête a pour objet l'analyse du montage juridique et financier de l'autoroute A69 et pas autre chose et vous venez, messieurs, de faire la démonstration d'une déviance certaine de ces auditions.
Je cède la parole à madame la rapporteure et aux autres collègues qui voudront bien se manifester.

Je remercie messieurs Olivier et Manon pour leurs travaux extrêmement riches, denses et très utiles pour la bonne compréhension de ce dossier.
Avant d'en venir à mes questions, il me semble essentiel de rappeler les termes de la proposition de résolution n° 1814 portant création de cette commission d'enquête sur le projet d'autoroute A69. « Cette commission d'enquête est chargée, d'une part d'enquêter sur les liens existants entre la société Atosca et les décideurs politiques français, ainsi que sur les soutiens directs et indirects accordés par le gouvernement français aux entreprises impliquées dans ce projet et d'autre part, sur les paramètres juridiques et financiers du projet, singulièrement du contrat de concession. »
Messieurs, vos travaux très documentés ont assurément permis d'éclairer les membres de la commission d'enquête, ainsi que l'ensemble des personnes intéressées par ce dossier de l'A69.
Monsieur Manon, vous évoquiez la privatisation de la déviation Soual-Puylaurens, qui avait été financée par les deniers publics et qui sera finalement intégrée à l'autoroute, en suggérant qu'elle perdrait justement sa fonction de déviation. De quelle manière cette fonction sera-t-elle comblée ? Vous avez proposé le maintien de la gratuité pour cette déviation, étant observé que les conditions tarifaires ont déjà été négociées entre l'État et Atosca dans le cadre du contrat de concession. Votre proposition impliquerait donc une demande reconventionnelle ne s'intégrant pas nécessairement à l'équilibre financier du contrat.
Par ailleurs, je vous remercie de votre question des plus avisées sur la subvention d'équilibre de 220 millions d'euros, à comparer aux 23 millions de concours public prévus par la convention de concession, car je me la suis également posée. Il est à prévoir que le troisième volet de cette commission, le volet financier, nous permettra d'y répondre.
Vous nous faisiez part de votre sentiment que la valeur actualisée nette socio-économique (VAN-SE) avait été surestimée, corroborant ainsi les propos des experts du CGI l'ayant évaluée à 91 millions d'euros, comparativement aux 508 millions d'euros avancés par Atosca.
Il faut logiquement en déduire que la VAN-SE s'en trouverait nettement fragilisée. Le sujet reste pendant, car à la suite de nouveaux calculs, Atosca a depuis présenté un dossier où la VAN-SE est passée à 788 millions d'euros.
Enfin, je vous précise avoir demandé au ministère chargé des transports communication de l'étude sur la RN126, dont vous avez fait état, sans avoir eu aucun retour à ce jour, ce qui m'a récemment forcée à renouveler la demande.
Monsieur Olivier, eu égard au niveau de détail particulièrement élevé des éléments présentés, je crois nécessaire, comme le proposait d'ailleurs monsieur Terlier, de demander une nouvelle audition de M. Gibelin ou a minima une comparaison entre votre étude et celle qui nous sera communiquée par la SNCF.
Notre objectif est évidemment la préservation des espaces agricoles, de la santé et des perspectives d'avenir de ce territoire, en termes de qualité de vie et de désenclavement, pour reprendre le terme employé dans l'ensemble des documents.

Mme Arrighi a très clairement posé les questions qui me paraissaient en suspens. Je remercie à mon tour messieurs Olivier et Manon pour leurs exposés particulièrement riches, construits et documentés.
Je dirais simplement qu'il me paraît essentiel de réentendre M. Gibelin et, à la lumière de cette nouvelle audition, d'entendre également à nouveau messieurs Olivier et Manon. La présente audition, illustrée de nombreux graphiques, a eu le mérite essentiel d'éclairer les non-Tarnais, qui écoutent ces auditions depuis le début, pour avoir une juste idée de ce qui a été fait correctement ou non. Cette audition me semble particulièrement importante pour l'ensemble de nos concitoyens et pour éclairer les députés de cette commission d'enquête.

Je devrais peut-être déduire, de cette demande de nouvelles auditions, à une plus grande expertise de monsieur Olivier par rapport à l'expérience professionelle de la directrice territoriale de la SNCF, que nous venons d'auditionner et qui nous a dit, monsieur, tout le contraire de ce que vous affirmez. Je comprends aussi que monsieur Manon aurait une plus grande légitimité que l'ensemble des élus qui se sont prononcés, notamment de la région Occitanie, de la communauté de communautés de Sor et Agout et du département du Tarn, pour ne citer que ceux-ci.
Je comprends également que l'un et l'autre ne tenez pas compte de l'existence d'une déclaration d'utilité publique, comme du fait que les questions de solutions alternatives et des gains de temps ont évidemment été tranchées.
Si j'entends bien votre souhait de réinterroger l'utilité publique du projet, tel ne sera évidemment pas le cas.
Vous connaissez désormais mon sentiment quant aux expertises qui sont les vôtres et je n'en dirai pas davantage sur ce que je considère être – et je réitère – un dévoiement de cette commission d'enquête.
J'invite donc messieurs Manon et Olivier à des réponses les plus concises possible.
Je répondrai donc à madame la rapporteure sur la question des déviations de Soual et de Puylaurens.
À l'heure actuelle, il n'est pas difficile de contourner les centres-villages du fait qu'il existe une entrée et une sortie à chaque extrémité des deux déviations. À la suite du projet de l'A69, il ne subsistera plus qu'une entrée et une sortie. Ainsi, ceux qui entreront par la déviation de Soual ne pourront sortir que par Puylaurens et inversement (ou de l'autre côté de l'itinéraire). En conséquence, elles ne joueront plus leur rôle de déviations des centres-villages.
Ma proposition est de maintenir les deux déviations de Soual et de Puylaurens dans le domaine public et de placer à leurs extrémités des déviations en péage en flux libre, ce qui permettra aisément de différencier les utilisateurs de l'autoroute des utilisateurs qui n'emprunteront que ces déviations. J'ajoute que cela aura un intérêt pour l'ensemble des reports de trafic sur le réseau secondaire ; reports dont l'ensemble des élus de la communauté de communes Sor et Agout se sont d'ailleurs plaints lorsqu'ils ont appris l'insertion de ces deux déviations dans le projet d'autoroute. Je ne comprends pas la mise à l'écart de cette solution des plus simples pour un coût relativement faible, par rapport au demi-milliard d'euros du projet, dans la mesure où Atosca propose des barrières de péage en flux libre.
S'agissant de la VAN-SE, je ne m'étendrai pas davantage eu égard à la complexité de ce calcul. Toutefois, les éléments que j'ai avancés - surestimation du report de trafic, surestimation des gains de temps et sous-évaluation du prix du péage - sont purement factuels en ce qu'ils proviennent du dernier dossier d'Atosca.
Je tenais pour ma part à vous remercier de nouveau de l'occasion qui m'a été donnée de présenter les éléments et veuillez bien croire, monsieur Terlier, que je m'y suis employé à œuvrer dans un souci d'intérêt général, de bon usage de l'argent public et de préservation de la biodiversité. Les éléments présentés résultent de mes compétences de docteur en écologie et de toute la rigueur scientifique et technique à laquelle j'ai été formé. Je me tiens donc à disposition des services de la région Occitanie, de la SNCF et de vous-même, comme de toute entité qui souhaiterait mieux comprendre.
Malheureusement, je ne puis que confirmer mon sentiment d'une profonde incohérence entre les chiffres communiqués ces derniers mois, soit 975 millions d'euros par la région Occitanie, le 20 janvier dernier, puis 2,7 milliards d'euros en 2023 et 4 milliards en euros courants 2034, dans un courrier aux députés du groupe La France insoumise. Il serait assez instructif de savoir de quelle manière de telles estimations ont été produites.
Je serais d'ailleurs très ouvert à des éléments plus solides que produirait la SNCF, comme à l'idée de soumettre ces éléments au débat public. Je rappelle en outre que M. Émery nous a indiqué qu'il se tenait à la disposition de SNCF Réseaux ou de toute entité souhaitant consulter son étude visant à la réutilisation d'une voie ferrée refaite en 2013.
De la même manière, monsieur Terlier, puisque vous êtes l'actuel député de la circonscription, je me tiens à votre disposition pour un échange, dans un autre cadre si nécessaire, pour envisager ces éléments qui, me semble-t-il, sont dans l'intérêt de votre territoire.

Merci de votre proposition, tant il est vrai que je suis toujours disponible pour débattre. Vous aurez néanmoins compris l'agacement qui était le mien et qu'en l'occurrence, ce débat se soit tenu hors du champ de cette commission d'enquête.
Je vous cède la parole, madame la rapporteure, pour votre mot de fin.

Oui, mais nous avions fixé la durée de l'audition à une heure et demie. Je vais donc y mettre un terme.

Je pense pourtant que nous pouvons tout à fait nous accorder quelques minutes supplémentaires.

Je pense pour ma part que nous avons longuement entendu les exposés des deux personnes auditionnées. Nous étions convenus d'une clôture à douze heures trente et il est douze heures trente-sept. Telle est la règle du jeu que nous nous étions fixée.

Nous avons entendu messieurs Manon et Olivier pendant une heure et demie. Je souhaite donc mettre un terme à cette audition.

Je souhaite dire quelques mots de conclusion et je crois plus approprié, en vertu du droit de tirage et par simple courtoisie, de laisser Mme Ferrer et Mme Erodi s'exprimer.

Mme Erodi a eu l'occasion de poser sa question et Mme Ferrer a pu se manifester précédemment. J'avais bien indiqué que l'audition se terminerait à douze heures trente. Je pense que Mme Ferrer, comme députée des Hautes-Pyrénées, aura toute occasion de poser directement ses questions à messieurs Olivier et Manon de sorte à enrichir notre commission d'enquête, à n'en point douter. Pour l'heure, je pense que ceux-ci ont été suffisamment exhaustifs dans leurs présentations.

Je prends acte de l'impossibilité que l'ensemble des députés, notamment écologistes, s'exprime. Une telle façon de procéder me paraît pour le moins contrariante, voire extrêmement inquiétante dans le cadre d'une commission d'enquête dont je suis la rapporteure.
En ce qui me concerne, je remercie monsieur Manon et monsieur Olivier pour leurs expressions très constructives et pour être venus devant cette commission avec des propositions et non des « oppositions ». Ces expressions très constructives témoignent d'un investissement citoyen notable.
Je pense que cette expression mérite de la part des élus que nous sommes, monsieur Terlier, tout le respect que l'on doit à l'engagement au service de l'intérêt général. Lorsque les citoyens s'engagent, c'est qu'ils s'inquiètent et s'interrogent sur leur territoire, bien que n'ayant pas nécessairement les mêmes convictions que les vôtres, ou les nôtres d'ailleurs, selon les dossiers. Les élus que nous sommes seraient donc bien inspirés de leur prêter attention et de respecter leur expression.
Je remercie encore monsieur Olivier et monsieur Manon pour le travail accompli et dont je rappelle le caractère bénévole. Vous témoignez, messieurs, de tout le travail réalisé dans le Tarn et ailleurs et dans cette période d'abstention massive, je pense très important d'avoir connaissance de vos avis et a minima de respecter votre parole.

J'ajoute que monsieur Jean Olivier est tout de même docteur en écologie et que monsieur Manon a été élu local.
Ni madame la rapporteure ni moi-même, monsieur le président, n'avons traité les personnes auditionnées comme vous venez de le faire, en prétendant juger de leurs capacités. Je ne vous cache pas être choquée de cette manière de procéder et je maintiens ma demande que messieurs Manon et Olivier soient de nouveau auditionnés. Votre manière de mener cette commission d'enquête parlementaire, monsieur Terlier, est pour le moins perturbante. Vous n'avez aucunement à remettre en cause la légitimité et la capacité des personnes auditionnées, que leurs positions vous plaisent ou non.
Pour notre part, lorsque vous avez auditionné un certain nombre de maires en faveur de l'autoroute, nous avons veillé à ne pas donner nos avis personnels. Je crois donc votre manière de procéder très particulière et très différente d'autres commissions d'enquête, ce que je tenais à le signaler.
Dans de telles conditions, il me faut enfin vous remercier, monsieur le président, de m'avoir laissé parler et de m'avoir écouté.

Très bien, madame Érodi.
Pour clarifier les choses, je ne crois pas que monsieur Manon ou monsieur Olivier n'ont pris cela pour eux. Je ne mets nullement en cause le travail qui est le leur, aux places qui sont les leurs et je les remercie effectivement de leurs exposés et de nous avoir dit qu'ils s'inscrivaient dans un combat contre l'autoroute A69.
En ma qualité de président, je me dois de veiller à ce que les personnes auditionnées soient liées à l'objet de cette commission, à savoir le montage juridique et financier de l'autoroute A69. Cette audition n'a rien apporté à cet égard, si ce n'est de la contradiction sur la base d'éléments, dont nous ne disposons pas d'ailleurs, sur les solutions alternatives et les questions de VAN-SE, qui ont déjà été tranchées.
Je n'ai rien contre l'audition d'opposants, mais en ma qualité de président de cette commission d'enquête, que je vous remercie de bien vouloir respecter, je me dois également de faire état d'éventuels dévoiements qui sortiraient de son périmètre de sa mission. C'est l'analyse qui est la mienne.
Je me permets en outre de vous rappeler que, jusqu'à présent, je ne me suis opposé à aucune des auditions proposées par madame la rapporteure et que j'y ai systématiquement apporté mon aval.
Je me dois néanmoins de signaler les cas où ces auditions sortent du contexte de notre commission d'enquête. À mon sens, on ne peut pas mettre sur un même piédestal la position d'un ancien conseiller municipal d'une petite commune rurale et pour lequel j'ai beaucoup de respect au demeurant, avec la position de l'ensemble des élus de la communauté de communes de Sor et Agout dans le choix du financement de l'autoroute A69. C'est une bonne chose que de présenter certains avis au travers cette commission, mais il importe aussi de les contrebalancer avec les prises de décisions des élus de ce territoire, ce qui n'a pas été fait.
Monsieur Olivier a effectivement présenté ce qu'il avait à présenter, mais encore une fois, les discussions que nous avons eues avec la SNCF ont donné lieu à des propositions très différentes des siennes. Je m'inquiète donc de cette initiative d'auditionner des personnes qui ne nous apportent pas de chiffrages techniques, à la différence de la SNCF.
En ma qualité de président, je ne peux autoriser aucun dévoiement de cette commission d'enquête.

En aucun cas il n'y a eu dévoiement de la commission d'enquête. M. Olivier a démontré qu'un certain nombre de fondements juridiques avaient été négligés. Vous autorisez certains à parler de choses que vous n'autorisez pas à d'autres. Il s'agirait d'être juste de part et d'autre.

Monsieur le président, à l'instar de Mme la députée Erodi, les propos que vous venez de tenir me semblent assez graves au regard de l'engagement citoyen incarné par les personnes auditionnées aujourd'hui.
Je conteste également ce soi-disant dévoiement que vous invoquez, aucun des propos des personnes auditionnées ne contrevenant à la proposition de résolution que j'ai déposée à l'Assemblée nationale pour constituer cette commission d'enquête.
Vous semblez considérer que la simple existence de citoyens en désaccord avec vos positions révélerait un dévoiement de cette commission. Une telle position revient à fouler au pied la démocratie et à décréter que toute proposition différente des termes du contrat de concession contrevienne, ipso facto, à ce vous pensez utile. Lors des auditions des maires de Puylaurens ou de Saint-Germain et bien qu'étant en désaccord avec leurs propos, à aucun moment je ne me suis permis de déclarer que leurs positions dévoyaient la commission d'enquête.
Je trouve franchement incorrect de tenir ce genre de propos face au travail remarquable de messieurs Manon et Olivier, extrêmement documenté et bien davantage, d'ailleurs, que n'a pu le faire la SNCF ; Mme Trevet n'ayant pas su répondre à plusieurs des questions que je lui ai posées, sans critique aucune, car j'espère qu'elle s'y emploiera par écrit.
Une fois encore, je tenais à remercier les citoyens qui viennent porter à notre connaissance des propositions pleinement et complètement liées à l'objet de cette commission d'enquête.
Sur ce, je pense effectivement que, comme le souhaitez, nous en avons terminé avec cette audition.
La séance s'achève à midi et quarante minutes.
Membres présents ou excusés
Présents. – Mme Christine Arrighi, M. Édouard Bénard, Mme Karen Erodi, Mme Sylvie Ferrer, M. Philippe Frei, M. Jean Terlier, M. Jean-Marc Zulesi
Excusé. – M. Frédéric Cabrolier