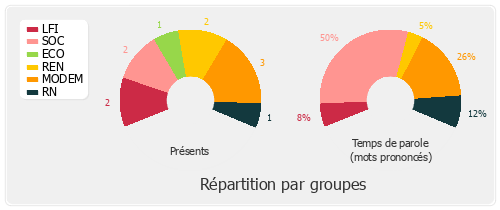Commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la france à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire
Réunion du jeudi 7 septembre 2023 à 9h10
La réunion
Jeudi 7 septembre 2023
La séance est ouverte à neuf heures dix.
(Présidence de M. Frédéric Descrozaille, président de la commission)

Nous ouvrons la deuxième séquence des travaux de cette commission d'enquête. Après avoir consacré les premières auditions à dresser un état des lieux et à partager un niveau de connaissance commun sur les aspects techniques, les définitions, les éléments factuels et les analyses de la contamination de l'eau, du sol et de l'air par les pesticides, nous entrons dans une phase à proprement parler critique des politiques publiques qui ont été menées. L'objet de cette commission est en effet de comprendre ce qui s'est passé – comment et pourquoi les objectifs initiaux de ces politiques publiques n'ont pas été atteints.
Plusieurs rapports bilans ont été opportunément produits, rapports critiques sur la mise en place et la conduite de ces politiques publiques. En particulier, un rapport interministériel d'évaluation du plan Écophyto, publié en juillet dernier, a été transmis à l'ensemble des membres de la commission. Cette publication est tardive, quand on sait que le rapport a été produit en 2021, mais vous allez sans doute nous l'expliquer.
Nous allons maintenant disposer d'un moment privilégié avec les personnes que nous accueillons ce matin : M. Pierre Deprost, de l'Inspection générale des finances, ainsi que Mme Anne Dufour et M. Claude Ronceray, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), que je remercie de leur présence. Cette audition nous permettra d'échanger avec vous, madame, messieurs, sur le périmètre et le contenu de ce que vous avez produit.
Avant de vous donner la parole, je rappelle que cette audition est publique et qu'elle est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale.
Je vous rappelle également que vous êtes tenus, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demande donc de lever la main droite et de dire : « Je le jure. »
(M. Pierre Deprost, Mme Anne Dufour et M. Claude Ronceray prêtent successivement serment.)
En présentant notre rapport, je rappellerai tout d'abord la genèse et les grandes lignes d'Écophyto, après quoi M. Pierre Deprost interviendra à propos des finances et de la gouvernance, puis M. Claude Ronceray présentera notre analyse et nos recommandations.
Je précise que ce rapport a été coécrit avec deux membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable, les inspecteurs généraux Louis Hubert et Mireille Gravier-Bardet.
À la suite d'un référé de 2019 dans le cadre duquel la Cour des comptes s'est interrogée sur l'efficacité des mesures financières du plan, le Gouvernement a commandé une évaluation interministérielle des mesures financières d'Écophyto. C'est la genèse de ce rapport.
Je ferai un très bref rappel historique à propos d'Écophyto. Plusieurs étapes démarrent en 2008. Ce plan, qui est d'abord une mesure issue du Grenelle de l'environnement, constitue la réponse française à une directive européenne demandant aux pays membres d'établir un plan national en vue de réduire l'usage des produits phytosanitaires, ainsi que leurs risques et leurs effets. D'emblée a été affichée une volonté de réduire l'usage de ces produits de 50 % à l'horizon de dix ans. En 2015, devant la faiblesse des résultats, un plan Écophyto 2 a été défini – et M. Potier a été un grand acteur de cette phase. L'objectif de réduction de 50 % a alors été reporté à 2025, avec un objectif intermédiaire d'une diminution de 25 % à l'horizon 2020. Détail important, dès 2008, on avait insisté sur le fait que cette réduction interviendrait « si possible ».
Enfin, en 2018, le Gouvernement a décidé un « plan d'actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides », complété par un objectif de sortie du glyphosate. Ce plan a pris le nom d'Écophyto 2+. On observe ainsi une succession de plans de 2008 à aujourd'hui. En 2018, on prévoit deux phases successives. Tout d'abord, un objectif de réduction de 25 % de l'usage des pesticides est affiché à l'horizon 2025, objectif compatible avec un « changement dans le système ». Compte-tenu de l'ampleur des modifications qu'exigerait une réduction de 50 %, laquelle supposerait cette fois un changement de système, cet horizon est repoussé à 2030.
Les mesures concrètes, que je ne pourrai détailler pas dans le temps qui m'est imparti, reposent sur trois leviers principaux, activés simultanément et que nous avons jugés comme étant globalement à faible intensité.
Le premier de ces leviers est la persuasion : il s'agit d'identifier les bonnes pratiques alternatives, montrer que la réduction est possible et accompagner les agriculteurs. Ce sont les gros dispositifs du plan Écophyto, dont le dispositif Dephy, réseau de démonstration, expérimentation et production de références sur les systèmes économes en phytosanitaires. Ce programme est relativement important, avec 3 000 exploitations engagées volontairement à réduire l'usage des phytosanitaires tout en maintenant leurs performances économiques, sociales et environnementales. Il faut citer également le Bulletin sanitaire du végétal, dispositif qui fournit aux agriculteurs un bulletin gratuit présentant de façon neutre l'état sanitaire des cultures afin qu'ils puissent disposer d'une information de qualité pour gérer et raisonner efficacement les traitements phytosanitaires, ce qui ne les empêche évidemment pas de faire un tour de plaine. La production de ces bulletins repose sur un vaste réseau d'épidémiosurveillance couvrant 15 000 parcelles surveillées chaque semaine ou à la fréquence adéquate selon les cultures.
Le second levier est celui de l'incitation, qui consiste à encourager la réduction de l'usage des phytosanitaires ou, au contraire, à dissuader d'y recourir. Cela suppose des aides financières dédiées, comme le crédit d'impôt pour sortie du glyphosate, la conditionnalité de certaines aides, la taxation des produits phytosanitaires par la redevance pour pollution diffuse (RPD) et, plus récemment, le certificat d'économie de produits phytosanitaires (CEPP).
Le dernier levier est celui de la réglementation, qui porte ses fruits, avec le retrait de l'approbation européenne des substances dangereuses, des restrictions de préparation, dont la réglementation relève de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), et des restrictions d'usage imposant, par exemple, par voie réglementaire, des zones de non-traitement. Il s'agit aussi d'une réglementation sur les matériels, avec le contrôle des pulvérisateurs, et de la séparation de la vente et du conseil. Un corollaire nécessaire de cette réglementation est l'application de contrôles, que nous estimons cependant globalement limités.
Quant aux résultats de ces plans, on observe, d'une manière générale, des avancées. Écophyto apporte la preuve qu'il est possible de réduire l'usage des phytosanitaires. Cependant, on voit aussi les limites des techniques alternatives, qui sont moins faciles et plus chères, et dont le résultat est incertain – sans doute Christian Huyghe vous a-t-il bien informés à ce propos.
La politique réglementaire prouve son efficacité, avec en particulier une réduction notable du risque liée à la baisse de l'utilisation des produits les plus dangereux, de nouvelles substances étant régulièrement interdites.
Malgré ces avancées, le résultat n'est pas à la hauteur de l'ambition initiale. En effet, les indicateurs historiquement choisis pour piloter le plan – la quantité de substances actives (QSA) et le nombre de doses unités (Nodu) – ne suivent pas la trajectoire voulue et se situent encore bien au-dessus des références de 2008.
Pour conclure, tous les acteurs s'accordent à dire que l'on bute toujours sur la massification des pratiques propres à réduire l'usage et le risque.
Avant d'évoquer les questions liées au financement et de préciser quelques points marquants pour l'analyse du plan Écophyto, je tiens à souligner d'emblée que les données que je citerai datent de 2019, et qu'il convient donc, en 2023, de les prendre avec prudence.
Je rappelle tout d'abord que le financement du plan Écophyto repose sur une taxe : la redevance pour pollutions diffuses, qui a rapporté 150 millions d'euros en 2019, dont 41 millions réservés au financement du programme national. Ces sommes sont versées à l'Office français de la biodiversité (OFB), qui met ensuite en œuvre les financements. En complément, il existe également depuis 2016 une enveloppe régionale affectée aux agences de l'eau, soit au total environ 71 millions d'euros sur les 150 millions de la redevance pour pollution diffuse. Ces montants sont donc assez faibles et la première conclusion que l'on peut en tirer est que la redevance pour pollution diffuse a un impact assez réduit sur le prix des produits phytopharmaceutiques.
La Cour des comptes avait souligné, dans son rapport de 2019, que ces montants ne donnent pas une vision complète de l'ensemble des dépenses engagées en faveur de la politique de réduction de la consommation de produits phytopharmaceutiques, car il existe aussi des financements européens, des financements des régions et d'autres financements de l'État. La Cour des comptes estimait ainsi que, parallèlement à ces 71 millions d'euros, 400 millions étaient consacrés à l'ensemble cette politique avec d'autres financements.
Le premier travail du délégué interministériel nommé en novembre 2018 a été de préciser ces montants, sur la base d'une enquête assez poussée. Selon cette enquête, l'ordre de grandeur des financements bénéficiant à la réduction de l'usage des produits phytosanitaires était plutôt de 643 millions d'euros à l'époque. Bien que l'enquête soit approximative, l'ensemble des acteurs a été consulté et les montants semblent avoir été plutôt bien définis.
Il importe donc, afin de disposer de tous les leviers d'action pour la définition d'une politique, de garder présent à l'esprit que le plan Écophyto ne représente qu'une faible partie des financements alloués à la réduction de la consommation de produits phytopharmaceutiques.
Deuxième constat, bien qu'il s'agisse d'une somme importante, ces 643 millions ne font pas le poids face aux 9 milliards d'euros que représentait en 2019 la politique agricole commune et au chiffre d'affaires de la production agricole française, que nous estimions à l'époque à 71 milliards d'euros. Les montants destinés à la mise en œuvre de ces actions sont donc certes importants au niveau opérationnel mais, dans la réalité, ils ne le sont guère pour changer les mentalités et accompagner des mesures dans l'esprit de massification que nous évoquions tout à l'heure – à moins que les autres acteurs bénéficiant de montants importants convergent vers l'objectif politique de réduction des produits phytopharmaceutiques.
Enfin, les moyens sont concentrés sur un nombre limité d'actions. En effet, 90 % des crédits sont concentrés sur cinq actions et les 10 % restants financent une multitude de petites actions, ce qui est une forme de saupoudrage. La moitié des cinq actions principales concernent l'agriculture biologique, qui a des effets positifs sur les résultats en termes de baisse de la consommation de produits phytopharmaceutiques. Je pourrai, si vous le souhaitez, revenir sur d'autres points à ce propos.
Dans l'ensemble, le seul financement orienté vers la massification est celui qui concerne l'agriculture biologique. Tout le reste porte sur des expérimentations permettant de démontrer que des résultats sont possibles, mais pas de massifier, ce qui explique en partie les résultats insuffisants constatés par la Cour des comptes.
Voilà pour ce qui concerne les financements.
Sur la gouvernance, la Cour des comptes avait également formulé des critiques, et nous avons fait exactement les mêmes constats.
Tout d'abord, si la gouvernance du plan est interministérielle et concerne quatre ministères, ces derniers ne sont impliqués que pour le pilotage du volet national, ce qui leur donne, en termes stratégiques, une vision partielle. Par ailleurs, pour ce qui est de la réalisation du plan d'action, l'absence d'évaluation des mesures financées ne permet pas de savoir si elles sont ou non efficaces. En troisième lieu, ces évaluations inexistantes ne donnent pas lieu à rapport à un comité scientifique et technique : cela avait été proposé en 2014 par notre éminent président mais, fin 2020, cette proposition n'avait toujours pas été mise en œuvre.
Nous ne disposions donc pas d'éléments permettant d'avoir une vision globale des financements, les évaluations sont insuffisantes et elles ne font pas l'objet de validation par le comité scientifique et technique, qui n'existait d'ailleurs pas à l'époque. Plus largement, cette absence de vision globale ne permettait pas de mettre en cohérence des politiques publiques qui, malgré des objectifs quelque peu différents, pouvaient converger. Un pilotage stratégique était donc réellement difficile.
Sur le plan opérationnel, nous n'avions pas à l'époque de chef de projet au sens classique du terme. En effet, le délégué interministériel créé et nommé en décembre 2018 n'avait pas la capacité d'arbitrer, notamment pour la vie quotidienne et les besoins des différents acteurs de terrain. Cette absence de conduite de projet global ajoutait à la difficulté stratégique une difficulté de mise en œuvre pratique, ce qui se traduisait, en termes de réalisation, par une programmation budgétaire assez tardive, avec en général un décalage de l'ordre d'une année. Or lorsque les crédits sont programmés tard dans l'année, ils ne sont consommés que l'année suivante, ce qui se traduit par d'importants reports de crédits, sur lesquels je reviendrai. Il n'y avait, en outre, pas de coordination entre les responsables des différentes actions du programme.
En termes de gouvernance, la mobilisation des acteurs clés du programme n'était pas suffisante ni orientée. C'est évidemment difficile s'il n'y a pas de pilote, mais chacun des acteurs concernés n'était, en outre, pas en mesure d'aller loin dans la mise en œuvre. L'OFB, qui disposait des financements, menait cette politique parmi d'autres et lui consacrait des montants relativement faibles par rapport à ceux alloués à d'autres domaines – j'y reviendrai tout à l'heure, car cela a des conséquences sur la consommation des crédits.
Au niveau régional, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) disposent de peu de moyens financiers, car ce sont les agences de l'eau qui les ont, les Draaf étant plutôt des coordonnateurs de comités de financeurs et ne pouvant pas mettre d'argent sur la table pour entraîner d'autres acteurs, notamment régionaux, dans cette démarche, qui est donc toujours plus délicate à mettre en œuvre.
Enfin, nous n'avons pas constaté que les chambres d'agriculture se soient mobilisées pour ce plan et il n'y avait pas non plus de contrat d'objectifs et de moyens qui les incitaient à mener des actions dans ce sens.
Voilà pour les idées-forces concernant la gouvernance du plan et le pilotage du programme.
Pour ce qui est, en troisième lieu, de la gestion financière du programme, nous avons constaté, comme la Cour des comptes, que certaines actions revenaient régulièrement chaque année. Alors que 70 % environ des financements sont récurrents, on se pose chaque année à nouveau la question de la programmation budgétaire pour l'ensemble des crédits. Cette procédure est assez lourde, alors qu'une procédure de programmation pluriannuelle permettrait d'anticiper les crédits, de les consommer plus vite et donc d'agir plus vite. Ces techniques, qui n'étaient pas en vigueur à l'époque, sont certes assez élémentaires, mais elles sont désormais bien au point.
Du côté des recettes, le recouvrement de la redevance par l'une des agences de l'eau – celle d'Artois-Picardie – fonctionne bien, et il n'y a donc pas de raison de remettre en cause ce fonctionnement. Du côté des dépenses, en revanche, l'OFB n'a pas, je le répète, pour mission principale la mise en œuvre du plan Écophyto : cet établissement exécute d'autres politiques et, pour agir, applique des règles internes qui s'imposent à l'ensemble des politiques, notamment pour ce qui concerne les subventions. Or, alors que l'OFB a, par exemple, pour règle interne de ne pas subventionner un projet à hauteur de plus de 75 %, de telle sorte que ce projet doit trouver d'autres financeurs, l'État souhaite parfois que le financement atteigne 100 %. Certaines contraintes peuvent ainsi tenir à un opérateur qui n'est par ailleurs pas pleinement concerné par le projet en question, et a d'autres préoccupations.
Quant au volet régional, les agences de l'eau, qui disposent de 30 millions d'euros répartis entre elles, ont des missions plus vastes que le plan Écophyto, qui se trouve ainsi un peu marginalisé. Les agences de l'eau contribuent toutefois, pour des montants importants, au bénéfice des objectifs du plan Écophyto – nous y reviendrons tout à l'heure.
Comme je l'ai également dit, la Draaf n'est pas le pilote régional du plan et ne dispose pas des moyens. Par ailleurs, les agences de l'eau ne participent pas à la stratégie nationale et on ne les consulte pas sur la mise en œuvre des différentes actions. Il n'y a donc pas d'interactions entre la vision nationale et la vision régionale – en d'autres termes, entre le terrain et les décideurs : les deux niveaux sont déconnectés. C'est en tout cas ce que nous avions constaté à l'époque.
Enfin, sur six ans et pour ne parler que des 41 millions affectés à l'OFB, 15 % des crédits de paiement ne sont pas consommés ni reportés, soit en moyenne 6 millions d'euros qui tombent chaque année dans le fonds de roulement de l'OFB, lequel les emploie à d'autres usages. À l'époque, je le rappelle, cette redevance était une taxe affectée, dont on ne pouvait pas utiliser l'argent à d'autres objets que la réalisation du plan Écophyto – cela a changé depuis. Normalement, c'est l'exercice de la tutelle qui permet de constater la sous-consommation des crédits et d'inciter à les reprogrammer pour l'année suivante. Sur les 24 millions qui n'ont pas été consommés durant la période 2016-2019, seuls 4 millions ont été reprogrammés, ce qui représente une perte sèche de 20 millions sur l'ensemble de cette période, perte non négligeable par comparaison avec les 41 millions annuels – et, de fait, en discutant avec les acteurs de terrain, on voit que 20 millions représentent une somme importante.
Il m'appartient de prolonger les constats présentés par mes deux collègues autour d'une question principale : au-delà des différentes actions menées et des financements importants mobilisés, qu'est-ce qui pourrait marcher ? Quels pourraient être les mécanismes qui permettraient une massification des bonnes pratiques ? De fait, des bonnes pratiques, meilleures que d'autres, ont été identifiées, ainsi qu'un grand nombre d'actions et de leviers mais, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce qui a été réalisé permettrait d'atteindre l'objectif initial, ni même les objectifs intermédiaires que nous nous sommes donnés. Cette question est celle que la mission approfondit dans son rapport – modestement, car nous ne doutons pas que ce soit difficile, comme plusieurs experts vous l'ont indiqué, mais il nous semble néanmoins que certains principes peuvent être identifiés et mieux respectés.
La première question est peut-être de savoir quelles sont les méthodes permettant que les agriculteurs adoptent une nouvelle technique, une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire. Je sais que vous avez reçu au mois de juillet des experts qui ont retracé un historique des transformations très nombreuses que le monde agricole a connues. Je prendrai un seul exemple : lorsque, dans les années 1970, ma famille, qui dégarnissait les betteraves, a vu pour la première fois un champ recevoir des semences enrobées de betterave, du jour au lendemain, tous les agriculteurs ont décidé d'abandonner l'ancienne technique et ont acheté ensemble un semoir en coopérative d'utilisation de matériel agricole (Cuma) et, en très peu de temps, une année ou deux, ont tous adopté la nouvelle technique de l'enrobage, qui permet d'éviter le dégarnissage des betteraves, l'une des opérations les plus pénibles dans le monde agricole. Ce dernier n'est donc pas forcément résistant au changement et connaît parfois des transformations très importantes dans des délais très brefs.
En revanche, il faut de bonnes raisons pour pousser les agriculteurs à abandonner une technique qu'ils maîtrisent ou une organisation qui existe. Ces raisons devront être à la fois techniques, agronomiques et économiques, car une exploitation agricole est aussi une entreprise qui demande un pilotage par la microéconomie.
Lorsqu'on pose ce diagnostic, on constate des difficultés. En réalité, depuis le premier plan Écophyto, le « signal prix » – pour parler le langage des économistes – n'a pas été, à bien des égards, dans le bon sens. Aujourd'hui, le rendement économique des phyto est plutôt meilleur que celui des alternatives et il évolue plutôt favorablement. Ainsi, la part de la dépense des phyto dans les consommations intermédiaires des exploitations agricoles a plutôt diminué en termes relatifs. On voit donc que cette solution, même si elle a été découragée par les mots et par de nombreuses actions de dissuasion, continue à être très souvent la solution de référence pour les agriculteurs et que, s'ils doivent en adopter une autre, il faut leur donner de bonnes raisons.
Il faut donc agir sur l'économie et sur l'écart de prix, sur le fait que les nouvelles techniques proposées ou déjà adoptées – car de nombreuses découvertes ou redécouvertes des vingt dernières années sont adoptées assez spontanément par les agriculteurs – offrent une motivation et un rendement agronomique et économique.
De ce point de vue, l'un des facteurs limitants – pour employer une autre expression des économistes – est bien souvent la possibilité de disposer dans l'exploitation, plus que de la main-d'œuvre en soi, de la main-d'œuvre au bon moment, c'est-à-dire de celle qui permettra de réaliser la tâche. C'est là un point très délicat pour de nombreuses alternatives aux phyto : c'est parce qu'on ne dispose pas de la main-d'œuvre au bon moment que la solution phyto apparaît presque comme la seule possible, même si ce n'est pas le cas.
Il ne faut pas pour autant dévaloriser tous les efforts réalisés en amont, par les agriculteurs, et en aval. Qui plus est, faire peser le poids de la transformation sur les seuls agriculteurs n'est sans doute ni correct ni même très juste socialement. En effet, les agriculteurs se situent dans une chaîne de valeur qui commence bien avant eux et se poursuit bien après. On parle, à la Commission européenne, d'une chaîne qui va « de la fourche à la fourchette », mais il faudrait agir bien avant la fourche et jusqu'à bien après la fourchette, car la décision de recourir aux phyto a des déterminants bien en amont, notamment au niveau des paysages et de l'organisation spatiale. Si l'on favorise, par exemple, les très grands champs, certaines solutions seront rendues presque impératives, alors qu'un parcellaire plus émietté rend à nouveau possibles certaines solutions inspirées de la nature, du fait par exemple de la présence de coccinelles ou d'autres auxiliaires de culture. Ce sont là des facteurs qui se situent en amont de l'exploitation agricole et qui ne dépendent pas seulement de l'exploitation même, mais aussi du système d'exploitation pris dans son ensemble.
D'autres facteurs se situent en aval, au premier rang desquels les circuits de collecte, qui recèlent une partie des solutions. Or la France a connu un processus de très grande concentration de ces circuits, avec la concentration et la spécialisation des grandes coopératives et des grandes sociétés de négoce, de telle sorte que les exploitants agricoles ne peuvent pas facilement peser sur ces mécanismes qui se situent en aval d'eux, alors que la transformation de ces structures doit intervenir en même temps que celle des agriculteurs. Une solution consiste, par exemple, à pratiquer des cocultures, c'est-à-dire plusieurs cultures à la fois sur un même champ, mais sans une adaptation concomitante en aval, c'est l'impasse technique et économique.
Il ne faut pas s'arrêter à la collecte et au négoce ; les industries de transformation, la grande distribution et les consommateurs ont leur rôle à jouer. Il est, par exemple, très connu que ces derniers préfèrent les beaux fruits plutôt que les tachetés, et leur comportement a un impact sur l'amont. Il faut donc agir sur l'économie et sur l'ensemble de la chaîne, pas seulement sur les agriculteurs.
Nous avons tenté de recommander des mesures ayant un effet massif de réduction des pesticides. Comme vous, nous avons rencontré de nombreuses personnes et étudié les leviers actionnés dans d'autres pays. Ce travail d'analyse a abouti à la définition de trois grands scénarios, recouvrant trois stratégies différentes pouvant réduire fortement l'usage des pesticides.
La première stratégie, celle qui s'inscrit le plus dans la continuité des plans précédents, repose sur la segmentation des marchés. Il ne faut pas faire comme si une production utilisant des produits phytosanitaires et une autre n'en comprenant pas étaient identiques, afin de ne pas réserver le marché du bio à une classe qui peut supporter le surcoût de la production. Celui-ci n'est pas transitoire, il perdure car il répercute un coût de maintien : la production bio coûte durablement plus cher que celle utilisant les technologies les plus productives. Il nous a semblé que nous avions conservé en France une vision trop jacobine du territoire alors qu'on constate de grands écarts d'une région à l'autre, et même d'un petit territoire agricole à l'autre, dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Ces différences se retrouvent dans les cultures, certaines d'entre elles consommant beaucoup de produits phytosanitaires quand d'autres en utilisent beaucoup moins ; au sein d'une même culture, des écarts existent aussi selon les régions. Il convient donc de dresser un diagnostic par petits territoires. Or, jusqu'à présent, l'échelle des objectifs des plans Écophyto est nationale, et leur déclinaison locale n'intègre pas la nécessité de les adapter aux territoires. Cet axe doit produire des résultats, l'avantage de la démarche de segmentation étant de bénéficier des bonnes volontés. Ainsi, des territoires ont commencé de s'organiser pour réduire fortement, voire éliminer, l'utilisation de produits phytosanitaires. L'action publique peut s'appuyer sur ces réussites et généraliser ces expériences.
Les consommateurs connaissent les très nombreux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (Siqo), qui sont connus dans tous les circuits de distribution. Beaucoup de Siqo ne comportent aucune exigence en matière de produits phytosanitaires. Il faudrait qu'ils intègrent cette dimension, afin que le consommateur connaisse le poids de ces produits dans ce qu'il achète. La cueillette mécanique des raisins est, par exemple, interdite pour certaines appellations de vin, mais les exigences en matière de produits phytosanitaires sont très faibles.
La deuxième stratégie est centrée sur l'incitation économique visant à modifier la variable du prix. Les produits phytosanitaires ne sont pas seulement gênants pour les agriculteurs qui les utilisent, ils induisent des externalités négatives, dont la pollution, qu'il convient de réduire. Pour y parvenir, l'un des moyens est de fixer un prix à ces externalités, que l'ensemble de la chaîne, et pas simplement les agriculteurs, devra payer. Nous proposons donc d'avantager fiscalement les filières utilisant moins de pesticides, afin d'aider l'ensemble des acteurs à abandonner leur usage. L'utilisation de l'instrument fiscal est très délicate, d'autant que les secteurs français de l'agriculture et de l'alimentation sont très ouverts au marché européen et mondial. Il existe néanmoins des marges de manœuvre, notamment avec la redevance pour pollution diffuse dont le taux est actuellement très bas.
La dernière stratégie consiste à réglementer – tâche à laquelle l'État s'est déjà attelé –, à agir à l'échelle européenne sur les substances et à aligner les politiques publiques en matière de PAC. Pierre Deprost l'a évoqué, la part des financements dédiés aux produits phytosanitaires, même en élargissant à l'ensemble de la production bio, est de l'ordre de 600 millions d'euros quand l'enveloppe de la PAC atteint 9 milliards d'euros – un peu moins si on ne considère que l'argent allant directement dans la poche des agriculteurs – et le chiffre d'affaires annuel du secteur agricole 90 milliards d'euros. Les ordres de grandeur ne sont pas les bons, et il est indispensable de mobiliser la PAC pour réaliser les transformations nécessaires. L'une des recommandations importantes de notre rapport est d'essayer d'aligner les objectifs phytosanitaires et les moyens que mobilisent la France et l'Union européenne pour augmenter le revenu agricole, but principal de cette politique. L'amélioration du couplage entre la distribution des aides de la PAC et les exigences en matière de réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires est souhaitable.
Pour conclure, il faut actualiser nos travaux, réalisés il y a environ deux ans et demi, à la lumière de la nouvelle PAC, qui se déploie depuis le début de cette année, et du nouveau plan stratégique national (PSN). L'exécution de ce plan offre l'opportunité d'améliorer les pratiques, la France disposant, à nos yeux, de marges de manœuvre pour agir, non sur les substances puisqu'elles relèvent de l'Union européenne, mais sur la territorialisation de cette politique publique. Cela répondrait à une demande des acteurs que nous avons rencontrés, notamment à l'échelle locale. Nos concitoyens étant de plus en plus préoccupés par les produits phytosanitaires, il importe que les élus et les territoires puissent s'approprier cette question afin que celle-ci sorte de la sphère technique.
Voilà un résumé brutal, voire un peu caricatural, de notre rapport, qui est assez épais et que nous ne pouvons pas présenter de manière exhaustive.

Nous vous remercions pour votre effort de synthèse : votre propos était très dense et nous allons prendre le temps d'échanger.
Les incohérences de la gouvernance financière et les inefficacités que vous pointez laissent songeur : nous pourrions sans doute tirer de ce constat des leçons dépassant largement ce programme, car nous avons l'impression de rencontrer ces travers dans de nombreuses politiques publiques.

Votre rapport est d'une très grande qualité, qui vous honore ainsi que les structures auxquelles vous appartenez. Vous avez fait preuve d'une haute exigence intellectuelle et d'une grande rigueur : l'exposé synthétique n'en rend que partiellement compte, donc j'invite les membres de la commission à lire ce rapport.
Je me mets dans les pas du président : comme je l'avais écrit en 2014 à la fin de l'introduction de mon rapport Pesticides et agroécologie, les champs du possible, l'échec du plan Écophyto est une leçon pour les politiques publiques, car il représente l'archétype de l'incurie qui m'a incité à demander la création de cette commission d'enquête.
Je crains que vous ne bottiez en touche, mais puisque vous intervenez sous serment, pouvez-vous nous donner votre avis sur les raisons pour lesquelles votre rapport n'a pas été publié ? Le débat au Parlement que la publication du rapport aurait pu susciter en 2021 aurait pu déboucher sur le déploiement de solutions : nous aurions ainsi gagné quelques années par rapport à cette commission d'enquête. J'imagine que vous allez nous répondre que le choix de publier ou non le rapport ne relevait pas de votre autorité, mais vous avez sûrement un avis sur la question.
Vous avez rencontré de nombreux acteurs pour la rédaction de votre rapport, mais vous n'avez auditionné aucun contributeur du rapport de 2014 : je suis étonné de cet oubli, que je regrette car il vous a conduit à certaines incompréhensions. Je ne doute pas que Jean Boiffin, que vous devez estimer comme nous, aurait la même appréciation que moi. Une audition des auteurs du rapport de 2014 aurait permis de purger ces incompréhensions.
Le diagnostic et les préconisations du rapport de 2014 sont très proches des vôtres, par exemple sur les questions de la gouvernance, du délégué interministériel, de la recentralisation du commandement, de la cohérence, de la coordination, de l'efficacité de l'emploi des fonds publics et de l'augmentation des moyens : tous les éléments sont dans notre rapport, certes de manière moins approfondie.
Vous confondez le rapport ayant inspiré le plan Écophyto 2 et la réalisation de celui-ci ; or ce plan n'a pas été mis en œuvre : vous évoquez les 30 000 fermes engagées dans la transition vers l'agroécologie à bas niveau de produits phytosanitaires comme si elles existaient, mais tel n'est pas le cas – même les 3 000 fermes Dephy n'existent pas. Et ce plan date de dix ans ! Il n'a donc pas été mis en œuvre. Écophyto 1 est un échec et Écophyto 2 n'a pas été déployé.
Vous vous trompez également en présentant le plan Écophyto 2 comme une stratégie articulée en deux temps. Dans le premier, on tâcherait d'optimiser. On pourrait ainsi mieux travailler dans la ferme France avec un assolement, des pratiques, une économie, des filières, un droit européen et une PAC identiques, mais en produisant au bon moment, en utilisant les doses pertinentes, les technosolutions, etc. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la marge de progrès tourne autour de 20 % ; fixer un objectif à 25 % à atteindre en cinq ans est donc très ambitieux. Puis vous évoquez une seconde étape. Ce raisonnement est erroné : l'idée était bien de déployer sans attendre des réformes structurelles des filières, de la PAC et de la gouvernance pour atteindre une cible de diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires de 50 % en dix ans, elle aussi très ambitieuse. Les premières actions permettent d'obtenir des résultats et ainsi de redonner le moral. Une action herbicide et insecticide bien ciblée et obéissant à une obligation réglementaire sur la sole de colza produit 10 % des solutions attendues, de façon certes autoritaire mais efficace et à même de donner confiance dans l'action publique. Or nous avons privilégié ce que Jean Boiffin qualifiait de « dispositif kafkaïen ».
S'agissant du continuum entre la recherche et le développement, votre rapport méprise le fait que le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques comprenait une sanction financière, que la loi Egalim a supprimée, le pouvoir exécutif se rendant là coupable d'un véritable abus. Le seul dispositif allant au-delà de la simple incitation, expérimentation ou communication a ainsi été dévitalisé par décret. Il a été remplacé par une séparation de la vente et du conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, que vous présentez comme une bonne nouvelle mais dont un rapport parlementaire, rédigé par un ancien ministre de l'agriculture, souligne l'échec, reconnu par tous les acteurs.
Votre rapport pointe le manque d'indicateurs sur les risques et les effets dans les domaines de la biodiversité et de la santé humaine. Pouvez-vous nous expliciter la différence entre ces deux notions de risques et d'effets ? Vous affirmez par ailleurs que ceux-ci sont méconnus, comme les auditions que nous avons conduites jusqu'à présent l'ont montré. Dès lors, comment pouvons-nous élaborer des indicateurs dans des matières où nous en sommes encore au stade de la recherche ? Nous pressentons qu'il y a des dangers – dont l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a pointé l'existence –, mais nous ne les connaissons pas encore assez bien pour construire des indicateurs.
Les pays européens les plus productivistes et les plus conservateurs défendent l'option d'une diminution des risques liés aux produits phytosanitaires ; de son côté la France pense que c'est la baisse de l'usage des produits phytosanitaires qui réduira les risques. Mais quels sont les indicateurs pertinents pour mesurer cette évolution des usages ? Vous plaidez pour l'indicateur du Nodu, qui est actuellement stable alors que celui de la QSA diminue. À quoi, selon vous, cette baisse est-elle due et pourquoi faut-il rester attaché au Nodu ?
Vous dites que le plan Écophyto n'a pas suffisamment intégré la PAC et les régimes d'autorisation, mais ceux qui le déploient pilotent un dispositif de recherche et de développement et n'ont pas d'autorité sur la PAC ni sur les régimes d'autorisation, lesquels sont le principal moteur de retrait des molécules depuis vingt ans, notamment grâce à l'Anses. Votre délégué interministériel ne serait-il pas un superministre de l'écologie, de l'agriculture et de la santé ? Je comprends votre volonté de placer sous sa responsabilité tous les dispositifs de R&D, qu'ils soient incitatifs, réglementaires et financiers, mais lui demander de s'assurer de la cohérence avec la PAC relève d'une décision politique : je souhaiterais que nous discutions de cette question.
Je ne vois pas de sujet de polémique dans les propos de M. Potier, car nous sommes d'accord sur presque tout, même si notre expression a peut-être été un peu maladroite. Nous ne nous sommes pas placés dans la perspective d'évaluer la mise en œuvre des recommandations du rapport de M. Potier. Nous nous sommes beaucoup inspirés de ce document extrêmement intéressant, que nous avons beaucoup cité, mais nous n'avons pas étudié la compréhension, le déploiement et les résultats des mesures qu'il préconisait. Si je devais me poser cette question, la réponse serait très simple : de nombreuses dispositions recommandées par le rapport n'ont pas été mises en œuvre.
Il y a un écart entre nos travaux et les plans d'action du Gouvernement et de son administration. Un rapport avait été rédigé, un an avant le Grenelle de l'environnement, puis le Gouvernement avait conçu le plan Écophyto que l'administration a largement mis en œuvre. Actuellement, cette démarche en deux temps se perd et nous avons tendance à confondre les intentions et les véritables plans d'action. Derrière vos interrogations se pose la question suivante : existe-t-il un plan d'action gouvernemental qui engage l'ensemble des acteurs et qui est effectivement déployé avant d'être évalué plus tard ? La réponse est négative. Un tel plan devrait être interministériel car une partie des sources d'information ne se situe pas au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; il devrait également identifier avec une grande clarté les responsables de chaque action pour rendre le plan opérationnel. Mon collègue Pierre Deprost a parlé de direction de projet, celle-ci devant désigner chaque équipe participant au déploiement des dispositions du plan.
Les produits phytosanitaires ne représentent pas un aspect particulier de l'agriculture, ils participent d'un système industriel, agricole, de distribution et de consommation. Veiller à l'alignement de tous les acteurs est une tâche difficile, et notre rapport recommande quelques mesures visant à faire progresser leur identification, leur responsabilisation et leur évaluation. Cette mission doit s'accomplir à l'échelle territoriale et pas seulement nationale, car c'est à ce niveau que certains diagnostics et certaines solutions peuvent être posés.
La question des indicateurs est technique. Le Nodu, défini au début du plan, est pertinent et utile, car il mesure à moyen et long terme les évolutions ; il n'est néanmoins pas très opérationnel parce qu'il est difficile de le décliner à l'échelle locale. Or il importe que chaque acteur concerné puisse prendre sa part dans le travail collectif. S'il n'y a pas de lien entre son action et le grand indicateur national, celui-ci pourrait s'en trouver délaissé. Nous ne souhaitons pas abandonner le Nodu, nous voulons que le pilotage s'exerce à la bonne échelle.
Certaines substances et certains produits comportent des dangers encore inconnus. Nous en découvrons régulièrement de nouveaux, qui doivent nous conduire à ne certes pas pécher par excès de prudence, mais à ne pas montrer non plus trop d'assurance. La France a choisi un objectif de réduction quantitative de l'ensemble des pesticides de synthèse, qui aura pour effet de diminuer les risques puisqu'une part d'entre eux ne sera plus du tout utilisée. D'autres pays contestent cette analyse et recommandent une plus grande sélectivité et une action concentrée sur les risques identifiés pour les populations les plus exposées, humaines ou relevant de la biodiversité. Nous n'avons pas remis en cause la stratégie française de réduction quantitative des produits phytosanitaires, nous avons simplement regretté qu'elle ne soit pas déclinée par territoire et par type de filière. Des discussions se tiennent actuellement à l'échelle européenne pour que l'objectif de réduction quantitative soit également pris en compte : ce n'est donc pas le moment d'abandonner cette cible.

Merci pour ce début de réponse à des questions très vastes. Je veux insister – à mots choisis, car le point est sensible – sur la question de la publication du rapport. Il ne s'agit pas de mettre à l'index tel ou tel acteur. L'esprit de cette commission est de parvenir à comprendre, collectivement, ce qui se passe lorsque la nation échoue à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. En ce sens, la publication du rapport, qui pourrait paraître anecdotique, est essentielle. Elle reflète la capacité collective de l'appareil d'État et des politiques à reconnaître leur insuffisance.
En 2021, lorsque vous avez écrit le rapport, vous aviez un commanditaire. Par quel processus a-t-il été décidé que le rapport serait utile et publié, et pour qui ?
Nous travaillons à la demande du Gouvernement. Plus exactement, des lettres de commandes sont signées par les directeurs de cabinet des différents ministres chargés des questions posées dans le rapport. Nous fournissons le document et ses conclusions à nos commanditaires. Chemin faisant, nous travaillons également avec les services en lien avec ces thématiques : des présentations provisoires du rapport, à un état quasi définitif, leur ont été faites.
Le choix de publier n'appartient pas aux instances dont nous faisons partie : ce sont les cabinets des ministres qui en décident. En l'occurrence, chaque cabinet a décidé pour son propre compte. Le rythme de publication a donc été différent pour l'Inspection des finances, le Conseil général de l'environnement et du développement durable, aujourd'hui Inspection générale de l'environnement et de développement durable (IGEDD) et le CGAAER, pour l'agriculture.
Nous avons écrit pour être publiés – c'était le sens du travail qui nous était demandé. Nous n'avons pas eu vocation à examiner votre rapport de 2014, soit pour en faire une critique, soit pour déterminer s'il a été suivi d'effet. La lettre de mission du Gouvernement visait à ce que nous fournissions des arguments pour répondre au rapport de la Cour des comptes. La plupart de nos constats sont allés dans le même sens que ses observations. C'est ce qui explique que notre rapport soit un peu décalé par rapport aux questions que vous posez.
Sur le fond, nous sommes d'accord avec vos remarques. Il y a bien une difficulté entre l'intention et la mise en œuvre. La gouvernance est un élément essentiel de celle-ci : on voit qu'aucune autorité n'est capable d'arbitrer et de faire le lien avec le niveau opérationnel. Ce lien ne peut être établi que si un plan d'action très précis est défini.
Par exemple, une des difficultés pour faire évoluer l'indicateur phare qu'est le Nodu, c'est de connaître les leviers d'une telle évolution : on ne sait pas si telle ou telle opération aura un impact sur cet indicateur très globalisant. Un important travail doit être mené en amont pour préciser ces effets, en plus de déterminer si c'est le bon indicateur.
Nous sommes arrivés aux mêmes constats que vous dans le rapport, ce qui a confirmé la pertinence de vos propositions. Nous avons vu que, dans les organisations mises en place, le plan d'action n'est pas assez détaillé ; l'effet de levier d'une action sur le résultat n'est pas démontré ; et les acteurs ne sont pas mobilisés pour contribuer. Enfin, ceux qui détiennent les financements ne sont pas les responsables. Dans les administrations, certaines personnes sont responsables d'actions pour le plan Écophyto, mais elles ne disposent pas des fonds et, selon les principes de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf) auxquels nous sommes attachés, elles n'ont pas les moyens de mettre en œuvre le plan.
Ce sont des éléments très importants, qu'il faut corriger si l'on veut mener des actions significatives.

Vous avez évoqué l'incapacité de l'OFB à attribuer l'intégralité des financements sur une année et le fait que le résidu retourne au pot commun. Ces dysfonctionnements sont-ils spécifiques à ces sujets ou les retrouve-t-on ailleurs ?
S'agissant de la stratégie, je partage les éléments que vous avez évoqués, notamment la notion de segmentation territoriale, l'importance que toute la chaîne supporte les externalités négatives ou l'idée d'alléger la fiscalité des acteurs allant dans le sens attendu. Enfin, vous évoquez la nécessité d'agir à l'échelle européenne, en allant dans le sens d'un alignement des grandes politiques. Or la PAC concerne l'ensemble de l'agriculture, y compris biologique. On ne peut donc pas opposer les deux.
Le marché de l'alimentation n'est ni français, ni européen, mais mondial. Agir sur ces variables en raisonnant de façon franco-française peut-il être efficace ? Comment y parvenir sans détruire notre agriculture et notre système de production, et consommer des produits importés qui ne répondront pas aux critères que nous nous sommes fixés, notamment une utilisation moindre des pesticides à l'échelle de la planète ?
Il n'est pas facile de répondre à votre première question car il faudrait mener des comparaisons avec d'autres institutions. L'État a toujours eu des difficultés à exercer sa tutelle sur les opérateurs. Selon les thématiques, il est nécessaire d'instaurer certains contrôles. La plupart des financements de l'OFB sont plus importants que ceux consacrés au plan Écophyto. Lorsque nous avons interrogé l'OFB à ce sujet, nous avons constaté que cette préoccupation n'était pas sa priorité.
La tutelle n'a pas été exercée dans de bonnes conditions : il n'y a pas eu d'alerte permettant de constater une consommation insuffisante des crédits et surtout de reporter les crédits non consommés sur l'année suivante. Les volumes des financements sont modestes ; chaque million perdu est une action non réalisée. S'agissant d'une taxe affectée, il importe que la tutelle vérifie que les montants sont bien utilisés conformément aux dispositions votées.
Un tel report peut se produire dans d'autres cas, même si je ne peux pas citer d'exemple.
Je n'oppose pas la PAC et le bio, qui sont des approches différentes et complémentaires. Le bio est une façon de produire et de distribuer bien identifiée et certifiée, avec des règles qui permettent à cette filière d'exister partout dans le territoire et à l'échelle européenne.
Les financements et les mécanismes de la PAC, qui est la boîte à outils, sont-ils suffisamment mobilisés pour encourager les bonnes pratiques et décourager celles qui le sont moins ? Personne n'a souhaité remettre en cause le soutien à la conversion, pendant les trois années qui permettent à un agriculteur d'obtenir la certification bio. Ces primes compensent les pertes de l'agriculteur, qui accepte d'introduire des contraintes permanentes, sans pouvoir valoriser ses produits comme s'ils étaient déjà bio. En revanche, l'aide au maintien n'a pas été pérennisée en France : certaines régions l'ont instaurée, d'autres l'ont abandonnée. Une réflexion doit être menée, non seulement sur le bio, mais aussi sur d'autres modes de production qui utilisent moins de produits phytopharmaceutiques.
La nouvelle PAC a élargi la palette des possibilités. La France a décidé de mobiliser presque tous ces outils pour encourager les bonnes pratiques. Encore faut-il que les différents décideurs utilisent ces possibilités.
D'autres contraintes, réglementaires, s'exercent. Certaines sont incluses dans le plan stratégique national : on ne pourra pas jouer dessus. Nous pensions que l'on pourrait durcir les conditionnalités, qui permettent de ne verser des financements qu'à condition que l'exploitation ou le produit respecte certaines conditions. Ce travail aurait pu être fait en amont du PSN. Celui-ci ayant été approuvé, il faut se donner rendez-vous lors de sa prochaine révision.
Pour ce qui concerne les marchés, plusieurs aspects sont à examiner, en particulier s'agissant du positionnement de la France : exporte-t-elle des matières premières ou des produits à forte valeur ajoutée ? À l'heure actuelle, nous sommes présents dans les deux activités, mais il faudra sans doute se demander si cela constitue notre positionnement stratégique sur le long terme ou s'il faudra faire porter nos efforts sur ce point.
Outre la question des contraintes se posent celles de la valeur et des apports pour le territoire. Nous estimons qu'il existe des marges de manœuvre. La France dispose d'un bon positionnement dans plusieurs secteurs avec des produits à assez forte valeur ajoutée. Ce modèle peut être performant à l'échelle européenne et internationale, et mérite d'être poursuivi, plutôt que de chercher à conquérir de nouveaux marchés. Ceux-ci seront en effet très tendus, car on voit arriver sur le marché mondial des producteurs qui ne respectent pas les contraintes environnementales que nous nous donnons.
Le rapport souligne aussi l'importance de la cohérence et de la réciprocité. Jusqu'à peu, on produisait en France des substances interdites à l'utilisation agricole domestique, que l'on exportait vers d'autres pays producteurs, lesquels les incorporaient dans leurs productions, que l'on importait ensuite. On doit s'efforcer d'imposer une plus grande cohérence. Des marges de manœuvre existent, notamment avec les clauses miroirs, qui offrent la possibilité, au fur et à mesure que se négocient les contrats commerciaux internationaux, de relever les exigences et de faire en sorte que le consommateur français ne supporte pas des résidus de pesticides interdits en France.
La question des externalités se pose dans tous les cas : une partie du bénéfice n'est pas réalisée. L'impact des pesticides est pour partie lié, non aux consommateurs, mais au lieu de production et à son environnement. Nous avons besoin d'une réflexion, notamment à l'échelle européenne, qui fasse progresser les dimensions agronomique et économique, mais aussi la réglementation sociale. Si l'on accepte que des travailleurs de certains pays s'exposent fortement à certains risques, on crée une concurrence illégitime, avec des conséquences fortes sur la santé humaine. Ce n'est pas l'internationalisation ou l'européanisation des marchés qui supprime les marges de manœuvre : sur certains sujets, la France peut prendre les devants. Elle le fait, avec raison. Par la suite, des rapports de force s'exercent, aux différentes échelles, grâce auxquels on peut parfois constater des avancées significatives.

J'ai du mal à voir des avancées significatives dans la compétition mondiale : nous sommes plutôt en recul. La part des produits importés dans la consommation nationale augmente dans toutes les filières. Quant au dispositif des clauses miroirs, il pourrait être intéressant mais il est inopérant pour le moment. Je suis bien moins optimiste que vous.
L'objectif de réduction des produits phytosanitaires a été fixé sans différenciation qualitative. Sortir des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), donc dangereuses, pour se tourner vers d'autres produits phytoconventionnels non dangereux ne constituerait donc pas une avancée ? On garde le Nodu, avec des indicateurs de passage, car on veut atteindre un objectif de sortie qui semble irréalisable. Choisir de remplacer un CMR qui a un indicateur de fréquence de traitements phytosanitaires (IFT) de 1, par un autre produit conventionnel de même IFT avec une rémanence moins importante, conduit à traiter davantage, donc à dégrader l'IFT. L'exploitation apparaît alors comme moins vertueuse au regard du Nodu, qui, pour simplifier, n'est que l'addition des IFT. Chacune d'elles connaît son IFT et sait qu'elle doit faire des efforts sur ce sujet, par exemple pour obtenir une certification haute valeur environnementale (HVE). Avec le Nodu, j'ai le sentiment que l'on fixe des objectifs qui ne sont pas réalistes mais plutôt idéologiques.
J'ai été gêné de vous entendre parler de RPD trop faibles : cela renvoie à une vision caricaturale de l'administration, selon laquelle les solutions passent forcément par les taxes. Pour mon exploitation viticole du Bordelais, la RPD correspond à 1 000 euros par an. Cela n'est pas énorme au regard du chiffre d'affaires mais considérable eu égard aux marges quasi négatives de la viticulture bordelaise. Continuer d'augmenter les RPD serait faire peser le poids sur l'agriculteur, non sur le reste de la chaîne : ce serait facile et peu encourageant.
La PAC fixe des objectifs environnementaux, mais quid de la compétitivité quand la nouvelle politique reste à budget constant ? On va donc orienter des budgets visant à améliorer la compétitivité de l'agriculture française vers des pratiques vertueuses. Très bien, mais il ne faudra pas s'étonner si la production décroche, dans les exploitations comme sur le marché intérieur. Cela semble en contradiction avec l'objectif de souveraineté alimentaire. Il faudra pourtant bien parvenir à concilier les deux !
Enfin, quel regard portez-vous sur la stratégie en matière de glyphosate, eu égard au récent avis de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments ?
Christian Huyghe a brillamment présenté les indicateurs : tous ont des biais. Le Nodu est le moins mauvais des indicateurs que l'on a pu trouver en se mettant d'accord pour suivre une trajectoire. Les agriculteurs utilisent l'IFT, qui a aussi des biais. L'essentiel est que chacun puisse s'emparer d'un indicateur reconnu et dont les biais sont connus.
Par exemple, si l'on renonce à l'enrobage des semences, on supprime les nicotinoïdes au profit d'autres molécules, lesquelles se retrouvent dans les QSA – les quantités d'enrobage des semences ne sont pas prises en considération. Les biais sont donc nombreux : il faut les connaître et pouvoir les expliquer.
Ayant une valeur symbolique forte, le Nodu écrase les autres indicateurs, lesquels témoignent tout de même des efforts qui peuvent être faits. Quant à le considérer comme la somme des IFT, je vous laisse la paternité de cette affirmation. Il faudrait du moins établir le lien entre le Nodu national et les efforts que peuvent réaliser les agriculteurs, pour être fiers de la part qu'ils prennent dans la réduction des produits phytosanitaires.
Nous ne commenterons pas vos remarques. Vous êtes libre de les faire, et nous les comprenons assez bien.
Dans notre rapport, nous avons souhaité présenter toute la palette des solutions, sans les reprendre nécessairement à notre compte. S'agissant des mesures fiscales, nous avons envisagé celles qui seraient susceptibles de fonctionner. Il ne nous revient pas de décider s'il faut les appliquer. Elles ont non seulement un impact direct sur ceux qui les subissent, mais aussi des effets politiques, qui ne relèvent pas de nos responsabilités.
Notre responsabilité est de regarder ce qui est susceptible de fonctionner, d'en évaluer les avantages et les inconvénients. Nous avons intégré dans notre rapport des tableaux mettant en évidence les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour chaque stratégie que nous recommandons. Nous en présentons une analyse, que j'espère équilibrée, et qui reprend pour partie les éléments que vous évoquez. Nous n'étions pas sans connaître certaines des conséquences que peuvent avoir les mesures.
La compétitivité est décisive à bien des égards : il faut continuer à travailler sur ce point, à toutes les échelles. Aujourd'hui, on examine beaucoup les bilans commerciaux à l'échelle nationale, mais il faut aussi envisager les comptes d'exploitation.
Dans le secteur des fruits et légumes, par exemple, on doit analyser pourquoi les entreprises manquent de compétitivité et ont du mal à répondre à la demande locale, qui est pour partie satisfaite par les importations. L'analyse est à poursuivre, car nous n'avons pas pu la décliner secteur par secteur. Le ministère travaille avec chacune des filières pour essayer de repérer les difficultés et définir la stratégie adéquate.
Nous avons en effet essayé de passer en revue tous les champs des possibles, considérant que les entretiens ou les expériences menés contenaient de nombreuses solutions pour améliorer la situation. Nous n'étions pas forcément favorables à l'augmentation des taxes. La démarche était intéressante, car le caractère redistributif n'est pas toujours exploré. Dans l'exemple choisi, l'augmentation des taxes avait pour but de restituer les fonds aux agriculteurs qui tentaient de diminuer leur consommation de produits phytopharmaceutiques. Il ne s'agissait pas d'augmenter les budgets de l'État ou des bénéficiaires de taxes affectées, le cas échéant, mais de redistribuer les fonds à ceux qui adoptent de bonnes pratiques. Nous avons voulu explorer cet exemple pour offrir des solutions.

Globalement, je ne suis pas en phase avec vos présentations. D'abord, je souhaiterais apporter une nuance sémantique. Vous avez dit que l'on fabrique en France des produits phytosanitaires qui y sont interdits et qui sont utilisés dans d'autres pays. Or il y a plusieurs raisons à ces interdictions. Soit les produits sont classifiés comme phytotoxiques, et il faut alors ne pas pouvoir les produire ; soit leur renouvellement n'est pas demandé car de meilleurs produits existent sur le marché ; soit ils servent à lutter contre des ravageurs qui n'existent pas en France ou en Europe – dans ce cas, la raison de cette absence d'autorisation est tout simplement qu'elle n'a pas été sollicitée.
Vous avez évoqué la possibilité de changer tout le système, de l'amont de la fourche à l'aval de la fourchette. Tout changer pour parvenir à changer, c'est la garantie que l'on n'y arrivera pas. En tant qu'agriculteur, je suis persuadé que des choses sont possibles. Mais on change d'abord parce que l'on apprend qu'il est possible de changer et que l'on y a intérêt ; ensuite, parce que la marche pour y parvenir semble accessible.
Revenons aux betteraves qui, polygermes, nécessitent d'être éclaircies manuellement. Dans ma région de polyculture-élevage, la betterave fourragère a été abandonnée en quelques années car sa culture était trop compliquée et difficile, physiquement : le maïs l'a remplacée. Si l'on se questionne sur ce qui poussera les agriculteurs à changer, on obtiendra des résultats. Mais aucune contrainte extérieure, comme le Nodu national, ne permettra d'aboutir à un tel changement.
De même, on peut se demander pourquoi les conversions au bio ne sont pas plus nombreuses, voire pourquoi, comme cette année, les déconversions sont aussi massives. La conversion est très difficile sur le plan agronomique, car il faut maîtriser de nombreuses techniques. De surcroît, la production bio reste variable : si l'on peut bien gagner sa vie certaines années, on peut aussi connaître un épisode de mildiou, par exemple. On doit donc s'interroger sur le caractère accessible et suffisamment stable du bio.
Je suis persuadé qu'une démarche volontariste et double est nécessaire pour réduire les produits phytosanitaires : il faut rechercher des solutions et offrir des formations aux agriculteurs, qui en manquent. Descendus du tracteur, certains collègues ont du mal à identifier une maladie ou un ravageur et peuvent effectuer des traitements qui ne sont pas indispensables. Les solutions existent ; il faut les chercher, filière par filière. Alors, naturellement, le Nodu diminuera.
Dans le Centre-Ouest de la France, la culture du tournesol a apporté de la diversité et favorisé les insectes pollinisateurs. Elle est pourtant en train de s'écrouler, après la suppression d'un produit qui, placé sur les graines, avait un effet répulsif pour les oiseaux – il présentait peut-être un problème que je ne conteste pas. À cause des pigeons, toutes les exploitations proches d'un clocher doivent abandonner cette culture intéressante car elles doivent semer les graines de tournesol trois fois pour la réussir ! Elle est remplacée par du colza, que l'on traite davantage, ou du maïs, qui nécessite plus d'eau et de produits.
Une approche filière par filière est nécessaire. Vous avez raison de dire qu'il faut également territorialiser car les maladies ou les ravageurs, donc les solutions, diffèrent d'un territoire à un autre, distant d'une centaine de kilomètres. Si l'on réfléchit ainsi, on parviendra à diminuer les produits phytosanitaires, ce que souhaitent tous mes collègues. Tout le monde l'a compris : chaque agriculteur qui ouvre un bidon se demande s'il ne joue pas avec sa santé ou avec l'environnement. Il faut des éléments accessibles, connus et réalisables.
Nous partageons beaucoup de choses et peut-être me suis-je mal exprimé, car nous avons précisément tenté d'inscrire dans notre rapport de nombreux points évoqués dans votre intervention, notamment la question de l'adoption et de la marche accessible – comment sort-on d'un système que certains sociologues disent aujourd'hui marqué par un verrouillage sociotechnique ? Comment déverrouiller ce système et permettre aux agriculteurs d'en sortir pour adopter une meilleure pratique ? Comme vous l'avez indiqué, cela suppose tout à travail, un « design » de solutions qui soient adoptables. Ce mouvement est aujourd'hui largement en cours et un important travail de recherche et de transfert est engagé, qui doit être approfondi.
On peut compter à ce titre l'innovation variétale, les techniques de semis et le Bulletin du végétal, qui peut contribuer au choix du calendrier. L'effet de ces mesures n'est cependant pas à la hauteur de l'objectif fixé dans le cadre du plan Écophyto depuis son origine. Vous indiquez qu'il faut travailler filière par filière, mais il faut également travailler de manière transversale et interfilières – c'est l'enjeu de l'agroécologie : il ne suffit pas de construire toujours le même itinéraire très simplifié sur la même parcelle, comme c'est parfois la tendance aujourd'hui, notamment dans des exploitations de très grande taille. Certaines solutions utilisent aujourd'hui la nature – comme l'assolement, connu depuis très longtemps, qui minore les besoins en eau ou en autres intrants, et qu'il faut parvenir à promouvoir –, mais elles sont souvent interfilières, et non pas spécifiques à une filière.
L'agriculteur, qui se trouvait confortablement établi à l'intérieur de sa filière, doit aussi apprendre parfois à en sortir pour travailler selon une modalité plus transversale. À cet égard, la filière bio a pris un peu d'avance, car elle a déjà appris à travailler de cette manière, avec des échanges entre pairs au sein d'exploitations agricoles, dont les groupements d'agriculteurs biologiques (GAB). Ces échanges sont importants et il faut donc mener, parallèlement à la recherche très technologique sur certains sujets, tout un travail d'accompagnement, parfois de recréation des collectifs, lui aussi très important et qui doit également, semble-t-il, être mené à l'échelle territoriale. C'est l'un des points sur lesquels nous nous sommes rejoints.
J'ai donc l'impression que nous nous retrouvons sur bon nombre des points que vous avez évoqués, et que ce qui nous oppose est plus un écart de communication qu'une question de fond. Il nous semble que le plan Écophyto doit s'adresser en priorité aux agriculteurs. Les responsabilités ont été bien identifiées, en amont et en aval, au cours des éditions précédentes. Certains verrous sont dans notre main, et non pas dans celle des agriculteurs, et il faut bien les traiter. Certains échanges ont notamment montré l'importance du réseau de collecte et les blocages qui se situaient à cette échelle. Une action déterminée sur les réseaux de collecte peut ainsi aider à régler toute une série de difficultés qui ne peuvent l'être que dans de très grosses exploitations agricoles capables d'investir seules dans les dispositifs alors que, dans la plupart des cas, compte tenu de l'organisation des exploitations, c'est à une échelle collective qu'il faudra trouver des solutions.

Je souhaite revenir sur la gestion. Pourriez-vous faire un bilan plus détaillé de la mise en œuvre de la redevance pour pollution diffuse, sur le plan tant national que régional ? Parmi vos recommandations, avez-vous également réfléchi à l'instauration d'une taxation de l'industrie agrochimique qui fournit ces produits à nos exploitants ? Il s'agit en effet, dans la chaîne des acteurs de l'usage des produits que vous avez évoquée, de ne pas viser seulement les exploitants, acheteurs finaux des produits phytosanitaires – vous avez d'ailleurs invoqué à ce propos un principe de cohérence qui est un élément important.
Votre rapport évoque également, parmi les ambitions du plan Écophyto, le fait que ce plan devait être autofinancé, et vous avez exprimé à ce propos une certaine déception, soulignant notamment que les crédits non consommés échappaient à la volonté de consacrer plus de moyens à la réduction de l'emploi des produits phytosanitaires. Tout cela est évidemment lié à la faiblesse de la gouvernance et à l'absence de pilotage financier et politique dans la mise en œuvre du plan, que vous avez évoquées tout à l'heure.
Un deuxième aspect est l'importance des dispositifs d'accompagnement des exploitants sur le terrain. La PAC est sans doute fondatrice pour intégrer cette ambition et, au sein de la communauté agricole, vous insistez sur la nécessité de moyens humains pour favoriser des politiques vertueuses. Je m'interroge sur les solutions territoriales nécessaires pour mettre en œuvre cette ambition, compte tenu du risque d'impasse économique et de rupture qu'elles induisent dans certaines filières en raison de conditions ou de sanctions trop fortes qui leur seraient associées. Comment accompagner et motiver économiquement les exploitants pour les amener à faire les bons choix ? Comment accompagner les agriculteurs dans ces changements ? Vous avez employé tout à l'heure des mots forts, proposant d'agir petit territoire par petit territoire, dans la diversité agricole. Il me semble en effet essentiel de désamorcer une vision trop jacobine de nos territoires, et je souscris donc à certaines de vos remarques en la matière.
Par ailleurs, nous percevons sur le terrain des alertes lancées notamment par des agents de l'OFB qui déplorent de ne pas pouvoir remplir convenablement leurs missions par manque de ressources humaines. Quelles solutions de ressources humaines complémentaires envisagez-vous, à l'échelle des structures publiques, pour renforcer l'action sur le terrain afin d'appliquer les politiques du plan phyto ?
L'accompagnement des agriculteurs est l'un des grands objectifs du plan Écophyto. Les agriculteurs ont l'habitude de travailler en groupe – les cuma et autres dispositifs de ce type existent en effet depuis très longtemps. Le dispositif des fermes Dephy impliquait 3 000 fermes, réparties en 200 groupes et accompagnées par des ingénieurs réseaux pour les agriculteurs volontaires afin de montrer la faisabilité de cette démarche. Elles avaient aussi pour mission de porter les fruits de leur travail au sein de la communauté.
Ce dispositif a été révisé dernièrement, après la publication du rapport. Je ne l'ai pas étudié en détail, mais la démarche a montré que c'était possible mais que la diffusion par-dessus la haie ne suffisait pas. Ce point avait déjà été relevé dans le cadre d'un plan précédent et on imaginait alors qu'en prenant les moyens de subventionner l'engagement de 30 000 agriculteurs, soit 10 % de la population, on pourrait démultiplier l'action. Ce dispositif, peut-être complexe et pas assez subventionné, n'a pas atteint, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Potier, les objectifs attendus. Le rapport a en effet montré qu'un cinquième seulement de l'objectif était atteint, avec 6 000 agriculteurs volontaires sur les 30 000 attendus. Il y a donc certainement lieu de retravailler ce dispositif.
Un autre dispositif est celui des groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE), dans lequel s'engagent de nombreux agriculteurs et dont 50 % des projets concernent des produits phytosanitaires. Ce dispositif, piloté par les agences de l'eau, offre parfois des taux de subventionnement un peu plus élevés.
Peut-être faudrait-il mieux coordonner ces deux dispositifs, les rendre plus accessibles aux agriculteurs et leur assurer un meilleur accompagnement. Peut-être faut-il aussi monter en puissance en termes de capacités des personnes qui accompagnent les agriculteurs. Bien souvent, en effet, comme nous l'avons noté dans le rapport, cet accompagnement est confié, pour des raisons essentiellement financières, à de jeunes agronomes sortant de l'école : peut-être faut-il établir des liens avec des agronomes, des techniciens ou des ingénieurs attachés à des chambres d'agriculture ou d'autres structures et qui ont beaucoup plus de compétences, afin que l'information et la formation allient l'expérience aux connaissances nouvelles acquises à l'école.
J'apporterai deux compléments. La RPD est aujourd'hui due non seulement par les acheteurs finaux de produits phytopharmaceutiques, mais aussi par les vendeurs de ces produits. Le mécanisme est bien construit. Certains trouveront que le taux est déjà élevé, mais il ne représente en réalité qu'une faible part du coût des produits phytopharmaceutiques et n'est donc pas de nature à modifier significativement les décisions économiques, car il enchérit certes le prix, mais pas dans des proportions importantes. Des économistes ont donc examiné l'élasticité prix des acheteurs de phyto. Ces travaux, cités dans notre rapport, montrent qu'il faudrait un montant de RPD très élevé pour modifier significativement la décision des acheteurs. Cette solution, bien qu'elle existe, est donc problématique.
Par ailleurs, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Deprost, l'argent collecté au titre de la RPD ne revient pas dans la poche des agriculteurs car, pour partie, il finance des actions d'environnement visant notamment les agences de l'eau, qui disposent ainsi de moyens destinés à transformer l'agriculture.
J'en viens à votre deuxième question, la question institutionnelle. Au-delà de l'OFB, il faudrait évoquer l'ensemble des acteurs existants. À l'échelle nationale, quatre ministères sont impliqués : ceux de la recherche et de la formation, de l'agriculture, de la transition écologique et de la santé, qui sont les plus engagés à l'échelle nationale. On retrouve des représentants de ces ministères à l'échelle régionale, avec une séparation des fonctions, et donc un problème de pilotage régional, comme cela a été dit tout à l'heure. Nous recommandons, pour notre part, que ce soit la Draaf qui soit chargée de la coordination de l'ensemble du plan à l'échelle régionale, sous l'autorité du préfet, qui n'assure aujourd'hui qu'une sorte de coordination et n'est nullement en situation de responsabilité sur l'ensemble du plan.
Nous pensons aussi qu'il faut associer le niveau départemental à cette démarche, avec toutefois cette difficulté qu'il n'existe plus aujourd'hui de directions départementales de l'agriculture ou de l'alimentation, mais des directions départementales des territoires, interministérielles, qui possèdent un service d'économie agricole, lequel s'est du reste partiellement vidé car une partie des activités que menaient les départements ont été transférées aux régions au titre de la nouvelle PAC. La capacité de ces directions départementales à accompagner la transition agroécologique, dont les produits phytosanitaires ne sont, somme toute, qu'un seul élément, doit peut-être être renforcée. C'est là l'un des points sur lesquels le ministère a travaillé, y compris en aval de notre rapport, et qui mérite véritablement attention.
De nombreux autres services de l'État sont également concernés, notamment dans le domaine de la surveillance sanitaire, assurée par les Draaf et à l'échelle départementale. Je ne vais pas vous brosser un tableau exhaustif, mais les acteurs sont multiples. Ceux-ci ne partagent pas forcément de vision collective et peuvent se retrouver en difficulté. L'agriculteur peut avoir le sentiment, sur ce sujet-là comme sur d'autres, qu'il se trouve au centre d'un système très complexe dans lequel les acteurs ne se parlent pas beaucoup et où un grand effort de pédagogie doit être mené. Nous sommes tous conscients que l'accompagnement de l'agriculteur est crucial ; dans ce domaine, l'État dispose de marges de progrès réelles.
Quels sont les acteurs qui peuvent accompagner les agriculteurs ? Une ancienne proposition recommandait de créer un conseil stratégique sur le phytosanitaire : chaque agriculteur aurait été soumis tous les cinq ans à l'obligation de faire travailler un prestataire le conseillant sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Dans notre rapport, rédigé il y a deux ans et demi, nous privilégions l'installation d'un conseil stratégique qui ne soit pas circonscrit au phytosanitaire. À l'échelle d'une exploitation, les produits phytosanitaires ne peuvent être que l'une des solutions d'une palette d'actions plus large. La réduction de l'utilisation de ces produits ne dépend pas uniquement de la sphère phytosanitaire, voilà pourquoi il nous a semblé indispensable que le conseil stratégique puisse se pencher sur la totalité de l'activité de l'exploitation et pas uniquement sur le volet phytosanitaire. Les acteurs du conseil devront s'organiser, car leur mission dépassera celle de l'aide à la vente de semences ou de produits phytosanitaires. Ce travail nécessaire d'adaptation est en cours.

Je suis inquiète car vous dites que les produits phytosanitaires se trouvent au cœur d'un système. Autre motif d'inquiétude, votre rapport a été rédigé, si j'ai bien compris, pour répondre à celui de la Cour des comptes, mais vos conclusions se rejoignent et sont également proches de celles de Dominique Potier, posées il y a bientôt dix ans. Bref, il a fallu des heures de travail pour constater que la France est à la traîne pour réduire, sans parler d'abandonner, l'usage des pesticides.
Je m'interroge également sur la chaîne dont vous avez décrit les différentes étapes : l'amont, la partie relevant des agriculteurs et l'aval : avez-vous constaté des freins à la baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires ?
Des agents de la Draaf ont contacté des producteurs cet été pour leur demander de modifier leurs déclarations sur les aides de la PAC et de solliciter des dispositifs moins avantageux en utilisant leur droit à l'erreur, alors qu'ils n'en avaient commis aucune. La nouvelle PAC permet d'actionner des critères, mais les budgets provisionnés seront insuffisants : voilà le message qui a été envoyé aux agriculteurs en leur demandant de faire valoir leur droit à l'erreur.
Pensez-vous que la PAC actuelle, qui repose sur des aides à l'hectare, constitue un frein à la réduction de l'utilisation des pesticides ?
Nous avons déjà identifié, dans nos échanges aujourd'hui et dans nos communications, de nombreux freins : il y en a à toutes les étapes de la chaîne. En aval, par exemple, les consommateurs ont des attentes esthétiques sur les produits qu'ils achètent sur les étals, cette exigence pouvant constituer un frein à la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires ; en effet, certaines actions ne sont effectuées que pour combler cette demande et ne contribuent en rien à la qualité organoleptique des marchandises finales. Je ne souhaite pas me focaliser uniquement sur les consommateurs, d'autant que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette situation. Pensons, par exemple, aux collecteurs : dans un dispositif de collecte qui permet de séparer les graines de coquelicot du blé, il n'est pas grave de livrer du blé mélangé à ces graines ; mais si le circuit de collecte impose à l'agriculteur une séparation stricte entre les deux, le défi devient plus difficile. Pour qu'il y ait moins d'herbicides, il est nécessaire d'organiser les étapes en aval en conséquence et d'accepter de réceptionner des marchandises qui ne soient pas totalement pures. Il existe encore bien d'autres exemples.
Il ne nous appartient pas de présenter la nouvelle PAC, d'autant que nos travaux datent de deux ans et demi. La nouvelle version de la PAC comporte de nouveaux concepts, notamment le droit à l'erreur qui permet aux demandeurs d'aide de modifier leur dossier dans un certain délai et à la condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un contrôle depuis la première demande. Cette possibilité peut donner lieu à des discussions avec l'administration, mais nous ne pouvons pas évaluer ces relations, encore moins s'il s'agit d'un cas particulier.
Une grande partie des fonds de la PAC sont attribués sur des critères liés à la surface ou au nombre d'unités animales de l'exploitation, car la motivation première de cette politique est de soutenir les revenus agricoles. Il y a deux ans et demi, nous pensions qu'il était possible d'augmenter les conditionnalités et d'en lier certaines au phytosanitaire : l'idée était de les durcir progressivement afin de réduire l'usage de ces produits.
La discussion était très avancée lorsque nous avons rédigé le rapport. Le plan a été approuvé ; il est maintenant mis en application. Cela reste un enjeu pour l'avenir, à l'échelle française comme européenne, où différents travaux sont menés en vue de préparer un nouveau règlement sur l'usage des produits phytosanitaires – vous auditionnerez certainement des personnes plus qualifiées que nous pour vous l'exposer. Établir un lien entre ces deux volets de la politique agricole est dans les esprits : cela débouchera certainement.
Pour ce qui est de la convergence des rapports, les résultats du plan Écophyto de 2008 à aujourd'hui ont fourni des exemples concrets qu'il est possible de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Les différentes stratégies ont mis en avant des expériences intéressantes menées par des filières, que l'on pourrait massifier : dans le domaine économique, elles témoignent que des avancées sont possibles en renforçant l'effet redistributif. Avec une convergence des politiques, on peut aussi avancer.
La vraie difficulté reste la massification. Ces nombreuses possibilités ne sont pas utilisées dans cet objectif. On donne peut-être trop de place au volontariat. Si l'on veut obtenir davantage de résultats, il faut être plus incitatif.

Comment inciter les gens à aller vers le bio si l'on ne s'en donne pas les moyens ?
En tant que producteur de pommes, je sais qu'une annonce de conversion au bio fait peur au banquier, car elle constitue une prise de risques pendant trois ans. La production passe de 60 à 20 tonnes par hectare, soit une diminution de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Renoncer aux produits phytosanitaires revient à augmenter le travail manuel, pour l'éclaircissage des pommes, par exemple. Payer 300 heures de main-d'œuvre à 11,52 euros, le tarif du Smic brut, plutôt qu'épandre vingt minutes, en tracteur, un produit chimique coûtant 300 euros, c'est se créer une charge de 4 000 euros par hectare, cela, alors que les aides de l'État s'élèvent à 900 euros par hectare,
Pourquoi un tel frein à aller vers le bio ? Ce n'est pas que les agriculteurs sont contre, ce qui compte, c'est de vivre : les agriculteurs ont le droit de se dégager un salaire. Il y a une forme d'hypocrisie dans ce système où l'on demande en plus aux agriculteurs de nourrir les gens pour pas cher, parce qu'il faut que tout le monde puisse manger.
Il faut s'enlever de l'esprit que l'on peut vendre un kilo de pommes bio au même prix qu'un kilo de pommes non bio, parce que l'agriculteur bio produira beaucoup moins, avec des charges bien plus élevées et des difficultés pour trouver la main-d'œuvre.
Quel est votre sentiment sur ces aides à la conversion ?
Nous partageons votre diagnostic, que nous avons aussi établi dans d'autres secteurs d'activité. Le soutien aux filières et aux productions économes en pesticides n'est pas suffisant. L'écart entre les deux systèmes est trop faible. Une bonne partie de ceux qui passent au bio ou diminuent les phyto le font par militantisme. Souvent, ils ne s'y retrouvent pas, économiquement parlant, et ce, de moins en moins : plus leur production bio augmente, plus ils s'éloignent des marchés de niche au pouvoir d'achat plus élevé, et plus les contraintes économiques sont fortes.
On le voit avec la difficulté à concrétiser les mesures de la loi Egalim concernant la restauration collective, qui aurait dû servir de relais de croissance. La part des produits bio ou locaux atteint 9 %, loin de la cible de 20 %. Des prescripteurs publics – État, collectivités territoriales – en sont responsables.
Les pouvoirs publics n'accentuent donc pas assez l'écart entre les systèmes économes et non économes en phyto.
Le second point important est de déterminer qui doit payer. À l'origine, l'idée était que les consommateurs choisiraient le bio comme un produit de luxe. Or le bénéfice n'est pas évident pour eux : il réside, non dans la qualité organoleptique de la pomme bio, mais dans des externalités négatives plus réduites sur la santé humaine, la biodiversité ou les paysages. Le consommateur de produits bio n'est pas forcément celui qui doit payer la diminution de ces externalités. Décider de qui doit financer cette transition et quels leviers on doit utiliser est une question politique, qui doit faire l'objet de débats.

Vous avez évoqué la nécessité que l'Union européenne prenne des décisions pour certains sujets, et que les territoires en prennent pour d'autres. Des projets alimentaires territoriaux (PAT) se développent, parfois difficilement. La volonté politique varie d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un autre. Comment favoriser leur installation ?
La question est assez éloignée de mon domaine d'expertise principal et je serai donc très prudent. Dans notre rapport, nous avons pris les PAT comme l'un des bons exemples de territorialisation dans le domaine de l'alimentation. Dans beaucoup de ces PAT se pose la question de l'accès aux ressources alimentaires, ainsi que celle de leur territorialisation. C'est là l'un des dispositifs qui permettraient de progresser dans le domaine des phyto, et nous l'avons présenté comme tel dans notre rapport.
Il existe cependant des freins à la diffusion ou à la réussite de ces projets, liés principalement à la dispersion des acteurs concernés. Au début, l'État a réalisé un gros effort pour accompagner les PAT, mais cette initialisation n'a pas été suivie dans la durée, car ces compétences ont été considérées comme territoriales. Je n'irai pas très loin dans ce domaine, mais du moins avez-vous raison d'évoquer cette expérience comme un point lié à notre sujet et sur lequel il est possible de réaliser des progrès en associant à ces mécanismes des enjeux de production agricole, couplant ainsi alimentation et agriculture.
Travaillant, dans le cadre de la planification écologique, sur les données numériques, je sais que le ministère de l'agriculture soutient le projet des PAT pour lui assurer un développement et permettre aux nouvelles technologies de favoriser le partage d'informations avec une nouvelle plateforme des PAT au niveau national : il s'agit de recueillir de la donnée et de diffuser l'information pour améliorer les pratiques, afin de pouvoir capitaliser sur les bons résultats obtenus dans un endroit sans être obligé de repenser à chaque fois tout le système.

Monsieur Ronceray, pour reprendre l'exemple de la pomme citée par notre collègue, vous disiez que le bio n'était pas assez soutenu et ne pouvait donc pas rejoindre le prix de la pomme non bio. Ne s'agit-il que de soutenir le prix de la pomme bio pour qu'il rejoigne celui de la pomme non bio ou, puisque les enveloppes sont à moyens constants, cela ne signifie-t-il pas que c'est la pomme non bio qui est trop soutenue ?
La France a besoin de s'assurer de la pérennité de l'agriculture. Une partie importante de la production agricole est économiquement assez fragile et a besoin de se réformer, de se restructurer et de changer. Considérer qu'une partie des producteurs seraient trop soutenus ne me semble pas être une idée forte à retenir et ce n'est en tout cas pas la perspective dans laquelle nous nous sommes situés. Il semble cependant que l'allocation des ressources et les priorités pourraient être quelque peu infléchies pour prendre davantage en compte les enjeux sanitaires. Plus on examinera cette question dans le détail, plus on pourra lui apporter des réponses pertinentes. En effet, la situation n'est pas la même pour les grandes cultures en zone intermédiaire que, par exemple, pour le maraîchage en zones périurbaines.
On a tendance à examiner globalement et à l'échelle nationale des questions différentes, avec pour seul indicateur le Nodu, alors qu'elles mériteraient une analyse plus appropriée qui devrait être localisée et circonscrite : on verrait alors qu'il y a des réponses évidentes. En effet, une partie de l'agriculture française est aujourd'hui en difficulté et il importe de veiller à ce qu'elle ne soit pas complètement détruite. Il existe également des processus de transformation et des lieux où, faute de main-d'œuvre, on recourt de plus en plus aux entreprises de travaux agricoles. Des questions se posent également à propos du foncier.
Je crois que vous devrez bientôt débattre d'une loi traitant de l'ensemble de ces questions et nous y pensions également dans notre rapport. La question des produits phytosanitaires n'est pas séparable des autres questions qui touchent aujourd'hui le présent et l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation françaises.

J'ai eu l'occasion d'échanger avec Patricia Blanc, chargée d'élaborer le plan annoncé par Élisabeth Borne au salon de l'agriculture. Trois grands leviers existent en matière de politique de pesticides : le plan Écophyto, des conditions de marché fixées pour définir la concurrence loyale ou déloyale et intégrant l'aide de la PAC et, en troisième lieu, les régimes d'autorisation. L'appétence pour le bio, qui représente un segment de marché, et la réglementation qui a donné lieu au retrait des CMR ont été les principaux moteurs actifs, tandis que les moteurs liés au développement et à la PAC n'ont pas été actionnés.
Je souhaiterais également que vous évoquiez un autre volet que vous mentionnez dans votre rapport : celui du contrôle – non pas celui de la dépense de l'argent public, dont nous avons vu qu'il était pour le moins lacunaire, mais le contrôle de la réglementation relative aux phyto, qui est presque inexistant. Comment expliquez-vous qu'il y en ait si peu ? Est-ce une négligence ? La peur, sur le plan social, de créer des irritants dans la profession ou dans les territoires ? Un manque de moyens ? De l'inconscience ? Il est stupéfiant qu'une politique dont nous mesurons depuis une dizaine d'auditions l'impact sur la santé publique, sur la biodiversité et sur la qualité de l'eau soit aussi peu contrôlée. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres et quelques éléments d'explication ?
J'évoquerai plus spécifiquement les contrôles opérés par les services régionaux de l'alimentation dans le cadre des Draaf. Pour les agriculteurs bénéficiant d'aides de la PAC, les contrôles phyto sont fixés à 1 % des agriculteurs, soit 3 500 contrôles pour l'année 2018 ou 2019. Les agriculteurs qui ne respectent pas la réglementation risquent des réfactions de prime PAC, de l'ordre de 1 % à 3 %, ou des procès-verbaux. Selon nos calculs, 2 % de procès-verbaux ont été dressés, mais nous ne disposions pas du montant des réfactions de prime PAC.
Ces contrôles sont effectués par des inspecteurs spécialisés de ces services, dont les effectifs sont en effet assez restreints, comme c'est le cas, me semble-t-il dans tous les ministères. Même s'il peut sembler très lourd et très stressant pour l'agriculteur d'avoir sur le dos pendant deux ou trois heures un inspecteur qui explore les moindres détails, un contrôle peut-il être bien mené dans ce délai, qui ne permet pas d'aller voir des parcelles situées parfois à plus de 10 kilomètres ni de vérifier les dosages ou la relation entre les entrées et les sorties ? L'OFB réalise également des contrôles, qui portent sur les zones de non-traitement : lorsqu'ils constatent un versement d'herbicides sur ces zones, ses agents sont amenés à verbaliser, mais je ne dispose pas de chiffres à ce propos.

Grand merci pour votre disponibilité et votre patience, ainsi que pour le temps que vous avez pris pour nous répondre. Vos interventions seront très utiles pour la suite de nos travaux, y compris pour la suite des auditions. Je retiens, monsieur Deprost, que vous avez souligné certaines inconséquences, notamment l'absence de programmation pluriannuelle. Des questions très générales de principe et des procédures de conformité l'emportent sur le résultat à atteindre. L'action publique en France est vraiment malade de ces détails d'exécution, qui font perdre de vue le sens même de l'action menée.
La séance s'achève à onze heures trente.
Membres présents ou excusés
Présents. – Mme Anne-Laure Babault, M. Frédéric Descrozaille, M. Grégoire de Fournas, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Mathilde Hignet, M. Éric Martineau, Mme Marie Pochon, M. Dominique Potier, M. Loïc Prud'homme, Mme Mélanie Thomin, M. Nicolas Turquois